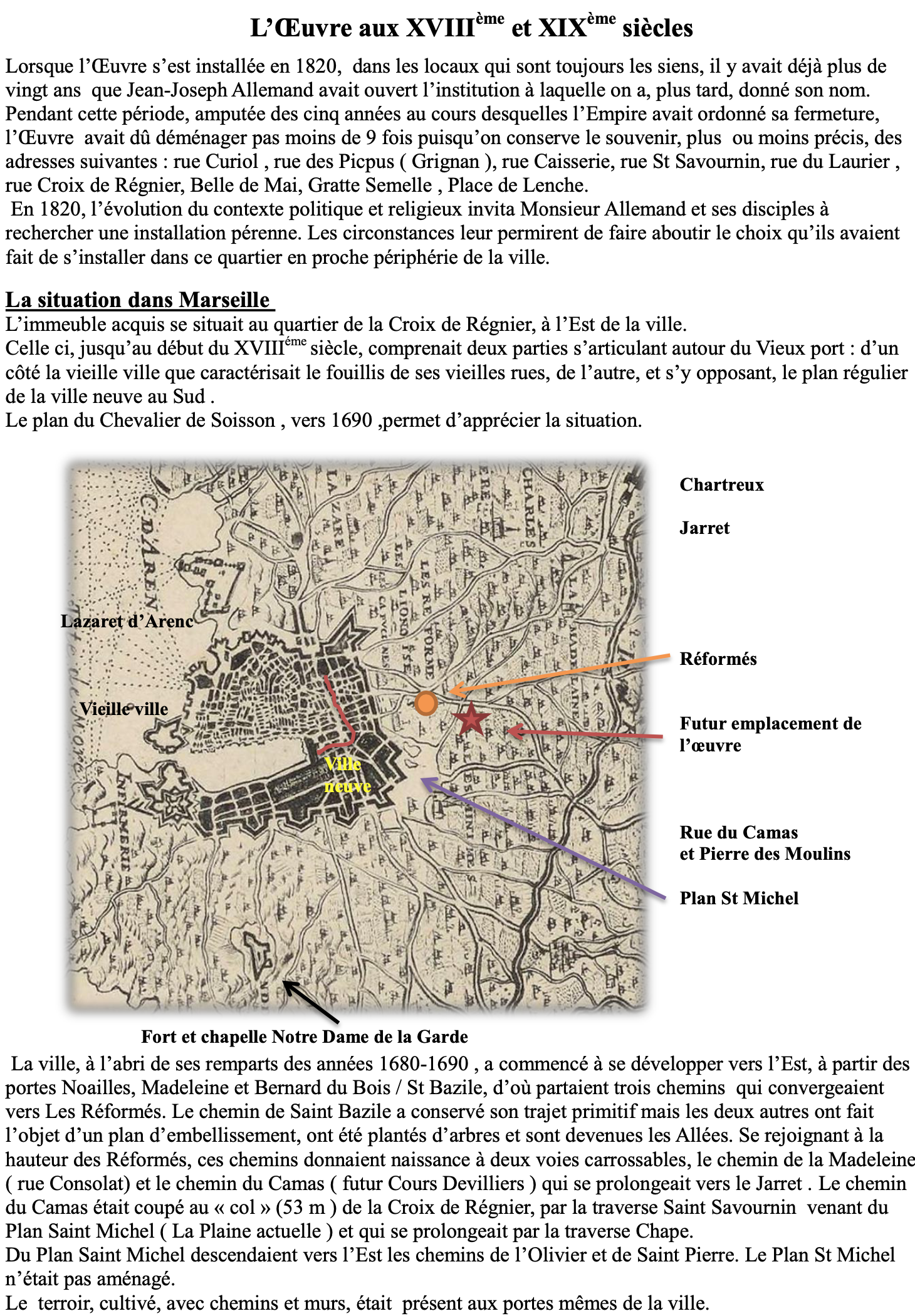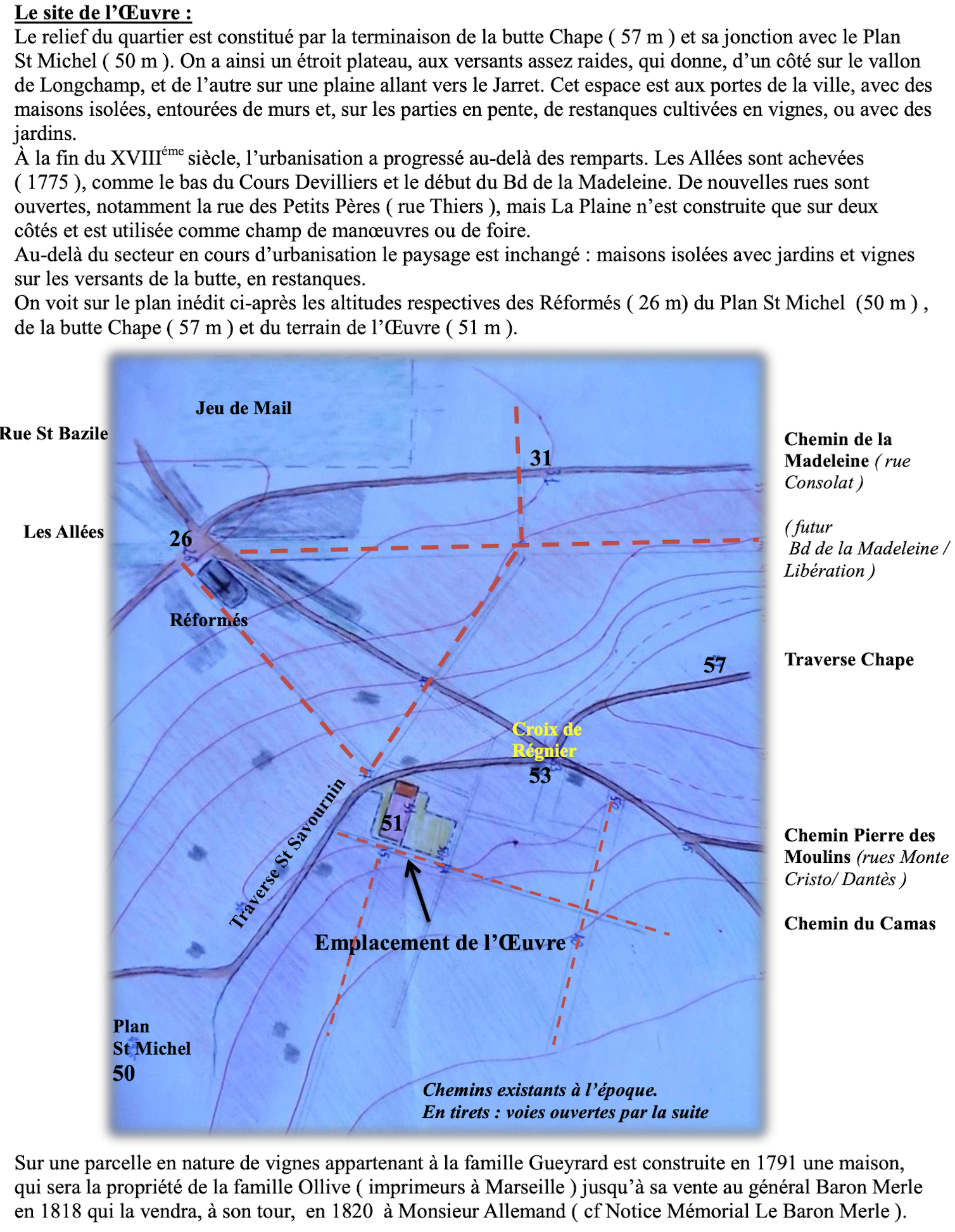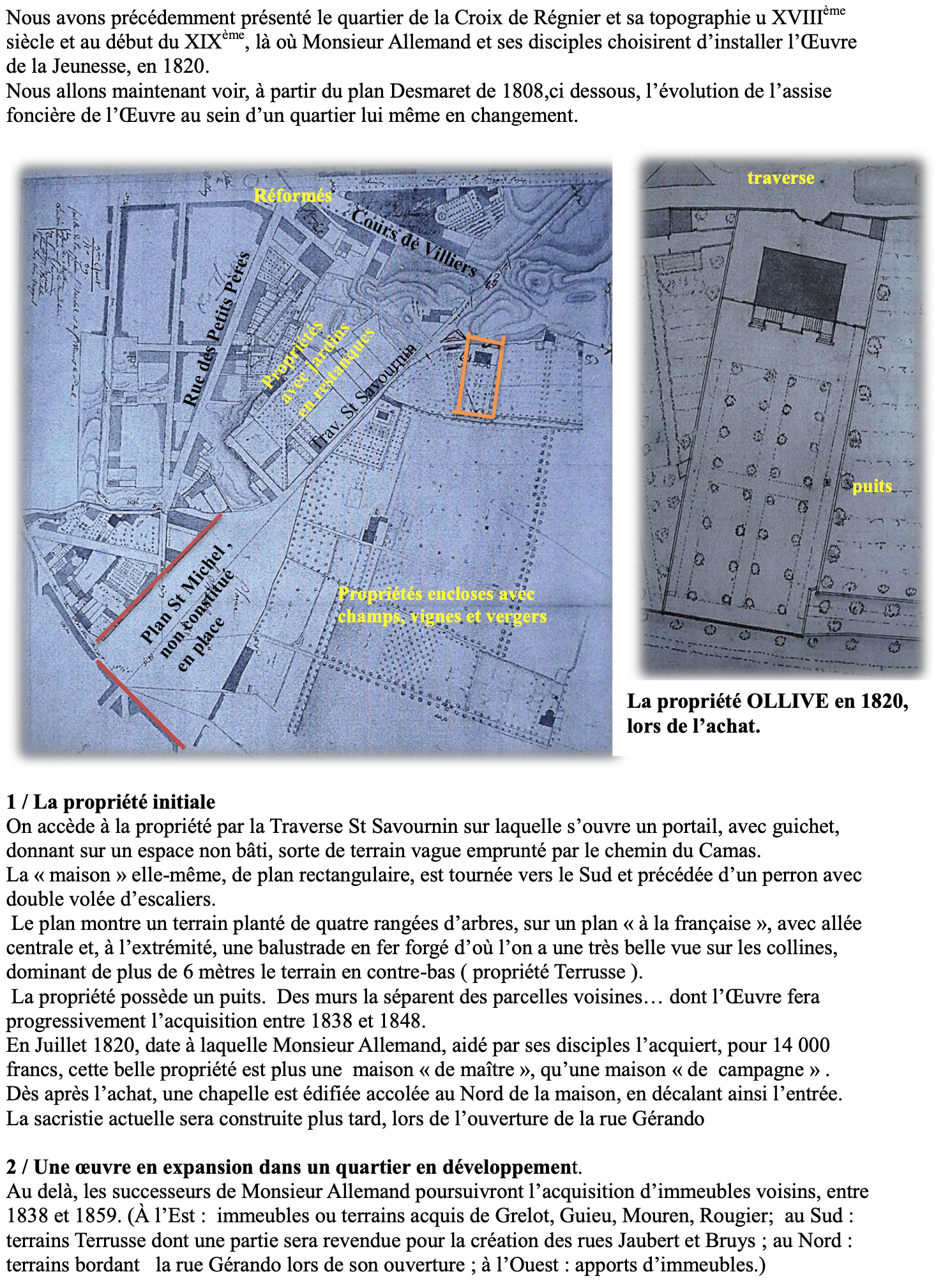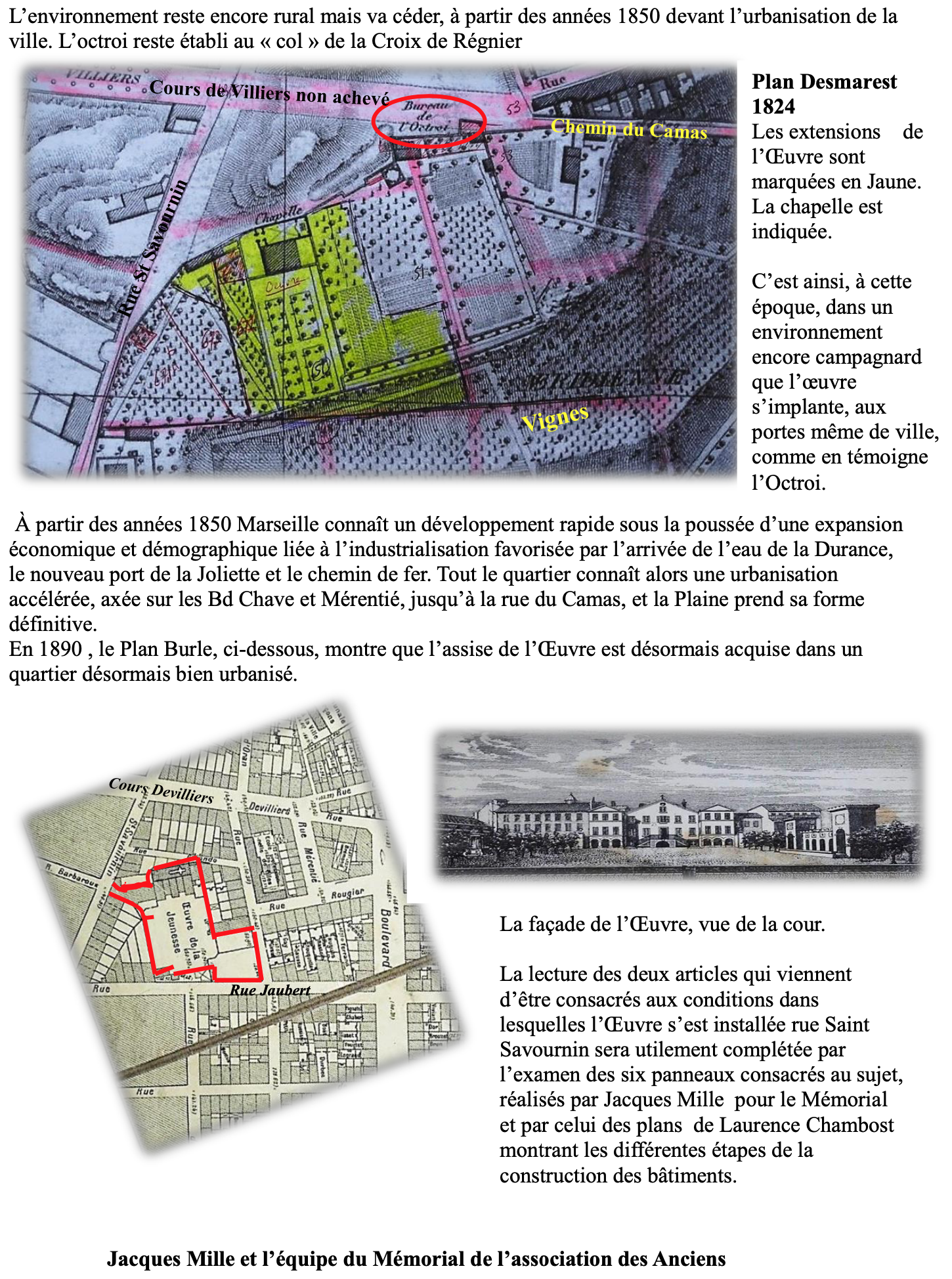Patrimoine
Le Patrimoine de l’Œuvre
L’Œuvre n’est pas un musée, mais elle a acquis ou obtenu au cours de son histoire différentes œuvres d’art, essentiellement pour la chapelle, qui constituent un patrimoine.
Ce patrimoine visible et tangible se trouve augmenté du patrimoine que constitue la mémoire commune de faits ou de récits d’évènements qui jalonnent son histoire. L’un comme l’autre ont vocation à s’enrichir au travers de la vie qui est celle de l’Œuvre.
Une équipe qui émane de l’Association des Anciens contribue à ce travail de mémoire.
Cette rubrique reprend les différentes études qu’elle a pu réaliser de façon discontinue.
Sommaire (cliquez sur la rubrique pour y accéder)
1. UN PEU D’HISTOIRE
1.2. L’Ordination de Jean-Joseph Allemand
1.3. L’Œuvre avant 1820 (l’évolution du quartier)
1.4. L’année 1820 : le contexte historique de l’installation de l’Œuvre rue Saint-Savournin
1.4.1. La maison du Baron Merle
1.4.4. Regards sur Marseille et la Provence en 1820
1.6. La « Congrégation Allemand » et la création de l’Œuvre Timon-David
1.7. L’Œuvre à l’exposition catholique de Marseille (26 mai – 18 juin 1935)
1.8. L’Œuvre de la jeunesse de Nîmes
2. LE CADRE
2.1. La chapelle au fil du temps
2.5. Le tableau de l’Adoration des mages
2.6. La statue de l’Assomption
2.8. Le tombeau de Monsieur Allemand
2.10. La statue de Jean-Joseph Allemand
2.12. L’oratoire de la grande cour
3. LES REPRÉSENTATIONS OU ÉVOCATIONS DE MONSIEUR ALLEMAND
4. LES INSTITUTIONS DE L’ŒUVRE
4.1. Les « Charges » à l’Œuvre
L’Oeuvre du Bon Pasteur
Jean-Joseph Allemand, né en 1772, a fréquenté l’Œuvre du Bon Pasteur de 1786 jusqu’à sa fermeture en 1791. C’est là qu’il sentit s’affirmer sa vocation ; il s’imprégna auprès des Prêtres du Sacré Cœur de Jésus qui dirigeaient l’Œuvre du Bon Pasteur de la méthode qu’il adapta aux attentes de la jeunesse de la Restauration et à sa personnalité.
La Société des Prêtres du Sacré Cœur
Les Prêtres du Sacré Cœur étaient des prêtres du clergé séculier du diocèse de Marseille, qui, en 1732, s’étaient voués à la dévotion au Sacré Cœur, dans le prolongement de la consécration du diocèse par Mgr de Belsunce pendant la peste de 1720. Au nombre de douze, ils étaient réunis en société (on dirait actuellement en association) et, sous l’autorité de l’Évêque, s’attachaient à « l’instruction de la jeunesse, à l’éducation des ecclésiastiques et la sanctification des fidèles de l’un et de l’autre sexe ». Bénéficiant de la confiance épiscopale, ils animaient des œuvres pour la jeunesse à Marseille, prêchaient des retraites pour les prêtres du diocèse et des missions dans la région. Dès 1740, Mgr de Belsunce leur avait en outre confié de fait le petit Séminaire diocésain. Les prêtres du Sacré Cœur ouvrirent un pensionnat en 1762 puis des classes de philosophie et de théologie après la suppression de l’Ordre des Jésuites en France en 1763. En 1789 Jean-Joseph Allemand y vint faire ses études de philosophie.
S’incitant mutuellement à cultiver (comme le détaille le chanoine Brassevin, auteur de l’Histoire des Prêtres du Sacré Cœur parue en 1876 et dont nous citerons dans la suite du texte les écrits entre guillemets) « les vertus d’humilité, de douceur, d’obéissance, de pénitence, de désintéressement, de zèle, de pauvreté et de simplicité », ils se distinguaient par leur maintien modeste, se tenant généralement les yeux baissés, les mains cachées dans les manches de leur soutane, la tête inclinée légèrement, ce qui faisait dire d’eux : « Es dou bouen Pastour, a le couélé de caire » (Il est du Bon Pasteur, il a la tête penchée). À côté de cela, on leur reconnaissait une grande rectitude de jugement ; accessibles à tous, ils savaient plaisanter et plaire.
La société se sépara le 31 janvier 1791, par suite du refus de ses membres de prêter serment à la Constitution civile du clergé. Le séminaire fut fermé ; les prêtres, devenus réfractaires, s’exilèrent. La société se reforma après la Révolution ; Jean-Joseph Allemand en fut membre à partir de 1807.
L’Œuvre du Bon Pasteur
Les deux premiers prêtres du Sacré-Cœur furent Denis Truillard et Boniface Dandrade (dont les portraits sont exposés dans le Musée de Monsieur Allemand). Ils reconstituèrent la congrégation « des petits enfants de l’hôpital des Enfants abandonnés », établi à proximité de la Porte d’Aix, et dont ils avaient été successivement aumôniers. Les Prêtres du Sacré Cœur firent l’acquisition de la chapelle dite du Bon Pasteur qui était dans le même quartier de la Bourgade.
Recueillant des jeunes gens pour les « former à la piété », ils y mettaient en œuvre une éducation basée sur le jeu et sur la prière. Ils les réunissaient en « congrégations », c’est-à-dire en associations pieuses de laïcs, sur le modèle des congrégations des Jésuites1. Ils inspirèrent ainsi la création de la congrégation de l’Enfant Jésus, dite de la « petite jeunesse » et celle de Saint-Jean-Baptiste, appelée de la « grande jeunesse » pour les plus âgés. L’ensemble formait l’Œuvre de Jeunesse. Ils y ajoutèrent la congrégation de Saint-Joseph, pour les artisans ainsi que deux congrégations féminines, dont celle, pour les femmes mariées, de « Notre Dame des Sept Douleurs »(!). Parmi les 12 prêtres de la communauté, deux exerçaient la direction de l’Œuvre. Ils étaient assistés par des membres du séminaire plus particulièrement chargés de l’Œuvre, appelés les « Pères de jeunesse ». Ceux-ci étaient aidés par les plus âgés des jeunes gens « qu’ils habituaient… à se dévouer pour leurs camarades les plus jeunes. Ils s’appliquaient à faire jouer les petits ». Les Pères du Bon Pasteur avaient en outre élevé en principe que « le meilleur moyen d’attacher les jeunes à une œuvre est de leur donner quelque chose à y faire ».
Les trois grandes congrégations
– La congrégation du Saint Enfant Jésus accueillait les enfants à partir de l’âge de 8 ans. Sous la surveillance des Pères de Jeunesse, ils s’amusaient (aux barres, aux billes, à la toupie, à l’épervier, aux boules, au loto, etc.) et « étaient formés à l’acquisition d’une réelle piété ». Les Pères leur faisaient le catéchisme, les préparaient à la communion (à l’époque entre 12 et 14 ans). Ils leur inspiraient « l’idée et le désir de la perfection ». Il était demandé à chacun de choisir une règle de vie (heure du lever, fréquentation des sacrements à intervalles réguliers, exercices de piété, lectures quotidiennes, oraison, fréquence des examens de conscience, etc.) et de s’engager à la respecter. Les Pères cherchaient à favoriser entre eux « l’esprit d’association qui entraîne à la volonté de pratiquer des vertus communes ». Ainsi furent constituées des « unions » sous forme des congrégations, telle que celle de Saint Louis de Gonzague, dont Jean-Joseph Allemand fut membre.
– La congrégation de Saint Jean Baptiste, également appelée « Grande Jeunesse », accueillait ceux des jeunes gens qui parvenus à l’âge de 18 ans et préalablement formés par la fréquentation de la congrégation de l’Enfant Jésus, s’engageaient à une vie d’exigence. « Ils y trouvaient des occupations en rapport avec leur âge en s’agrégeant à une réunion d’hommes plus âgés qu’eux ». Les Pères de Jeunesse n’intervenaient pas dans la vie de cette congrégation.
Sous le patronage de Saint Jean Baptiste, la Grande Jeunesse avait pour but de faire acquérir à ses congréganistes « l’esprit du désert, de la retraite sévère ». Un des directeurs avait énoncé : « Vous n’êtes pas faits pour convertir les (gens mauvais) mais pour leur résister ». Il était prescrit à ses membres « entrés dans la partie sérieuse de la vie chrétienne », de ne négliger aucun sacrifice pour « discerner (leur) vocation ».
Les membres se réunissaient tous les vendredis soirs et un dimanche par mois, pour réciter les offices, suivre la messe, entendre des lectures édifiantes, méditer et se donner la discipline.
– La congrégation de Saint Joseph comprenait exclusivement des artisans. Ses membres se retrouvaient le dimanche après midi. Ils suivaient les vêpres, l’office des morts, une instruction, et enfin le Salut du Saint Sacrement. Un dimanche par mois une messe était célébrée pour la congrégation. Ils pouvaient venir à l’Œuvre tous les soirs « pour se délasser ». Certains étaient déjà mariés.
La vie au Bon Pasteur
Les différentes congrégations suivaient chacune les règles qui leur étaient propres et dont nous avons indiqué les grandes lignes. Elles se retrouvaient dans diverses fêtes et manifestations qui venaient animer le cours régulier de la vie de l’Œuvre et qui ont été consignées dans un « coutumier » . Ce recueil décrit les grands moments de la vie au Bon Pasteur.
L’année s’ouvrait par la fête de la Congrégation qui précédait celle de L’Épiphanie. Ce jour-là, les congréganistes tiraient au sort les noms de fruits dont ils étaient invités à se priver l’année durant. Quelques jours plus tard, la fête de la « Partie des rois » (comme on dit une « partie » de campagne) consistait en une journée de récréation au cours de laquelle les membres de l’Œuvre (des enfants jusqu’aux Pères) désignaient par tirage au sort un roi et sa cour. Ils déjeunaient ensuite en chantant en français ou en provençal, sur des mélodies populaires, des parodies, des textes plaisants ou moqueurs, que composaient pour la circonstance des membres de l’Œuvre, des séminaristes, parfois même des Prêtres du Sacré-Cœur. La journée se terminait par la représentation d’une saynète comique, telle que l’« Âne musicien ».
L’année se poursuivait par la procession dite « du Parce » (du nom du chant de pénitence « Parce, Domine… » – Pitié, Seigneur…) qui parcourait Marseille pour racheter les débordements susceptibles d’advenir lors du Carnaval. Venait ensuite la retraite du « Jeudi gras » , prélude à l’Adoration du Très Saint Sacrement devant le reposoir installé à l’Œuvre ; cette adoration se poursuivait dans sept autres églises de la ville. La retraite de Pentecôte préparait plus tard aux communions. Au début de l’été, l’Œuvre fêtait Saint Louis de Gonzague. En août avait lieu la grande retraite dans la maison de Sainte-Marguerite, qui s’achevait par un pèlerinage à Notre-Dame-de-la-Garde. Une autre retraite, au début du mois de novembre, précédait l’Octave des morts. Les différentes responsabilités au sein des congrégations, appelées les charges (maître des novices, sacristain, choriste, visiteur des malades, etc.), étaient attribuées au mois de novembre. La fête de la Nativité n’était autrement marquée que par la célébration de trois messes basses pendant la nuit de Noël dans l’église du Bon Pasteur.
Les locaux de l’Œuvre
Les Prêtres du Sacré-Cœur avaient acquis en 1735 la chapelle en mauvais état du Bon Pasteur au quartier de la Bourgade. En 1738, elle fut démolie et remplacée par l’église du Bon Pasteur. Elle s’élevait à l’emplacement de la rue qui porte son nom, près de la place d’Aix, à la hauteur de l’actuelle rue des Fiacres.
L’église était construite sur une chapelle partiellement enterrée du fait de la déclivité du terrain. C’est dans cette chapelle que fut placée en 1788, la statue de l’Assomption qui est actuellement dans la chapelle de l’Œuvre Allemand.
Une cour pour jouer, désignée sous le nom d’enclos, jouxtait l’église. Le pensionnat occupait deux maisons de l’autre côté de la rue. Le séminaire était attenant à l’église. En 1791, l’église, dont les Pères avaient été chassés, fut affectée à un curé « jureur » et finalement démolie en 1794.
Les Pères du Bon Pasteur possédaient également une maison de campagne, dans le quartier de Sainte-Marguerite, qui était utilisée pour les retraites fermées.
L’héritage
En 1791, l’Œuvre du Bon Pasteur ferma ses portes pour ne plus les rouvrir. Les jeunes gens qui la fréquentaient se dispersèrent. La société des Prêtres du Sacré-Cœur qui l’animaient ne se réunit plus et les Pères qui avaient refusé de prêter serment à la constitution civile du clergé partirent en exil, notamment dans les États pontificaux. Un petit nombre d’entre eux, dont l’abbé Reimonet qui recueillit Jean-Joseph Allemand entre 1793 et 1798 et l’accompagna jusqu’à son ordination, poursuivirent leur ministère dans la clandestinité. Plusieurs prêtres furent pris, condamnés à mort et exécutés. Lorsque les persécutions cessèrent, les prêtres du Sacré-Cœur se retrouvèrent à Marseille mais leur société fut rétablie seulement en 1825.
L’Histoire de la Société des Prêtres du Sacré-Cœur rapporte que c’est l’abbé Bonnafoux, un de ses membres, revenu d’exil dès 1795, qui présenta Jean-Joseph Allemand, ordonné prêtre en 1798, aux quatre premiers garçons qu’il réunit en mai 1799, sous l’invocation de Saint Louis de Gonzague. C’était pour leur faire le catéchisme. On note que ces enfants étaient issus de familles dont des membres avaient fréquenté le Bon Pasteur. Plus tard, lorsque Monsieur Allemand installa son Œuvre rue du Laurier, il fut aidé par l’abbé Baron, prêtre du Sacré-Cœur revenu d’exil, qui fit aménager le local et le lui loua.
La relation entre les Prêtres du Bon Pasteur et Monsieur Allemand n’a jamais été interrompue, comme le confirmerait, si besoin était, le fait que ce dernier choisit comme confesseur et directeur de conscience l’Abbé Ripert, prêtre du Sacré-Cœur. Monsieur Allemand avait repris les méthodes éducatives qui permettaient aux « jeunes gens » d’accéder à l’âge adulte en affirmant leur personnalité, en approfondissant leur foi et en s’attachant à discerner leur vocation. Ici comme là, on retrouve l’importance de la prière, du partage des responsabilités et de la nécessaire attention à porter aux autres. Jean-Joseph Allemand perpétua en outre dans son Œuvre l’essentiel des fêtes et traditions du Coutumier du Bon Pasteur.
Des nuances, plutôt que des différences, distinguent cependant les deux Œuvres. En premier lieu, Monsieur Allemand n’a pas prévu de faire renaître une congrégation semblable à celle de Saint Joseph Artisan, car son projet était en priorité l’édification des enfants des catégories moyennes et bourgeoises. De même, il ne s’est pas intéressé aux congrégations féminines. Enfin, il n’a pas établi de congrégation similaire à celle de Saint Jean Baptiste, celle du Saint Enfant Jésus comprenant tous les jeunes gens sans limitation d’âge.
On relèvera que le jeune fondateur de cette Œuvre de jeunesse était un homme seul qui devait pourvoir à tout et ne pouvait se disperser. Les prêtres du Bon Pasteur, qui étaient plus nombreux, se partageaient les tâches. Les Pères de Jeunesse, leurs séminaristes, les assistaient. Monsieur Allemand ne disposa pas d’appuis constants tant que ses disciples ne se furent pas constitués en Institut en 1821. Sans doute cette situation l’amena-t-elle à accorder encore plus d’importance aux « Grands » et à accentuer le rôle de ce qu’il est convenu d’appeler « l’évangélisation du semblable par le semblable ».
On soulignera également que lorsque la direction est assumée par un seul homme, celui-ci imprime sur l’institution un cachet plus net que lorsque les décisions peuvent être partagées. On ne mésestimera pas, ainsi, l’incidence probable de la personnalité, du caractère, de Jean-Joseph Allemand qui, pour atteindre le but élevé qu’il s’était fixé, entendait diriger son œuvre sans partage. On relèvera, de même, que le soin extrême qu’il portait à la conduite de chacune des âmes qui lui étaient confiées ne lui permettait pas d’envisager qu’elle puisse être déléguée à des tiers. On mentionnera enfin que l’état d’esprit de ceux qui avaient animé l’Œuvre du Bon Pasteur était sans doute celui de l’Ancien régime, alors que l’Œuvre de Monsieur Allemand a frayé son chemin dans un XIXe siècle dont les mentalités étaient marquées par ce qui avait été vécu pendant la Révolution et l’Empire.
•••
On voit par là que les deux institutions ne pouvaient être que différentes mais au-delà des dissemblances, on soulignera la communauté d’esprit qui a trouvé une de ses expressions les plus nettes par l’agrégation de Jean-Joseph Allemand à la Société des Prêtres du Bon Pasteur en 1807 alors même que celle-ci n’avait pas encore été officiellement rétablie.
Association des Anciens
Équipe du Mémorial
Bibliographie :
– Anonyme, mais communément attribuée au Chanoine Auguste Brassevin, Histoire des Prêtres du Sacré Cœur de Marseille, 1876.
– Actes du colloque tenu lors du bi-centenaire de l’Œuvre Allemand, paru en 1999 aux éditions La Thune
– Abbé Félix Brunello, Vie du serviteur de Dieu J.J.Allemand, fondateur de lŒuvre de la jeunesse, 1852.
– Abbé Gaduel, Le directeur de la jeunesse ou la vie et l’esprit du serviteur de Dieu Jean-Joseph Allemand, 1867.
Nota : On peut retrouver cet article sur le site internet de l’Oeuvre, au chapitre Patrimoine, Rubrique « Un peu d’histoire ».
1 Cf. Régis Bertrand, Actes du colloque organisé lors du bi-centenaire de l’Œuvre en 1999.
Jean Magalon
Sources :
Archives et Documents Œuvre Jean-Joseph Allemand.
Brunello, Abbé Félix, Vie du serviteur de Dieu Jean-Joseph-Allemand, fondateur de l’Œuvre de la jeunesse (1772-1836), Paris, Sagnier et Bray ; Marseille , Chauffard, 1852.
Gaduel, Abbé Jean-Pierre-Laurent, Le Directeur de la jeunesse ou la vie et l’esprit du Serviteur de Dieu Jean-Joseph Allemand, prêtre du diocèse de Marseille…, Paris, Lyon, Jacques Lecoffre et cie, 1867.
Arnaud, Henry, La Vie étonnante de J.-Joseph Allemand Apôtre de la Jeunesse, Marseille, Sopic, 1966 (supplément au n°91 de Notre Écho).
Arnaud, Henry, 1789 L’Église de Marseille dans la tourmente, Marseille, Imprimerie Robert, 1988.
Bruschi, Christian, «L’Œuvre de la Jeunesse de Marseille . Un prêtre marseillais devant la jeunesse bourgeoise du xixe» dans Provence Historique, t. XXIX, fascicule 117, 3e trimestre 1979.
Mazel, Elie, Vie de Pierre-Hugues Victor Merle, Nîmes, A. Baldy, 1860
L’ordination presbytérale de Jean-Joseph Allemand
Fondateur de l’Œuvre de la Jeunesse en 1799
1.
Le dernier en date des biographes de Monsieur Allemand, Henry Arnaud1, rapporte que Monsieur Allemand fut ordonnée prêtre le 19 juillet 1798 à Saint-Barnabé, à Marseille par Mgr de Prunières « dans la propriété des Carvin » où ce dernier se cachait. Les deux autres biographies connues de la vie de M. Allemand, dues, l’une à l’abbé Brunello, publiée en 1852, l’autre à l’abbé Gaduel, dont la première édition est de 1866, ne donnent pas plus de précision, et seul l’abbé Gaduel mentionne la date de cette ordination.
Les circonstances de cette ordination ne manquent pourtant pas de retenir l’attention ; en 1798, en effet, les prêtres réfractaires, et ceux qui les accompagnaient, étaient toujours traqués. Par ailleurs, le lieu même de l’ordination, c’est-à-dire la campagne Carvin, n’a pendant longtemps pas été identifié et enfin, aussi curieux que cela puisse paraître, les archives diocésaines n’ont pas trace de cette ordination.
À l’issue de la période de la Grande Terreur montagnarde qui avait été particulièrement dramatique pour le clergé, la liberté de culte avait été rétablie en 1795. Dans le prolongement du coup d’état d’Août 1797 (17 fructidor An V), dirigé par le Directoire contre les royalistes, les persécutions reprirent cependant contre les prêtres réfractaires et ceux qui tentaient de rentrer en France. Mgr de Belloy, évêque de Marseille, dont le siège apostolique avait été rattaché à celui d’Aix, vivait caché sur ses terres dans l’Oise. Il avait donné pouvoir de conférer les ordres à des évêques qui se dissimulaient dans la région, notamment Mgr de Prunières, ancien évêque de Grasse et Mgr de Beaumont, évêque de Vaison2. Leurs évêchés avaient été supprimés par la Révolution. Mgr de Prunières3 avait émigré, puis était rentré en France en 1797 et il vivait caché dans les environs de Marseille. Il fut reçu dans la maison de la famille Reimonet de la rue Bernard du Bois, connue sous le nom de « maison du Figuier » et qui existe encore. Il y procéda à plusieurs ordinations, dont celle du futur cardinal d’Astros et, d’après le neveu de l’abbé Reimonet, y consacra le Saint Chrème lors de la semaine de Pâques 1798.
Il ne faudrait pas croire que le climat de terreur et la crainte des dénonciations aient contraint l’abbé Reimonet et ses disciples, issus pour l’essentiel de l’Œuvre du Bon Pasteur, à se terrer dans la maison de la rue Bernard du Bois ; bien au contraire, sous des déguisements divers, ils étaient souvent en déplacement dans le terroir de Marseille, et jusqu’à Aix-en-Provence, pour enseigner et réconforter leurs disciples.
Jean-Joseph Allemand fut donc ordonné prêtre, de façon clandestine, dans une maison particulière, par un évêque qui se déplaçait de cache en cache. L’ordination avait eu lieu un dimanche en pleine nuit. Malgré les précautions prises, la police eut vent de cette ordination et l’évêque ne dut son salut qu’en se glissant dans une cachette souterraine.
On rappellera que la même année, en 1798, le Père Donnadieu, revenu clandestinement à Marseille, y fut fusillé le 29 mars et que le pape Pie VI, enlevé de Rome, fut tenu en détention par les soldats français.
Jean-Joseph Allemand qui avait vécu la période révolutionnaire dans la maison de famille de l’abbé Reimonet, rue Bernard du Bois, n’avait pas suivi la formation habituelle des futurs prêtres. Les séminaires avaient été fermés en 1791. Jean-Joseph Allemand avait reçu en matière de théologie les enseignements que lui avaient donnés les prêtres qui fréquentaient la maison du Figuier. Il avait suivi l’abbé Reimonet dans ses visites pastorales, fait le catéchisme, accompagné des fidèles, lu, prié et médité. Il n’empêche qu’au jour de son ordination, on considéra qu’il ne pouvait encore administrer l’intégralité des sacrements.
Son ordination est attestée dans une lettre qui est conservée au musée de l’Œuvre. Elle présente l’originalité d’être établie au nom de Mgr Jean-Baptiste de Belloy, évêque de Marseille par Mgr François de Prunières et contresignée par Jaubert, vicaire général, prêtre réfractaire après avoir prêté serment à la Constitution civile du clergé. Cette lettre est datée du jour de l’ordination et porte le sceau de Mgr De Belloy. C’est en quelque sorte en vertu d’une procuration donnée par le titulaire du siège épiscopal que Jean-Joseph Allemand fut ordonné. Le Musée de l’Œuvre expose l’original et la traduction de cette lettre qu’en a faite Mme Gaëlle Viard, enseignant-chercheur à l’Université d’Aix-Marseille. Elle est accompagnée des commentaires de M. Régis Bertrand, professeur émérite d’histoire. Pour établir la validité canonique du document, ce dernier rappelle les pouvoirs particuliers donnés par le pape aux évêques en ces circonstances exceptionnelles.
L’évêché d’Aix-en-Provence, auquel Marseille était alors rattaché, n’a pu, non plus, nous confier un document mentionnant cette ordination, mais on peut penser qu’en cette période de persécution, nul ne tenait à laisser des traces d’actes compromettants.
Henry Arnaud rappelle que, dès le 13 ventôse An XII (1804), le vicaire général de l’archevêque d’Aix « approuva pour la confession » Jean-Joseph Allemand. La même année, l’archevêque d’Aix, Mgr de Cicé, a souligné ses qualités à l’occasion de la visite qu’il fit de l’Œuvre et, lorsque Mgr Fortuné de Mazenod fut nommé évêque de Marseille en 1823, il lui renouvela les autorisations de confesser et de prêcher.
•••
Dix mois seulement après son ordination, en mai 1799, Monsieur Allemand recevait pour le catéchisme quatre garçons issus de familles qui avaient fréquenté l’Œuvre du Bon Pasteur : l’Œuvre de la Jeunesse était née… six mois avant que Bonaparte ne réussisse son Coup d’État du 18 Brumaire !
L’évocation du contexte historique de cette ordination si particulière serait incomplète si quelques précisions ne pouvaient pas être apportées quant au lieu exact de son déroulement, autrement dit si nous ne pouvions indiquer où se trouvait la maison de campagne de la famille Carvin..
C’est ce que nous nous proposons de faire dans un prochain numéro.
Association des Anciens
Commission du Mémorial
- Henry Arnaud, La vie étonnante de Jean-Joseph Allemand, Apôtre de la Jeunesse, 404 pages. Supplément au n° 91 de Notre Écho, publication mensuelle de l’œuvre Allemand, 1966.
- Archives diocésaines.
- François d’Estienne de Saint Jean de Prunières, né à Gap en 1718, est ordonné évêque en 1753. Il n’accepte pas de prêter serment à la Constitution civile du clergé. Son évêché de Grasse est supprimé ; il émigre en Piémont, puis à Bologne, rentre en France en 1797, y vit clandestinement et meurt à Marseille en 1799. Il avait 80 ans lors de l’ordination de Jean-Joseph Allemand.
2.
Nous avons précédemment exposé le contexte historique de l’ordination de Jean-Joseph Allemand pendant les dernières années du Directoire par lequel se termine la période révolutionnaire . Le lieu précis de cette ordination ne paraît pas avoir fait l’objet d’une recherche particulière. On sait seulement qu’elle eut lieu dans la campagne Carvin à Saint-Barnabé. Encore faut-il préciser où se trouvait cette campagne. On soulignera en effet qu’au xviie siècle, la paroisse de Saint-Barnabé était plus étendue que de nos jours et qu’elle descendait jusqu’au ruisseau du Jarret, actuellement recouvert par la « rocade du Jarret ». La paroisse de Saint-Calixte n’a été créée qu’au milieu du xixe siècle.
Les recherches effectuées auprès tant des Archives départementales que du Comité du Vieux Marseille permettent d’établir que la famille Carvin était bien propriétaire à cette date d’une maison de campagne. Georges Reynaud, du Comité du Vieux Marseille, qui a consulté les archives municipales1, précise que « la propriété Carvin (2,5 ha environ avec bastide et ferme)… était délimitée à l’Ouest par le Jarret et au nord par la Traverse des Pierres de Moulins. C’est aujourd’hui le départ de la rue Antoine Pons sur le Bd Sakakini, au niveau du n° 35 […]. Le propriétaire, Joseph Carvin, était décédé en 1789, mais la bastide en 1798 était détenue par sa veuve, née Thérèse de Robolly […] .Connue à Marseille dès le xve siècle, la famille des Robolly se distinguait par son engagement catholique […]. Cette proximité avec l’Église explique sans doute que l’évêque de Grasse y ait été accueilli et qu’il ait là ordonné en secret Jean-Joseph Allemand. Mgr de Prunières décéda quelques mois après dans cette même propriété ».
Le domaine, en nature de vigne et de jardin, comprenait une maison de maître avec bassin et un bâtiment d’exploitation agricole2. Sur le premier plan cadastral dont on dispose, et qui est daté de 1819, l’accès s’effectuait depuis la Traverse des Pierres de Moulin (au Nord), actuellement rue Antoine Pons. Cette voie qui prenait naissance sur l’actuelle rue Monte Cristo, allait, d’après Adrien Blès3 en direction des Caillols.
La propriété fut vendue par la famille Carvin à un certain Farjon, qui la céda rapidement à la famille Viton. Celle-ci la conserva jusqu’en 1864 pour la vendre ensuite à la Compagnie ferroviaire PLM qui y logea sans doute une partie du personnel affecté à la gare de la Blancarde4.
En 1882, le plan Burle que nous a communiqué Jacques Mille, géographe et cartographe, montre qu’à cette date l’Orphelinat Viagliano occupait déjà l’autre côté de la Traverse des Pierres de Moulin. La maison de maître de la propriété Carvin et le bâtiment voisin apparaissent toujours sur le plan.
La Cie du PLM a cédé peu à peu les diverses parcelles, mais elle est restée propriétaire de ces deux derniers bâtiments jusqu’en 1954. Elle les a alors divisés pour les vendre à leurs occupants. Une photographie prise peu avant montre que la bastide et le bâtiment voisin subsistaient.
À ce stade de notre recherche, il apparaissait que le lieu de l’ordination de Jean-Joseph Allemand était bien établi. La campagne Carvin était située dans l’angle Est que forment le Bd Sakakini et le Bd Chave. Monsieur Allemand fut donc ordonné à 1,5 km de la campagne du baron Merle où il installa son Œuvre vingt et un ans plus tard. Une visite sur place nous a cependant permis de découvrir que l’ancien bâtiment d’exploitation agricole, qui est encore sur le terrain, a été mis en copropriété et est habité. Une des propriétaires a bien voulu nous permettre de consulter son acte d’acquisition qui confirme la succession des mutations intervenues depuis l’acquisition par la Cie du PLM ainsi que la mise en copropriété en 1954. Les photos confiées montrent que l’emplacement et la consistance de l’immeuble actuel sont bien celles du bâtiment porté sur le plan de 1819.
Au terme ce cette enquête, nous pouvons considérer d’une part que la localisation de la propriété Carvin est établie, d’autre part que le bâtiment que l’on voit sur le terrain, s’il n’est pas peut être pas celui dans lequel Monsieur Allemand fut ordonné prêtre, a sans doute été fréquenté par ceux qui l’accueillaient.
Nous pourrons désormais nous représenter de façon plus précise l’ordination de Jean-Joseph Allemand « dans la campagne Carvin à Saint-Barnabé » ; nous le verrons peut-être ainsi se glisser à la nuit tombée avec quelques proches, le cœur battant, dans une propriété au bord du ruisseau du Jarret5 ; nous saurons qu’il y avait là une bastide avec sa terrasse, son bassin et peut-être une allée de platanes. On peut douter que Jean-Joseph et ceux qui l’accompagnaient aient prêté attention à la quiétude de cette nuit de Juillet 1798… Il nous restera peut être à trouver le souterrain où Mgr de Prunières, âgé de 80 ans, se glissa ensuite : l’imagination y suppléera !
Nous tenons à remercier pour l’aide qu’ils nous ont apportée pour la documentation de ces deux articles et pour l’analyse d’un certain nombre de données :
Mesdames Régine Bernardini et Gaêlle Viard
Messieurs Régis Bertrand, Olivier Gorse, Jacques Mille et Georges Reynaud.
Association des Anciens
Commission du Mémorial
- Archives municipales, Registres 21 G 29 et 21 G 71, articles n° 153.
- Références cadastrales : Saint-Julien, Section, P Parcelles 919 à 942 . Le plan et l’état de section peuvent être consultés en ligne sur le site des Archives départementales www.archives13.fr
- Adrien Blès, Dictionnaire historique des rues de Marseille, Marseille, Ed Jeanne Laffitte, 2001.
- Sur le plan qui accompagne l’acte de 1864, le corps de bâtiment Ouest a été agrandi ; on lit « magasin et logements », l’autre bâtiment, avec sa terrasse, est qualifié de Maison de maître ; une construction a été édifiée le long de la Traverse des Moulins ; un « séchoir » la prolonge au Sud. Ce plan, ci-joint, a été aimablement communiqué par les Archives départementales ; il est référencé 373 E 526.
- Le boulevard Sakakini épouse toujours à la hauteur du Bd Chave la courbe que forme le Jarret à l’endroit où une butte de terre sur la propriété Carvin en déviait le cours.
La maison du baron Merle
Il est de tradition de situer la création de l’Œuvre Jean-Joseph Allemand le dimanche 16 mai 1799 dans une des chambres d’un immeuble situé vers le haut de la rue Curiol à Marseille chez un certain Monsieur Rome. Elle comptait alors quatre jeunes gens dont la chronique a gardé le nom. Jean-Joseph Allemand avait alors 27ans.
Une errance de deux ans s’en suivit dans des hébergements proposés rue des Picpus (actuelle rue Grignan) par la famille Brassevin ou par la famille de Justin Stamaty, l’un des quatre premiers membres. On parle aussi des domiciles de Monsieur Rome et de celui de Monsieur Aubert, rue Caisserie. Une première et brève installation eut lieu rue Saint-Savournin, probablement dans le local actuellement occupé par le foyer Saint-François-Régis (n°50).
En 1801 un local est loué à l’angle de la Place Saint-Michel (La Plaine) et de la rue des Petits-Pères (rue Thiers), dans la rue du Laurier. Ce local appartenait au savonnier César Lombardon. L’immeuble a été détruit en 1894. On peut situer la véritable création de l’Œuvre à cette adresse. C’est là que furent créées les deux Associations, celle du Sacré-Cœur et celle des Saints-Anges qui furent jusque dans les années 1970 la colonne vertébrale de l’Etablissement. Mais surtout c’est dans ce local qu’eurent lieu pour la première fois des confirmations de membres de l’Œuvre. À cette occasion Monseigneur Champion de Cicé, Archevêque d’Aix fut la première Autorité religieuse à visiter l’Œuvre et à rencontrer son Fondateur.
Depuis 1802, l’Abbé Allemand tombé alors gravement malade, logeait rue des Minimes (actuellement rue des Frères Barthélémy), où il fut alors soigné par M. Guitton et par M. Roubaud, qui était propriétaire de l’Hotel de la Croix de Malte. Il résidera dans ce logement jusqu’en 1817.
Après le Concordat de 1801, le 11 avril 1806, l’Abbé Henry-Toussaint Baron, ancien prêtre du Bon Pasteur revenu d’émigration, acheta à M.de Lombardon le local de la rue du Laurier dans lequel se trouvait déjà l’Œuvre.
Le 8 décembre 1809, l’Œuvre fut fermée par décision de l’administration impériale et de 1810 à 1816 Jean-Joseph Allemand devint vicaire à la paroisse de Saint-Laurent aux appointements annuels de 600francs. Des réunions se poursuivent cependant chez certains membres et trois maisons de campagne furent successivement louées dans des quartiers excentrés: Croix de Reynier, Belle de Mai et Gratte Semelle.
À la chute de l’Empire en mai 1814, J.-J. Allemand loue un local 8 Place de Lenche, l’ancien Hôpital des Enfants Abandonnés et ancien Hôtel Mirabeau. En 1817 Il viendra y demeurer. Ce local était situé à deux pas du Vieux-Port, dans un quartier populaire aux revenus modestes.
Mais en 1820, la fréquentation de l’Œuvre s’est accrue: elle compte près de 300 membres et la location présente plusieurs inconvénients (renouvellement du bail incertain, espace, dépenses à fonds perdu, etc). Une autre préoccupation fondamentale qui apparait dans les différentes biographies et études qui lui ont été consacrées, imprégnait depuis longtemps l’esprit du Fondateur; c’était sa volonté farouche de rechristianiser la jeunesse bourgeoise de Marseille. Il considérait que cette partie de la jeunesse était la plus menacée par l’esprit voltairien dans lequel avait baigné la grande Révolution et qu’il combattait à l’intérieur de l’Œuvre. L’étude des cahiers d’inscription avalise cette interprétation. Monsieur Allemand parlait de «mon œuvre de Muscadins». Ces arguments sont explicitement présentés dans les délibérations du Conseil de l’Œuvre du 9 juillet 1820 préalables à l’acquisition du local actuel.
Des anciens membres et collaborateurs de Monsieur Allemand, munis de conseils de modération financière se mirent en quête de trouver une propriété . Leur choix se fixa sur une maison à un étage avec un jardin clos sauf au midi, située dans le quartier de la Croix de Reynier. C’était une zone encore rurale mais peu éloignée du centre ville notamment des quartiers bourgeois du Chapitre avec ses hôtels particuliers et des allées de Meilhand
L’acte est signé le 9 juillet 1820 devant Maître Roubaud ancien membre de l’Œuvre, notaire à Marseille, par Monsieur Allemand et par divers membres du Conseil. Le prix est de 14000 francs plus 1500 francs de frais dits de notaire pris en charge par Maître Roubaud. Il est prévu une somme de 6500 francs pour la construction d’une chapelle. Le tout se montant donc à 20500 francs. Un financement fut trouvé par une souscription d’actions remboursables par tirage au sort de six mois en six mois à raison de douze souscripteurs par an à partir du printemps 1821. Cependant, un locataire, Alexandre Massol, Instituteur, occupait la maison. Le bail, dont le loyer annuel était de 600francs, avait été signé le 27 juillet 1817 avec un précédant propriétaire, Jean-Baptiste Marius Ollive, imprimeur très connu à Marseille. Renouvelé, le bail courait toujours en octobre 1820. Par convention du 13 octobre 1820, Alexandre Massol s’obligea à quitter les lieux le 16 octobre 1820, en contrepartie l’Œuvre versa à titre d’indemnité la somme de 1000 francs.
Le 20 novembre 1820 l’Œuvre s’installe enfin au numéro 20 de la rue Saint-Savournin qui deviendra le numéro 25 en 1850 puis le 41. Jean-Joseph Allemand a maintenant 48 ans.
Le vendeur de cette bâtisse était Pierre Hugues Victor Merle Général et Baron d’Empire. Il avait acquis cette propriété le 14 janvier 1818 auprès de la famille Ollive. Dans l’acte de vente le Baron Merle est d’ailleurs domicilié chez cette famille au 8 de la rue Neuve de l’Amandier (actuelle rue Augustin Fabre) à Marseille. En réalité il réside à Lambesc. Nous ignorons quels étaient les liens exacts de Pierre Merle avec la famille Ollive. On constate qu’il a gardé cette propriété moins de trois ans. L’étude des actes de vente et des conventions montrent que Pierre Merle n’a jamais habité la maison acquise par l’Œuvre. Les motivations de l’achat de cette maison par la Baron nous sont inconnues.
Né le 26 juin 1766 à Montreuil sur Mer (Pas de Calais) d’une famille originaire du Languedoc, Pierre Merle rejoint en 1781 le régiment de Foix. En 1789 il est caporal de fusilier et lieutenant en 1792. En 1794 il est Général de Brigade! Le 2 octobre 1797 il épouse une jeune veuve marseillaise Françoise Madeleine Bérenguier. En 1798 le Général Merle est mis en état d’arrestation à la prison du Temple pour avoir refusé de faire fusiller des prisonniers vendéens. Il est acquitté par une commission militaire siégeant à Marseille. Écoutant ses amis, il se retire dans la propriété de Lambesc appartenant à la famille de son épouse. Remis en activité après le 18 Brumaire, il passe au commandement de l’armée d’occupation de Turin puis devient Gouverneur militaire de Braunau (Autriche). En 1805 il est nommé Général de Division après Austerlitz. Il se distingue durant la guerre d’Espagne au cours de laquelle il est grièvement blessé et le 19 mars 1809 il reçoit le titre de Baron avec armoiries. Il est alors titulaire de la Légion d’Honneur. Peu connu du grand public, Pierre Merle était l’une des figures de la Grande Armée, estimé pour sa grande bravoure et sa modestie. Il a participé à toutes les campagnes du Consulat et de l’Empire. L’Empereur le distingue à plusieurs reprises. Le Général Merle participe à la campagne de Russie. En 1814 il se rallie aux Bourbons. Après avoir été Inspecteur Général de la Gendarmerie, il accompagne en mai 1815 lors des Cent Jours, le Duc d’Angoulême dans le midi où il est chargé de la défense de Pont-Saint-Esprit qu’il doit cependant évacuer après le ralliement de sa troupe à l’Empereur. Malgré l’intervention du Maréchal Soult il connaît une disgrâce qui l’amènera à demander sa mise à la retraite en 1816 avec une pension annuelle de 6000 francs. Il est alors Grand Officier de la Légion d’Honneur et Chevalier de l’Ordre de l’Ordre Royal et Militaire de Saint-Louis. Le Baron Merle se retire dans sa propriété de Bois-Fontaines aux environ de Nîmes. Dans les jours troubles qui suivent la seconde Restauration dans le Midi, des activistes royalistes incendient sa maison. Il habite alors la propriété de famille de son épouse à Lambesc. Monsieur Mazel son biographe et descendant adoptif signale que le Baron demeure à Marseille en 1822 sans préciser l’adresse. En 1830, malade, il doit se rendre à Marseille où il meurt d’hydropisie le 5 décembre. Il repose depuis au cimetière Saint-Baudile à Nîmes. Le nom du Général Baron Merle est gravé sur la 35ecolonne, pilier ouest de l’Arc de Triomphe de l’Etoile.
Jean Magalon
Sources :
Archives et Documents Œuvre Jean-Joseph Allemand.
Brunello, Abbé Félix, Vie du serviteur de Dieu Jean-Joseph-Allemand, fondateur de l’Œuvre de la jeunesse (1772-1836), Paris, Sagnier et Bray ; Marseille , Chauffard, 1852.
Gaduel, Abbé Jean-Pierre-Laurent, Le Directeur de la jeunesse ou la vie et l’esprit du Serviteur de Dieu Jean-Joseph Allemand, prêtre du diocèse de Marseille…, Paris, Lyon, Jacques Lecoffre et cie, 1867.
Arnaud, Henry, La Vie étonnante de J.-Joseph Allemand Apôtre de la Jeunesse, Marseille, Sopic, 1966 (supplément au n°91 de Notre Écho).
Arnaud, Henry, 1789 L’Église de Marseille dans la tourmente, Marseille, Imprimerie Robert, 1988.
Bruschi, Christian, «L’Œuvre de la Jeunesse de Marseille . Un prêtre marseillais devant la jeunesse bourgeoise du xixe» dans Provence Historique, t. XXIX, fascicule 117, 3e trimestre 1979.
Mazel, Elie, Vie de Pierre-Hugues Victor Merle, Nîmes, A. Baldy, 1860.
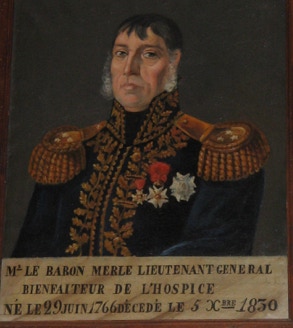
1820 dans le monde (ou presque)
Nous commémorerons fin novembre le deuxième centenaire de l’installation de l’Œuvre de Monsieur Allemand rue Saint-Savournin, dans la maison qui constitue le corps de bâtiment central de ses locaux actuels.
Nous savons bien ce qui s’est passé dans l’Œuvre cette année-là et les années qui ont suivi, mais le petit groupe d’Anciens qui s’occupe du Mémorial, installé au deuxième étage de l’extension réalisée dès 1840, a eu la curiosité d’élargir le champ de ces connaissances et de rattacher à la « Grande Histoire », celle, plus modeste, de l’Œuvre.
Jean Magalon, qui a déjà présenté (Notre Écho n° 626, voir l’article si-dessus) les conditions dans lesquelles la maison de l’Œuvre avait été acquise et le profil extraordinaire du vendeur, le baron Merle, interpelle à nouveau notre curiosité en nous invitant à découvrir ce qui se passait en ce temps-là dans le monde, disons en Europe, en France et en Provence, en trois volets, à raison d’un par mois.
Voici le premier :
Aperçu de l’Europe en 1820
En octobre 1820 l’Abbé Jean-Joseph Allemand installe son Œuvre rue Saint-Savournin à Marseille. Deux cents ans plus tard, nous vous proposons de présenter succinctement la situation de l’Europe en cette année-là.
L’Europe de 1820 est celle du nouvel ordre mis en place après la chute de l’Empire napoléonien. Il est issu du Congrès de Vienne tenu en 1815 par les monarchies conservatrices : Prusse, Autriche et Russie (puissances de la Sainte-Alliance) sans oublier le Royaume-Uni. La France est représentée par Talleyrand, ministre des Affaires Étrangères de Louis XVIII. En 1820 se tient un nouveau congrès à Troppau, capitale de la Silésie autrichienne, aujourd’hui en République Tchèque. À l’issue de ce congrès, la Prusse, l’Autriche et la Russie publient le 8 décembre 1820 un texte dans lequel elles affirment le droit et même le devoir des puissances garantes de la paix, d’intervenir pour réprimer tout mouvement révolutionnaire.
Depuis 1815, la nébuleuse des principautés allemandes se situe dans les frontières de la Confédération du Rhin (Allemagne/Autriche) acceptée par le Chancelier autrichien Mettermich pour satisfaire la Prusse. Le Chancelier se méfiait comme de la peste d’une éventuelle unité allemande. Cette Confédération fut rendue quasiment impuissante par les princes allemands jaloux de leur pouvoir. L’agitation nationaliste de la jeunesse universitaire (réunion de la Wartburg en 1817) fut réprimée par la Sainte-Alliance (1819/1820). Au début de 1820, les paysans touchés par la crise de l’agriculture allemande émigrent. Ils sont bientôt suivis par les artisans et les compagnons. Cette colonie de travailleurs constitue la première immigration de masse de la France issue de la Révolution. Cette émigration économique devient politique à la suite des mesures répressives prises par les gouvernements des différents états allemands et de l’Autriche où les prémices de l’éveil des nationalités commencent à fissurer l’Empire.
Soumise aux Bourbons de Naples, la Sicile connaît une révolution qui débute à Nola et qui oblige le Roi Ferdinand 1er à accorder une constitution libérale au Royaume de Naples le 13 juillet 1820.
En Espagne, après le départ du roi Joseph Bonaparte, le roi Ferdinand VII rentre de son exil marseillais laissant sa titulature au quartier du Roi d’Espagne. Le Bourbon restaure l’absolutisme et même l’Inquisition, entraînant la rébellion dite de Cadix qui débute le 12 janvier 1820. Des officiers refusent de partir pour les possessions espagnoles d’Amérique mater le mouvement bolivarien issu de l’aspiration à l’émancipation des colonies espagnoles d’Amérique. Cette expédition rencontrait une forte opposition de la Grande-Bretagne qui n’a jamais admis la politique interventionniste de la Sainte-Alliance. Ferdinand VII accepte de rétablir la Constitution de 1812.
Une révolution éclate également au Portugal à Porto, le 24 août 1820. Les rebelles exigent le retour du roi Jean IV réfugié au Brésil durant l’occupation par les armées françaises. Un pronunciamiento survient le 11 novembre 1820 qui aboutira à des élections pour une constituante.
En Russie le tsar Alexandre 1er expulse les Jésuites le 26 mars 1820. Devant l’agitation révolutionnaire, le tsar qui avait été un élément modérateur à Troppau doit faire face à une révolution militaire qui le fait revenir en 1820 à une pure autocratie et à rétablir une véritable censure. Censure qu’il rétablira également en Pologne après avoir assisté le 13 septembre 1820 à l’Assemblée du royaume de Pologne où s’exerce une forte influence libérale sous l’impulsion de l’intellectuel français Benjamin Constant.
En Grande-Bretagne, le 29 janvier 1820 marque le début du règne de Georges IV, également Roi de Hanovre. Le 23 février 1820, le complot de la rue Cato qui visait à assassiner tous les membres du gouvernement est déjoué. Comme nous venons de le voir, en raison de ses intérêts mondiaux, la Grande-Bretagne dirigée par Castlereagh prenait ses distances vis-à-vis des puissances de la Sainte-Alliance. L’année 1820 marque le sommet de la lutte entre le roi et son épouse Catherine de Brunswick, faussement accusée d’adultère. Cette lutte sur fond de graves problèmes sociaux entachera gravement le prestige de la monarchie.
Au Vatican le trône de Saint-Pierre est occupé par Barnaba Chiaramonti, moine bénédictin, sous le nom de Pie VII, élu en 1800 ; ses démêlés avec Napoléon sont bien connus. Au général Radet qui lui demandait de renoncer à ses pouvoirs temporels il fit une réponse passée à la postérité « Non possiamo, non dobbiamo, non vogliamo » (« Nous ne le pouvons pas, Nous ne le devons pas, Nous ne le voulons pas »). Emmené à Paris, il participa au sacre de Napoléon avec qui il avait signé le Concordat en 1801. De 1819 à 1822 il devint l’interlocuteur des principaux monarques européens.
Dans le domaine des sciences et de l’industrie on voit apparaître les prémices de la révolution industrielle. Hans Christian Oersted montre le lien entre magnétisme et l’électricité qui crée un champ magnétique. Faraday construit les premiers moteurs électriques. En Grande-Bretagne, James Fox met au point une raboteuse électrique, donnant naissance à la première machine-outil. Henri Fitton invente le thaumatrope (prodige qui tourne) créant la première image animée par illusion d’optique.
Le grand foyer intellectuel de l’époque est l’Université de Berlin où enseignent Arthur Schopenhauer et Friedrich Hegel. Le premier vient de publier Le monde comme volonté et représentation, Hegel publie en 1820 Les principes de la philosophie du droit. Le hollandais Multatuli publie son ouvrage L’exploitation néerlandaise des Indes, première critique du colonialisme économique.
Le romantisme domine une grande partie du monde littéraire et pictural en France en Allemagne et en Angleterre. En 1820, Walter Scott publie deux contes d’origine bénédictine Le Monastère et L’Abbé. Le peintre anglais John Constable (Le Moulin de Dedham) est un pur romantique précurseur de l’impressionnisme. Caspard Friedricih est considéré comme le peintre allemand le plus important de la première moitié du xixe siècle. Ses paysages (Le port de Greifswald) sont des œuvres purement romantiques.
En Italie l’écrivain Alessandro Manzoni publie des poésies (Inni Sacra) et sa tragédie Adelchi. L’auteur russe Alexandre Pouchkine édite son poème épique Rousian et Ludmilla.
L.-V. Beethoven est au cœur de la composition de sa grande œuvre religieuse Missa Solemnis. En 1820 il publie sa sonate pour piano n° 20.
L’année 1820 montre en Europe une forte poussée des aspirations nationales et libérales réprimées par les grandes puissances. Bientôt cette politique d’intervention va se détériorer. L’éveil des nationalités rendra insupportable les ingérences extérieures. Nous verrons d’ailleurs que le retour des Bourbons et des émigrés sur le territoire national sera vécu par la population française comme une ingérence étrangère.
Jean Magalon
La France de 1820
Nous commémorerons fin novembre le deuxième centenaire de l’installation de l’Œuvre de Monsieur Allemand rue Saint-Savournin, dans la maison qui constitue le corps de bâtiment central de ses locaux actuels.
Nous savons bien ce qui s’est passé dans l’Œuvre cette année-là et les années qui ont suivi, mais le petit groupe d’Anciens qui s’occupe du Mémorial, installé au deuxième étage de l’extension réalisée dès 1840, a eu la curiosité d’élargir le champ de ces connaissances et de rattacher à la « Grande Histoire », celle, plus modeste, de l’Œuvre.
Jean Magalon nous invite à découvrir ce qui se passait en ce temps-là dans le monde, disons en Europe, en France et en Provence.
Aperçu de la France en 1820
En octobre 1820 l’Abbé Allemand installe son Œuvre au 20 de la rue Saint-Savournin à Marseille.
Dans la France de 1820 règne Louis XVIII, Elie Decazes est Président du Conseil. Ils gouvernent en application de la Charte octroyée le 4 juin 1814. Sans être entièrement légitimiste (favorable aux Bourbons), le pays apprécie la paix retrouvée. Le régime est bicamériste avec une Chambre des Députés et une Chambre des Pairs. La charte de 1814 est d’inspiration libérale et proclame l’égalité civile de tous devant la loi, la justice, l’impôt et les emplois publics. Elle garantit les libertés individuelles, la liberté de la presse, et de culte, bien que le catholicisme soit proclamé religion d’État. Toutes les propriétés sont déclarées inviolables y compris les biens nationaux. La personne du roi est « sacrée », il est le chef suprême de l’État, ses pouvoirs sont très étendus, ce qui pondère largement l’aspect libéral de la Charte. Cependant l’esprit libéral domine. Decazes déclare : « Il faut nationaliser la royauté et royaliser la nation ». Un tragique événement va tout changer.
Dans la nuit du 13 au 14 février 1820, le neveu du roi, fils du futur Charles X et héritier du trône, le duc de Berry, est assassiné par un nommé Louvel qui souhaitait éteindre la « race des Bourbons ». Il n’atteint pas son but car la duchesse de Berry est enceinte du futur duc de Bordeaux qui sera très brièvement roi sous le nom de Henri V (l’enfant du miracle). Le retentissement dans le pays est important. Les ultraroyalistes demandent le départ immédiat de Decazes jugé responsable du crime par ses tendances démocratiques. François-René de Chateaubriand a pu écrire : « Les criminels sont ceux qui ont établi les lois démocratiques, qui ont banni la religion de ces lois, ceux qui ont cru devoir rappeler les meurtriers de Louis XVI, ceux qui ont laissé prêcher dans les journaux la souveraineté, l’insurrection et le meurtre ». Decazes refuse de démissionner ; soutenu par le roi, il maintient la loi électorale qui devait être déposée devant les chambres le 14 février. Le 20, jugeant sa position intenable il démissionne. Un ultra, le duc de Richelieu est chargé de former un gouvernement sous l’influence de Chateaubriand. Des lois d’exception sont votées (presse, liberté individuelle).
D’une manière générale, le sentiment monarchique est sur le déclin. Les Français ont mal vécu le retour des Bourbons et des émigrés dans les fourgons des armées étrangères. Le prince autrichien Schwarzenberg a ainsi déclaré, faisant allusion au trône du roi : « On peut tout faire avec les baïonnettes sauf s’asseoir dessus ». Alarmé par le retour offensif d’une caste de privilégiés dont il avait cru se débarrasser, le peuple français a bientôt commencé à réagir avec une vigueur croissante. Les premiers francs-tireurs apparaissent au sein de l’armée reprise en main par les aristocrates. Des complots se forment (Les Sergents de La Rochelle). La Charbonnerie est la plus organisée et la plus virulente des organisations secrètes. Plusieurs émeutes jalonnent l’année 1820. Le durcissement du régime (censure, loi électorale) provoque des troubles sérieux ; le 3 juin, un étudiant est tué, plusieurs villes s’enflamment. Le 19 août une conspiration des oppositions unies est déjouée (six condamnations à mort). Le chef de file de l’opposition libérale connue sous le nom des « Indépendants » est Benjamin Constant. Élu député en 1819, il est l’un des orateurs les plus en vue et défend le régime parlementaire. Le 7 octobre 1820, il est violemment agressé à Saumur par des élèves de l’école de cavalerie en majorité royalistes. Le pouvoir est isolé et La Fayette souligne en 1820 la solitude de la France restaurée au milieu de la France nouvelle. Dès l’année 1820, marquée par le début du retour de l’absolutisme, la nécessité du retour de la république est théorisée par les historiens libéraux comme l’aixois François-Auguste Mignet.
Les Français sont choqués par la volonté manifestée par l’Église de retrouver ses prérogatives. Elle n’a pu obtenir le monopole de l’école, faute d’enseignants assez nombreux et formés. Une ordonnance de 1814 lui donne le droit d’ouvrir seulement une école par diocèse. L’Église de France compte environ 35 200 prêtres dont 2 840 curés. Pour l’épiscopat il manque environ 3 000 prêtres. De 1820 à 1822 le nombre de diocèses passe de 50 à 80. Mais la France commence une lente déchristianisation. Avec son Génie du Christianisme publié en 1802, Chateaubriand alors en exil n’a vraiment convaincu que la noblesse. Des régions entières (sud-ouest, régions agricoles d’Île de France) sont en déshérence religieuse. La bourgeoisie est très résistante à la ré-évangélisation. La quasi-totalité de la jeunesse qui fait des études est alors hostile à la religion traditionnelle. Un rapport de Lacordaire sur les collèges royaux est accablant. Moins de 7 % des élèves des classes supérieures s’approchent des sacrements une fois par an et moins de 1 % sont pratiquants. À Saint-Cyr les jeunes gens qui communient en uniforme sont provoqués en duel par leurs camarades. Les sacrilèges sont fréquents (blasphèmes, saccages d’hosties). On comprend pleinement la décision de Jean-Joseph Allemand de désigner la jeunesse bourgeoise comme objectif principal de son Œuvre. La France ne connaîtra un renouveau religieux qu’à partir de 1850. Cependant, les principaux ordres religieux se réinstallent en France et certains ouvrent de nouvelles maisons. 1820 est une année de Mission intérieure. Les principales étapes en sont : prédications, retraites, grandes cérémonies, campagnes moralisatrices, érection de croix dont certaines sont encore visibles avec l’inscription « Mission 1820 » gravée sur leur socle. Le pouvoir comme l’opposition d’ailleurs ne voit pas d’un bon œil ces événements susceptibles de diviser encore plus la population.
Dans ces années 1820 le niveau de vie des Français s’élève bien que l’analphabétisme subsiste et que l’enrichissement ne profite qu’à une partie de la population. La tranquillité revenue après les guerres de l’Empire fait qu’en 1820 la France compte plus de 30 millions d’habitants. La France est un pays rural. En 1820 le rapporteur du budget à la chambre des Pairs indique que les revenus agricoles s’élèvent au triple des autres. La production de blé a augmenté plus vite que le nombre d’habitants. La ration quotidienne des classes les plus pauvres semble donc assurée. Les industries métallurgiques ont progressé mais la production reste désuète et faible. Dans le Nord l’extraction de la houille est une réussite. En 1820, l’industrie la plus florissante est celle du textile (laine et soieries). La banque s’est consolidée et inspire une grande confiance aux commerçants, mais elle a peu de capacité de financement et peu de souplesse d’organisation. Le capitalisme est embryonnaire mais l’idée de financer l’industrie s’installe. Le 6 mai 1820, Joseph Lainé, député de la Gironde déclare devant la chambre : « les intérêts économiques sont devenus prépondérant ». La fin de 1819 et le début de 1820 voient l’invention de l’acide acétique et de la chaux hydraulique. La première usine à gaz est construite dans la région parisienne. Toujours en 1820 Ampère travaille de plus en plus sur l’électromagnétisme.
L’hygiène générale, malgré l’exemple anglais est toujours peu développée. La médecine progresse cependant, Pierre Pelletier et Joseph Caventou découvrent le principe actif de l’écorce de quinquina (quinine) en 1820. La même année, Louis XVIII crée l’Académie de médecine, elle devra conseiller le gouvernement sur toutes les questions de santé publique.
La deuxième restauration qui suit la bataille de Waterloo en 1815 a été le théâtre de troubles importants visant les anciens fonctionnaires et militaires de l’Empire ainsi que les républicains (saccage de la propriété du Baron Merle à Nîmes qui vendit à Monsieur Allemand la maison de la rue Saint-Savournin). Dans le midi, les ultraroyalistes se livrent à un véritable massacre. Le 25 février 1820, quelques jours après l’assassinat du duc de Berry, François Vidocq, ancien bagnard, est nommé chef de la Sûreté. Grâce à un réseau d’indicateurs, il obtient rapidement des résultats comme l’arrestation d’une bande de « chauffeurs » dans le Nord.
Le romantisme domine le monde artistique, surtout la littérature. Chateaubriand en a été le précurseur. En 1819, l’exposition du « Radeau de la Méduse » de Géricault est le signal de l’assaut romantique. Mais le véritable choc a été la publication en 1820 des Méditations poétiques d’Alphonse de Lamartine. Bientôt les différents aspects de la vie artistique seront « contaminés » selon le mot du critique Sainte-Beuve. Pour certains critiques le romantisme n’est pas seulement un mouvement artistique, c’est aussi l’autre aspect de la révolte de la nation. C’est l’une des composantes du monde à venir.
Nous verrons que si Marseille se dit toujours légitimiste, une partie de sa jeunesse partage les aspirations de ce monde nouveau.
Jean Magalon
Regards sur la Provence et Marseille en 1820
Nous commémorerons fin novembre le deuxième centenaire de l’installation de l’Œuvre de Monsieur Allemand rue Saint-Savournin, dans la maison qui constitue le corps de bâtiment central de ses locaux actuels.
Nous savons bien ce qui s’est passé dans l’Œuvre cette année-là et les années qui ont suivi, mais le petit groupe d’Anciens qui s’occupe du Mémorial, installé au deuxième étage de l’extension réalisée dès 1840, a eu la curiosité d’élargir le champ de ces connaissances et de rattacher à la « Grande Histoire », celle, plus modeste, de l’Œuvre.
Jean Magalon nous invite à découvrir ce qui se passait en ce temps-là dans le monde, disons en Europe, en France et en Provence.
Dans ce dernier article nous comprenons que la mission de Monsieur Allemand s’est réalisée dans un contexte qui lui a demandé beaucoup de courage et de ténacité, l’ambiance de l’époque n’étant pas propice au genre d’Œuvre qu’il réalisait…
Le lundi 20 novembre 1820 l’Abbé Jean-Joseph Allemand installe son Œuvre et son logement au 20 de la rue Saint-Savournin, quartier de la Croix de Régnier à Marseille. Il y hébergera bientôt sa mère, Catherine Chaillan veuve Allemand, qui s’éteindra en 1826 dans les locaux de l’Œuvre.
Dans les premières années qui ont suivi la Restauration, Marseille qui compte environ 110 000 habitants est et se proclame légitimiste (partisane des Bourbons). Un peu par conviction mais surtout par particularisme, par opportunisme diront certains. L’agglomération est un port et une ville de commerce tant intérieur qu’extérieur. Elle apprécie l’ordre et la paix. Les violents troubles anti-bonapartistes que se déroulent après Waterloo montrent l’attachement de la majorité des Marseillais à la monarchie légitime. Les troupes impériales françaises se considèrent en terre ennemie. L’occupation des troupes autrichiennes, anglaises et anglo-siciliennes sous le commandement de sir Hudson Lowe (futur geôlier de Napoléon) se prolonge jusqu’en 1816 et de lourdes charges pèsent sur les notables. Il n’y aura pas d’incident sérieux durant cette présence militaire.
Cette occupation a quand même permis à la nouvelle administration de se mettre en place. Marseille a eu la chance de bénéficier de la sagesse de deux hauts fonctionnaires : Le marquis de Mongrand comme Maire (alors nommé) et le comte de Villeneuve-Bargemon comme Préfet des Bouches-du-Rhône. Issu d’une ancienne famille marseillaise, Jean-Baptiste de Montgrand, quoique légitimiste, déplace peu de subordonnés et évite les sanctions inutiles. Il résiste aux ultras et refuse de procéder à une épuration radicale. Il sera Maire de 1814 à 1830 avec une éclipse durant les Cent-Jours. Christophe de Villeneuve-Bargemon est Préfet des Bouches-du-Rhône depuis 1815, il le restera jusqu’à sa mort en 1829. Il appartient à une vieille famille provençale. Comme le Maire, il évite de prendre des mesures répressives et de procéder à des nombreux limogeages dans l’administration. Bien que légitimistes et catholiques, le Maire et le Préfet adoptent une attitude intelligente et modérée envers l’opposition libérale et les religions tant réformée que juive.
De Villeneuve est très impliqué dans la vie intellectuelle et industrielle. Il assure la mise en place en 1818 d’une École de Médecine. Il encourage les cours de chimie et de physique créés en 1820 par la municipalité. Mais son nom reste lié à l’exceptionnelle enquête qu’il dirigea sur l’ensemble des Bouches-du-Rhône. Elle est une source inépuisable de renseignements sociaux, économiques, géographiques mais elle est aussi le premier document « d’aménagement du territoire » de ce pays. Elle est connue sous le nom de « Statistique départementale des Bouches-du-Rhône ». Grace à ces deux administrateurs, Marseille retrouve dès 1815 une vie quasiment normale.
Une opposition libérale existe à Marseille dès les années 1818-1820. C’est la moyenne bourgeoisie qui alimente cette opposition. Elle est soutenue par la présence temporaire de réfugiés politiques italiens et espagnols. Cette opposition se dote d’une presse libérale. On peut citer : Le Messager de Marseille et Le Sémaphore. On signale même dans le port phocéen en 1821 « des ventes » (sociétés secrètes) carbonaristes. Une affaire célèbre a révélé au grand jour cette société secrète et marqué les Marseillais et les Provençaux. Demi-solde, vétéran des guerres républicaines et napoléoniennes, Armand Vallé débarque en 1821 à Marseille avec l’intention de rejoindre la Grèce pour participer à l’insurrection contre l’Empire ottoman. Il loge au 62 rue Sainte et entre en contact avec des Italiens qui ont ouvert une « vente » dans le même immeuble. Des militants du Parti libéral révolutionnaire (Confrérie des bons cousins charbonniers) le recrutent. Il devient délégué pour le Var du mouvement dont le but est de renverser la monarchie. Interpellé avec sept camarades, il est condamné à mort et exécuté à Toulon. Dégradé et déchu de la Légion d’honneur juste avant, il refuse de rendre sa médaille remise par l’Empereur et l’avale (!).
En 1814 (chute de l’Empire) à la demande des négociants marseillais, le Comte d’Artois avait rétabli la « franchise ». Ce retour ne satisfait pas nécessairement les paysans locaux et les jeunes entreprises qui se sont développées à l’abri du protectionnisme. En 1817, le gouvernement abolit la « franchise » et y substitue le principe de « l’admission temporaire ». Cette abolition entraîna toutes sortes de trafics dont le plus connu est la contrebande du tabac par les contrebandiers d’Allauch. Cette activité rémunératrice qui s’organisa à partir de 1820 dura, selon la tradition, jusqu’à la Première Guerre mondiale. Dès 1815, Marseille retrouve une vie économique relativement active. En 1820 environ 5 000 navires entrent dans le port. Le commerce marseillais retrouve les voies des Amériques et de la Turquie. Par contre dans les Échelles du Levant et aux Antilles, Marseille a perdu sa place. L’examen des documents douaniers montre une augmentation des échanges à partir de 1820. Jusqu’en 1821 les armateurs achètent du blé à la Moldavie et à la Russie. La distribution de la morue de Terre-Neuve reprend avec la Corse et l’Italie. Dans le midi, la consommation de morue est en nette baisse car l’huile est devenue trop chère suite au gel des oliviers en 1820. Il faudra attendre 1825 pour voir les bateaux du monde entier revenir à Marseille. Depuis 1818 le port bénéficie d’un service régulier avec Naples, Gênes et Livourne avec, notamment, un des premiers bateaux à vapeur, le Fernandino 1er, qui se joue des vents contraires, affrété par la Compagnie Pierre Andriel.
Les maisons qui tiennent le haut du pavé à Marseille durant la Restauration sont nombreuses : Fraissinet, Roux frères (armateurs), puis naissent les maisons comme Bergasse (vins et armement), Rocca (huileries, savonneries), une des principales maisons de Marseille, Pastré, Augustin Fabre (armateurs), les Imer, famille protestante d’origine suisse (industrie textile puis pétrolière), Straforello ou encore Jean-Louis Betfort devenu le plus important négociant en grains de Marseille. À son décès, en 1820, il laisse à son fils une fortune considérable. Il faut dire qu’en 1818 les importations de blé dépassent les 100 000 tonnes. Le port retrouve une activité commerciale pleine de vigueur. La famille Pastré joue un rôle essentiel dans cet essor. Dans les années 1820, ils créent des comptoirs en Égypte ; Jean-Baptiste et Jules acheminent vers Marseille des centaines de tonnes de coton qui seront livrées en partie à la filature que les frères Pastré exploitent à Aix-en-Provence. Les frères Pastré financeront l’étude de faisabilité de Ferdinand de Lesseps pour le Canal de Suez.
La diaspora grecque conquiert une place éminente dans l’économie et l’industrie marseillaise ; en 1820-21 naissent ou se développent les maisons : Ralli, Schilizzi, Passachachi puis les Rodocanachi (orthodoxes) qui mettent sur pied leurs activités de transport et de commerce (blé) et qui seront la première famille grecque a entrer dans la Chambre de commerce. Ils y rejoignent les Reggio (catholiques) d’abord armateurs puis industriels dans les huiles, ainsi que les Rostand, qui sont originaires d’Orgon et créent en 1746 une véritable dynastie. Bruno Rostand développe un commerce de draps. En 1820-21 Une maison de négoce avec le Levant est créée. On retrouvera cette famille dans le commerce, l’économie et la politique.
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Marseille est une vénérable institution créée en 1599. Elle est la Chambre de commerce la plus ancienne du monde. En 1820 elle était encore installée dans la Loge (rez-de-chaussée) de L’Hôtel de Ville. C’est ce qui explique que tous les matins, vers huit heures, une bourse secondaire se tenait devant et dans le café Casati, Place Royale (actuellement Place du Général de Gaulle). Au sortir du blocus, Marseille a un retard important dans le domaine technique et dans le secteur industriel, plus particulièrement dans le domaine de la construction navale. À titre anecdotique, on peut souligner un phénomène qui commence dans les années 1820 et qui perdurera jusqu’à la Première Guerre mondiale, je veux parler de l’endogamie quasi systématique qui unira les grandes dynasties industrielles marseillaises.
Il y a, bien sûr, des activités économiques et commerciales plus modestes. Il y a les gens de la mer : pêcheurs, calfats, portefaix ; le poisson est vendu par les épouses des pêcheurs sur le port, à la criée ou aux Halles Charles Delacroix (ancien Préfet). De nombreux artisans occupent encore la vieille ville : boulangers, quelques boucheries. Il y a aussi les artisans serruriers, chapeliers, cordonniers, charpentiers… Beaucoup sont compagnons (ouvriers très qualifiés). En 1820, il y a environ 60 savonneries à Marseille. À partir de cette année, de nouvelles matières grasses sont importées et transitent par le port de Marseille (huiles de palme, d’arachide, de coco…). Le travail des ouvriers est très dur dans ces établissements dans lesquels les maladies pulmonaires se multiplient. La plus importante des savonneries et la plus connue est Arnavon fondée par Honoré Arnavon sous l’Empire. Citons la savonnerie Lombardon qui reçut en 1814 la visite du Duc d’Angoulême et dont le directeur, Sauveur Lombardon, vendit en 1806 le local de la rue du Laurier à l’Abbé Baron où Monsieur Allemand installa son Œuvre à deux reprises. Les cafés et les cercles sont très fréquentés, ils jouent un rôle important dans le Marseille de la Restauration. On y discute affaires, politique, on y lit les journaux et on joue au billard. On peut citer le Cercle du Commerce, le Cercle des Phocéens, le Cercle des Provençaux… Les cafés proprement dits sont fréquentés par une bourgeoisie moins fortunée et plus commune. La jeunesse bourgeoise et libérale peut se retrouver au Café Américain (rue Suffren) et y manifester son hostilité au Régime. La bourgeoisie la plus aisée commence à émigrer vers le sud de la ville dans des quartiers plus calmes et mieux construits. Les classes plus populaires restent groupées dans un grand périmètre autour de l’Hôtel de Ville. C’est là où l’on trouve des débits de boissons beaucoup plus modestes dont la clientèle est essentiellement composée d’ouvriers et de marins. De grosses quantités d’argent y changent de main dans des jeux souvent illégaux. La prostitution prospère en ces lieux. Le Maire de Mongrand s’inquiète de ces dérives. Les armateurs français et étrangers redoutent le séjour de leurs marins à Marseille qui y dépensent beaucoup d’argent. Les frères Roux reçoivent dès 1820 des dizaines de courriers leur demandant d’activer le départ des navires. Mais il y a heureusement des établissements de quartier où l’on peut faire de tranquilles parties de cartes. C’est un des plaisirs des Marseillais modestes.
Cette population a des plaisirs simples, comme l’écrit en novembre 1820 le journaliste Joseph Mery : « Les habitants des quartiers populeux ne savent point varier à Marseille leur plaisirs », « une partie en mer, un dîner au bord de l’eau ». Les théâtres comme le Grand Théâtre, le Théâtre de la Comédie, le Théâtre Français, les Salles Turc et Thubanneau (spectacle, bal, concert) tiennent une grande place dans la vie quotidienne. Aller au théâtre, c’est à la fois un plaisir et un défoulement. C’est l’un des rares lieux où les classes sociales se mélangent un peu. Le théâtre amateur connaît aussi un grand développement. Précisons que la Pastorale Maurel ne sera créée qu’en 1848. Les jeunes vont également danser à « Andoume », endroit fréquenté également par les proxénètes en mal de recrutement. À la limite de la médecine et de la distraction, il y a à Marseille en 1820 la création des premiers « bains de mer médicaux » en France. Le corps médical marseillais a joué un rôle essentiel dans le développement de cette activité. Le premier établissement installé en 1818 dans l’anse du Pharo est dû à l’initiative du Docteur Giraudy. Pour diverses raisons, l’expérience a dû être abandonnée et c’est en 1820, au vu des conclusions de l’enquête demandée par le Préfet de Villeneuve à la Société Royale de Médecine de Marseille, que commencent vraiment sur la plage d’Arenc ce que l’on nomme alors : « Balnéation et hydrothérapie marine ».
La reprise économique favorise la création d’emplois et donc une certaine élévation du niveau de vie. La nourriture gagne en quantité et en qualité. Mais, dans les vieux quartiers, les logements insalubres et le manque d’hygiène sont causes de maladies et d’épidémies. La consommation d’une eau douteuse favorise la typhoïde et le choléra. Il y a aussi de nombreux cas dans toute la ville de petite vérole et de variole. Mais la cause principale des décès à Marseille est la tuberculose. L’Hôtel-Dieu est le phare du système de santé à Marseille avec environ 4 000 entrées par an. L’Hôpital de la Charité pratique une médecine moins pointue mais recueille les enfants trouvés et les vieillards indigents. Il existe nombre d’autres établissements publics et privés. En 1820 est créé l’Institut pour les sourds et muets. L’hiver 1820 est particulièrement rigoureux, les oliviers et autres cultures gèlent. Des entreprises ferment au moins momentanément. La mendicité et l’insécurité augmentent, la mortalité aussi. 55 % des décès concernent des enfants de moins de 10 ans.
Il y a bien sûr à Marseille une immigration ; elle est encore limitée dans les années 1820. La colonie italienne est encore peu nombreuse, environ 5 000 personnes. Ce sont souvent des travailleurs qui acceptent des conditions de travail très rude comme dans les savonneries. Beaucoup de femmes font des ménages et sont employées comme cuisinières dans des familles relativement modestes. Les Grecs sont encore moins nombreux, environ 500. Certains ont trouvé des emplois liés à la mer. On a vu que plusieurs familles sont rapidement devenues des industriels et des commerçants importants. On ne sait si ces familles étaient incluses dans la statistique précédente. En 1817 ils inaugurent l’Église grecque catholique construite avec l’appui de Louis XVIII rue du Marbre (rue Edmond Rostand). Avec la bienveillance du Préfet, la première Église grecque orthodoxe s’installe « clandestinement » rue Saint-Savournin car le rite orthodoxe n’est pas concordataire. En 1821, le soulèvement contre l’Empire Ottoman accélérera l’émigration grecque. La colonie grecque active et influente facilite l’acheminement des hommes et des convois mais la Chambre de Commerce les freine car ils gênent le commerce du Levant… Dès 1820 affluent à Marseille des volontaires de toutes nationalités (notamment des Allemands) auxquels viennent s’agréger des demi-soldes français (voir plus haut l’affaire A. Vallé). Le Préfet de Villeneuve s’en inquiète. Une immigration moins connue est l’immigration suisse. C’est la deuxième immigration après celle des Italiens. Tous sont à la recherche d’emplois. Ils sont des domestiques (environ 300 en 1820) très appréciés dans les grandes maisons. Ils sont également employés dans l’hôtellerie, la banque et le négoce et bien sûr l’horlogerie. Le Préfet de Villeneuve ne tarit pas d’éloges sur leur comportement. Les Suisses sont protestants et construiront en 1825 le Temple de la rue Grignan. Aix et Marseille garderont longtemps leur souvenir grâce aux grandes maisons de confiseries Castelmuro, Linder et Semadini. C’est en 1820 que s’installe tout en haut de la Canebière la pâtisserie Plauchut qui subsiste de nos jours.
En 1820, l’Église de Marseille n’a pas retrouvé son évêque. Le siège épiscopal reste inoccupé en raison d’une discorde entre le Roi et le Pape. Monsieur Allemand est donc toujours rattaché à l’Archidiocèse d’Aix-en-Provence à la tête duquel se trouve Monseigneur Pierre-Ferdinand de Beausset-Roquefort. Disons-le tout net, le diocèse de Marseille est en pleine foire d’empoigne si l’on peut s’exprimer ainsi. Les deux vicaires généraux se livrent pour la nomination épiscopale une guerre qui pour être sournoise n’en est pas moins virulente. Le Petit Séminaire est lui en conflit avec l’Université royale. Même le Préfet de Villeneuve-Bargemon s’émeut de l’anarchie du diocèse. Monsieur Allemand reste à l’écart de ces querelles et se consacre à « l’édification de ses muscadins » et à ses visites au Bon Pasteur. Dans un but d’union spirituelle, surtout poussé par les curés de son grand diocèse ainsi que par les Missionnaires de France et ceux de Provence, Monseigneur de Beausset décide qu’une Mission sera prêchée dans le diocèse d’Aix et celui de Marseille pour réhabiliter la France « veuve de son Dieu et de son Droit ».
La Mission de 1820 eut un grand retentissement à Marseille et en Provence. La rivalité entre les Missionnaires de France de l’abbé de Forbin-Janson et ceux de Provence fondés par Eugène de Mazenod ternit un peu les célébrations qui se déroulaient dans les paroisses. Les Missionnaires de Provence avaient le grand avantage de prêcher en provençal le plus souvent. Quelle fut la participation de l’Œuvre Allemand ? L’Abbé Gaduel (biographe de Monsieur Allemand) relate que le Fondateur avait pour principe d’engager les jeunes congréganistes (ainsi appelait on les membres de l’Œuvre) à ne point se partager entre l’Œuvre et d’autres activités religieuses. Il dérogea à ce principe pour la « célèbre Mission » de 1820 qui dura de janvier à février, mais il voulut que les jeunes gens qui assistaient aux processions et autres célébrations soient sans signe distinctif. L’Œuvre fut quasiment désertée. L’abbé Allemand prêcha lui-même la Mission à l’Œuvre en soulignant l’estime qu’il portait aux missionnaires. Il expliquait aux congréganistes que la Mission était une grâce de premier ordre et rare pour Marseille et que les membres de l’Œuvre avaient cette grâce perpétuelle car l’Œuvre était une Mission perpétuelle. Nous évoquerons seulement les célébrations les plus marquantes parmi plusieurs dizaines. La procession inaugurale a lieu le 3 janvier à partir de l’église Majeure de Saint-Martin. Menée par Monseigneur de Beausset, elle traverse toute la ville, suivie par plusieurs milliers de personnes. Plusieurs retraites ont été prêchées, celles pour les hommes et celles pour les femmes. L’une des plus marquantes a été celle prêchée en l’église Saint-Martin consacrée au « Panégyrique de Jésus-Christ » puis à la Passion ; enfin, sans doute pour égayer un peu cette solennité, l’abbé de Forbin-Janson discourut deux heures durant de « La mort inéluctable » (!). Il y eut également une réunion de toutes les congrégations de Pénitents. Le Précis historique de la Mission à Marseille indique que le dimanche 9 janvier l’abbé de Forbin-Janson célébra la messe de l’Épiphanie dans « l’église » de la congrégation de l’abbé Allemand (sans doute Place de Lenche) ; à l’issue de cette célébration, l’abbé de Forbin offrit à Monsieur Allemand un chapelet en bois d’un olivier du Jardin des Oliviers, rapporté de son voyage à Jérusalem, et avec lequel le Fondateur fut inhumé. Il fut retrouvé lors de l’exhumation de Monsieur Allemand en 1868 et il est très probable que ce soit le chapelet actuellement présenté au Musée de Monsieur Allemand. La plus grande procession eut lieu le 2 février jusqu’à Notre-Dame de la Garde. La statue de Marie était portée par la congrégation des portefaix. Sur la colline de la Garde, l’abbé de Forbin-Janson prononça une grande homélie sur le retour à la foi et le pardon des offenses. Dans sa péroraison il évoqua la messe célébrée en 1794 dans une grotte du Rove, par l’abbé Reimonet, assisté de Jean-Joseph Allemand. Le 27 février eut lieu, après une gigantesque procession à travers toute la ville, la « Plantation » de la Croix de Mission sur le parvis de Notre-Dame des Accoules. L’Œuvre Jean-Joseph Allemand assista au complet à la procession. C’était la fin de la Mission. Selon l’abbé Gaduel, le Directeur de l’Œuvre acheta sur ses deniers plusieurs centaines de petites croix souvenirs de la Mission qu’il distribua à chaque congréganiste.
Le siège épiscopal est enfin occupé en 1823 par Monseigneur Fortuné de , ancien vicaire général d’Aix. Il sera toujours attentif à l’action de Monsieur Allemand ainsi que son neveu Eugène de Mazenod qui lui succédera et qui restera proche de l’Œuvre.
Si la Mission de 1820 provoque un certain retour à la pratique religieuse, le nombre de baptême n’augmente pas. La foi populaire, traditionnelle, est surtout attachée aux manifestations extérieures de la religion. Le nombre élevé d’oratoires (chemin de Notre-Dame-de-la-Garde) et de chapelles privées datant de cette époque en témoigne. Ce retour à la religion ne touche pas toute la population marseillaise. Incontestablement, la Mission a exacerbé l’opposition libérale. Dès 1820 le journaliste Alphonse Rabbe fait entendre ses critiques dans Le Phocéen. En 1821 Le Caducée prend le relais. Comme dans les autres grandes villes du pays, la bourgeoisie s’est éloignée de la pratique religieuse, surtout les jeunes. Le vagabond, le mendiant n’est plus une personne à aider suivant les préceptes du Christ mais un individu menaçant la paix sociale. En 1823, un groupe de collégiens d’un établissement catholique, conduits à une procession, se moquent des cérémonies rituelles de manière burlesque, bousculent des religieux et foulent aux pieds des hosties. Il y a incontestablement dans une partie de la jeunesse bourgeoise marseillaise une haine militante qui entend s’opposer au retour des « anciennes superstitions ». Ces « profanations » se sont produites vers le haut de La Canebière et il n’est pas difficile d’imaginer les pensées de Monsieur Allemand sur ces actes perpétrés à quelques dizaines de mètres de « sa maison ». Quelle différence avec ses « congréganistes ! ».
En 1820, il n’y a encore que 11 églises pour desservir l’ensemble de la ville et le clergé est peu nombreux. La reconstruction de l’église Notre-Dame-du-Mont tombée en ruine débute en 1820. En 1821, le Préfet de Villeneuve avait approuvé la construction d’un sanctuaire dédié au Sacré-Cœur ; il dut y renoncer devant la forte opposition de la bourgeoisie libérale. Le rétablissement du Grand Séminaire est important mais son enseignement est médiocre. Les établissements des Frères des Écoles chrétiennes se multiplient mais la qualité des enseignants est très discutée. Vers 1820, seulement 35 % des jeunes gens du département savent lire et écrire.
En cette année 1820, obtenir de l’eau de qualité à Marseille et dans sa région est toujours un problème, surtout en été. Le projet d’amener l’eau de la Durance à Marseille a 90 ans en 1820 et est encore en discussion. En cette année, c’est l’ingénieur des ponts et chaussées Garella qui étudie le dossier. L’eau de la Durance arrivera à Marseille en octobre 1849 grâce à F.-M. de Montricher. Bien qu’ébauché sous l’Ancien Régime, le cimetière Saint-Charles ne commencera à sortir de terre, si l’on peut dire, qu’en 1820.
À la fin de l’année 1820 le souvenir de la Révolution et de l’Empire s’estompe à Marseille. Le haut commerce et la grande industrie s’installent durablement. De nombreux témoignages soulignent la prospérité retrouvée mais une certaine misère subsistera encore dans des quartiers insalubres à la forte mortalité infantile. La charité publique est exercée par l’Église ainsi que par certaines familles de grands industriels. La conquête de l’Algérie ouvrira en 1830 une ère de grande prospérité. Le Marquis de Montgrand peut écrire que « l’esprit public légitimiste du début de la Restauration est en train de changer ». Bientôt des députés libéraux seront élus.
Là-haut vers la Plaine, en ce mois de novembre 1820, dans la maison du quartier de la Croix de Régnier, Jean-Joseph Allemand peut enfin dire la messe dans la petite chapelle provisoire puis dans la grande chapelle de la maison, où il la célébrera jusqu’au Dimanche des Rameaux 1836.
Pense-t-il que son Œuvre est bien ancrée après 20 ans d’errance et qu’il peut défier quelques siècles ? Nous ne le saurons jamais. Mais ce que nous savons avec une certitude absolue c’est qu’il a « confiance en Dieu ».
Jean Magalon
Les Œuvres du passé
L’Œuvre de la Jeunesse Jean-Joseph Allemand n’a pas toujours consisté dans les deux maisons qui en 2022 la composent, celle de la rue St-Savournin et celle des Iris.
Depuis sa fondation, en 1799, puis son établissement en 1820 à la rue St-Savournin, elle a, souvent à la demande de l’évêque de Marseille, ouvert des maisons qui ont eu des durées de vie très différentes.
Entre 1820 et 1912, l’Œuvre a ainsi créé cinq maisons, quatre avant 1870, la dernière, celle des Iris, au début du xxe siècle. Les maisons qui avaient vu le jour au xixe siècle ont à ce jour toutes disparu.
Les Anciens qui s’intéressent à la mise à niveau du Mémorial de l’Œuvre ont entrepris, de concert avec elle, de rappeler le souvenir des « Œuvres du passé ». Ils procèdent à partir des informations que contiennent les archives de l’Œuvre, qu’ils complètent par des recherches dans les archives publiques, des contacts avec d’autres associations engagées dans un travail de mémoire, et par des déplacements « sur le terrain ».
Ils vous présenteront ainsi, successivement, les Œuvres de Cassis, de Roquevaire, de La Ciotat et celle du boulevard Tellène, à Marseille.
L’Œuvre de la Jeunesse à Cassis
L’Œuvre ouvrit à Cassis le 22 mars 1863 sur les instances du curé, le P. Désiré Paranque (1825-1899), qui était appuyé par le P. Pierre Vitagliano, vicaire général de Mgr Patrice Cruise, évêque de Marseille de 1861 à 1865.
Elle s’installa de façon provisoire dans un local qui appartenait à la paroisse. Il se composait d’une cour avec un petit bâtiment, d’un rez-de-chaussée et d’une seule autre pièce. Les offices religieux étaient célébrés dans la chapelle de l’hôpital. Deux des Messieurs, M. Olivieri et M. Billon, qui avaient la charge de l’Œuvre de Cassis, étaient initialement logés, l’un au presbytère, l’autre chez un habitant ; ils louèrent ensuite pour leur logement des chambres dans l’hôpital.
Les Messieurs achetèrent durant l’année 1863 plusieurs parcelles (donnant à l’ouest sur le chemin de communication de Marseille à Cassis), comprises aujourd’hui entre l’allée Paul Bérard et l’avenue Jules Ferry. Ce terrain, d’une superficie globale de 5478 m³ (1) jouxtait le local primitif. L’Œuvre fit édifier une bâtisse comprenant salles, chapelle et logement pour les Messieurs. Les matrices cadastrales montrent que les locaux étaient achevés en 1866 au plus tard.
De multiples jeux qu’accompagnaient les exercices religieux étaient alors proposés ; jeux de cour, tels que jeu de barres, échasses, boules, tambourin (lancer d’une balle à l’aide d’un tambourin), épervier, course-en-sac, etc, mais aussi jeux d’intérieur (charades, dames, échecs, rébus, etc).
L’Œuvre a fonctionné jusqu’à la guerre franco-prussienne de 1870. Le 4 septembre, elle ferma ses portes pour ne plus les rouvrir. On ignore les causes de cette fermeture ; la mobilisation des plus jeunes des Messieurs peut, au début, l’expliquer, de même que la désorganisation du pays liée à la chute de Napoléon III, puis à la défaite et enfin à la crainte que pouvait inspirer la Commune à Marseille, mais on ne connaît pas la raison déterminante. Peut-être les Messieurs, qui ne bénéficiaient plus de l’appui du même évêque, mais dont l’Institut avait été reconnu par Pie IX comme congrégation de droit pontifical le 24 février 1871, éprouvèrent-ils le besoin de se recentrer sur la maison de Marseille, comme en témoigne la fermeture à la même époque de l’Œuvre ouverte quelques années auparavant à Roquevaire. Peut-être aussi, et plus simplement, les familles cassidaines n’avaient-elles pas, en matière d’éducation, les mêmes attentes et les mêmes besoins que les familles qui confiaient leurs enfants à l’Œuvre, à Marseille. Le fait que l’abbé Paranque ait été nommé le 1er janvier 1871 curé de La Ciotat, où l’Œuvre était installée depuis 1863, peut en outre donner à penser que les Messieurs n’aient plus eu convenance à poursuivre des relations avec son successeur à Cassis.
Resté inoccupé pendant quelques années, le local de l’Œuvre fut présenté en 1877 à la commune de Cassis qui était à la recherche d’un local pour y installer la première école primaire de garçons (les lois Ferry sur l’école obligatoire s’annonçaient). Le Saint Siège donna l’autorisation de vendre le 12 mai 1877.  L’acte authentique fut signé seulement le 28 décembre 1880 ; il permet de connaître la consistance du bien vendu (2) : « une cour close avec portail, plantée de platanes donnant sur le Chemin de communication, un grand corps de bâtisse comprenant au devant un rez-de-chaussée avec porte et deux fenêtres et un étage formant mansarde pourvu d’une fenêtre et deux œils de bœuf, au centre un étage à cinq fenêtres sur rez-de-chaussée, au fond, deux préaux ; le tout est complété au nord par un terrain rocheux complanté d’amandiers où est situé un poulailler ». L’historien Pierre Guiral (3) a relevé qu’en 1880 les deux écoles communales étaient tenues, pour les garçons par les frères maristes et pour les filles par les Sœurs du Saint-Nom de Jésus. Il rapporte que la première classe de la nouvelle école avait été aménagée dans l’ancienne chapelle et que le bureau du maître était juché sur une estrade à trois marches… sans doute celles de l’ancien autel. Le dossier de classement de l’École Leriche (nom actuel de l’école) dans le PLU de Marseille Provence, mentionne que celle-ci a été construite dans les années 1920. Il s’est alors sans doute agi de l’extension de l’école qui avait été aménagée dans l’Œuvre de Cassis, puisque sont classés, sur la façade ouest, deux occuli à l’étage qui ne sont autres que les deux œils de bœuf mentionnés dans l’acte de vente de 1880.
L’acte authentique fut signé seulement le 28 décembre 1880 ; il permet de connaître la consistance du bien vendu (2) : « une cour close avec portail, plantée de platanes donnant sur le Chemin de communication, un grand corps de bâtisse comprenant au devant un rez-de-chaussée avec porte et deux fenêtres et un étage formant mansarde pourvu d’une fenêtre et deux œils de bœuf, au centre un étage à cinq fenêtres sur rez-de-chaussée, au fond, deux préaux ; le tout est complété au nord par un terrain rocheux complanté d’amandiers où est situé un poulailler ». L’historien Pierre Guiral (3) a relevé qu’en 1880 les deux écoles communales étaient tenues, pour les garçons par les frères maristes et pour les filles par les Sœurs du Saint-Nom de Jésus. Il rapporte que la première classe de la nouvelle école avait été aménagée dans l’ancienne chapelle et que le bureau du maître était juché sur une estrade à trois marches… sans doute celles de l’ancien autel. Le dossier de classement de l’École Leriche (nom actuel de l’école) dans le PLU de Marseille Provence, mentionne que celle-ci a été construite dans les années 1920. Il s’est alors sans doute agi de l’extension de l’école qui avait été aménagée dans l’Œuvre de Cassis, puisque sont classés, sur la façade ouest, deux occuli à l’étage qui ne sont autres que les deux œils de bœuf mentionnés dans l’acte de vente de 1880.
Toute information complémentaire sera bienvenue.
Association des Anciens, équipe du Mémorial, février 2022
- Cadastre section E, n° 122, 123, 124, et 125 le Vallon.
- Le local apparaît sur les matrices cadastrales au nom de la Commune de Cassis à partir de 1882.
- Pierre Guiral, Cassis hier et aujourd’hui, 1992.
Sources
- Pour les années antérieures à 1880 : Relation de Monsieur Delobre, de l’Institut Jean-Joseph Allemand.
- Acte de vente à la Commune de Cassis.
- Association Les Drailles de la Mémoire, Cassis.
- PLU Marseille-Provence. Classement Ecole Leriche. CAS – EE2 . n° E – 21
Mgr Patrice Cruice, qui fut évêque de Marseille de 1861 à 1865, tenait en estime ce qui se faisait à l’Œuvre Allemand. Un incident l’amena à demander à l’Œuvre d’ouvrir une maison à Roquevaire.
Un des Messieurs, M. Delobre, en donna quelques années plus tard la relation suivante : « Dans le courant de l’été 1862, Mgr Cruice eut à aller à Roquevaire pour confirmer. Parmi les enfants présentés, il s’en trouva un si dissipé que Mgr le mit à la porte au milieu même de la cérémonie. À la suite de cet incident, Mgr, se souvenant de la bonne tenue des enfants de notre Œuvre, eut la pensée et le désir qu’il s’en fondât une à Roquevaire, et il en parla à nos Messieurs. » La chronique se poursuit « On dut se mettre en mesure d’aller aux informations pour savoir si la chose était praticable. Messieurs Baudoin et Olivieri se rendirent à Roquevaire, accompagnés de l’abbé Vitagliano (Vicaire Général), et parlèrent au curé (l’abbé Jean Isnard, curé de Roquevaire de 1838 à 1877) . Ce curé, fort brave homme, mais âgé, avait ses habitudes et ne voyait pas la nécessité d’en sortir. Il donnait à sa paroisse les soins qu’il croyait convenables et était convaincu qu’il n’y avait pas lieu de faire davantage ni différemment. Il se montra donc dès le début tout à fait opposé à l’établissement projeté, donnant entre autres raisons « qu’à Roquevaire il n’y avait pas d’enfants » (sic). Nos Messieurs, devant ce parti pris, comprirent la difficulté de passer outre. » Ils craignaient que, dans cette ville alors ouvrière, peu importante, et dont le curé ne jugeait pas souhaitable l’implantation d’une Œuvre, le contexte ne se prête pas au développement d’une maison dans l’esprit de Monsieur Allemand. Ils en conclurent, nous dit le chroniqueur, « qu’il était prudent de s’abstenir. Mgr Cruice le comprit bien ; mais comme il en paraissait affligé et qu’il fallait lui montrer notre bonne volonté, on pensa à lui proposer de tenter quelque chose à La Ciotat » . Ce qui fut fait. Mgr Cruise et l’abbé Vitagliano, reprirent le dossier de Roquevaire au printemps 1863. Le chroniqueur poursuit « On trouva chez le curé les mêmes dispositions ; mais comme Mgr lui avait aussi déclaré qu’il voulait l’Œuvre, son opposition ne put être qu’une opposition d’inertie et on s’occupa des préparatifs de l’installation. (…) On préféra acheter une petite propriété (…) composée de plusieurs parcelles. Il y avait une maison de deux étages qu’on aménagea au moyen de quelques réparations en faisant du second tout entier une chapelle, du premier l’habitation de nos Messieurs et du rez-de-chaussée les salles des enfants ». L’Œuvre ouvrit le dimanche 5 juillet 1863. J.B.Abram et G.Héraud, Messieurs de l’Œuvre de Marseille (qui en comptait à l’époque une trentaine !), étaient détachés à Roquevaire. Divers travaux furent ensuite réalisés. Près de 70 enfants étaient inscrits. Mais suite à des différends avec le curé et les Frères Maristes qui dirigeaient l’école, l’Œuvre qui avait compté jusqu’à 80 enfants, se trouva réduite à 40 ou 50 au plus.
Comme celle de Cassis, l’Œuvre de Roquevaire ferma ses portes après le 4 septembre 1870, plusieurs jeunes Messieurs de l’Œuvre ayant dû, dès le début de la guerre franco-prussienne, rejoindre, les uns, la Garde nationale, un autre la Légion des Volontaires de l’Ouest (1) . Un des Messieurs décéda au cours du conflit.
La maison ne rouvrit pas, les attentes des familles dont étaient issus les jeunes gens ne correspondant sans doute pas aux projets qu’avaient pour eux les Messieurs. Les annales parlent d’« enfants d’une extrême rudesse », comme l’illustre la réponse de l’un d’eux à un Monsieur qui voulait expliquer tout ce que l’Œuvre faisait pour eux : « Se vous pagavoun pas, viendriès pas ! » (2) Un des membres de l’Œuvre de Roquevaire, Dominique Castellan, suivit cependant la voie qui le mena à la prêtrise puis à l’épiscopat ; il mourut archevêque de Chambéry… Après la fermeture de l’Œuvre, le local, un certain temps inoccupé, fut loué à un certain Turcat, qui exploitait un moulin à tan (écorce de chêne) puis à olives, en utilisant sans doute la force motrice de l’Huveaune. Il fut finalement vendu en 1904 à la Société coopérative des Agriculteurs de Roquevaire (3) qui en était locataire et qui le conserva jusqu’en 1943.
En 1939, la commune de Roquevaire avait pris la décision (délibération du 23 mai 1939) d’acquérir le magasin et l’usine de conserve de fruits qui avaient cessé leurs activités. La délibération prévoyait que « la commune pourrait employer ces locaux soit pour le logement de troupes de passage, de réfugiés venant de Marseille, soit pour l’aménagement d’un hôpital civil et en cas de conflit en hôpital militaire (on était à 4 mois de la déclaration de guerre) , soit pour l’aménagement (…) d’un groupe scolaire, d’une garderie, d’une colonie scolaire… ». La vente effective de la propriété, de 3 100 m2, entièrement close de murs, contenant une bâtisse de 850 m 2 en bon état, élevée d’un étage n’a apparemment pas eu lieu. Au-delà de 1943 , on sait que le syndicat n’en est plus propriétaire, mais suite à une erreur de transcription aux Archives départementales, on ignore si l’acquéreur en fut alors la Commune.
Aujourd’hui, le bâtiment de ce qui était autrefois l’Œuvre est partagé entre plusieurs propriétaires privés (parcelles 7,9,10, 233, 234). Il se trouve Traverse Saint Charles (parfois également appelée Traverse de l’Œuvre), dans un quartier résidentiel, proche du centre de Roquevaire et il a conservé belle allure.
Association des Anciens, Équipe du mémorial
- Que le colonel de Charette avait formée avec ce qui restait des zouaves pontificaux.
- « Si on ne vous payait pas, vous ne viendriez pas » .
- Concernant l’activité de ce syndicat, qui regroupait 200 cultivateurs, on lit dans le Petit Marseillais du 25 juin 1897 « Les cultivateurs réunis en syndicat mettent en commun la récolte et mettent en conserve la pulpe des abricots (Il s’agissait du « Pointu de Roquevaire » cultivé sur les restanques, pour être mis en conserve sous le nom d’ « Abricot français »). « La récolte, continue le journaliste, a été très abondante ; elle est apportée au syndicat qui a transformé l’usine Turcat et y a installé les cuves et le matériel nécessaire à la mise en boîte des pulpes. Sous les platanes de l’ancien local de l’Œuvre de la jeunesse plus de 200 femmes enlèvent les noyaux. Les hommes, jeunes gens et garçonnets reçoivent les pulpes, les passent dans de grandes cuves, les mettent en boîtes, stérilisent dans les immenses chaudières et les entassent dans les salles de l’entrepôt. Le syndicat a depuis deux semaines récolté et mis en conserve plus de 300 000 kg d’abricots, renfermés dans 55 000 boîtes. (…) La récolte devrait atteindre 400 000 kg. À ce chiffre s’ajoute ceux des autres négociants, le syndicat de Lascours s’étant réuni à celui de Roquevaire. (On) demande des femmes pour le dénoyautage. (…) Ces noyaux sont vendus (fabrication de sirops, orgeats, nougats ).Les abricots de Roquevaire sont expédiés en Belgique,Angleterre, Hollande, Russie et Amériques. Le syndicat prépare aussi des câpres ».
Sources :
-
-
- Relation de Monsieur Delobre, de l’Institut Jean-Joseph Allemand.
- Articles de Monsieur Verdot, de l’Institut J.J. À, dans Notre-Écho décembre 1988 et janvier 1989.
- Association pour la sauvegarde du patrimoine historique et culturel de Roquevaire.
- Archives départementales (M. Gorce).
- Archives diocésaines (Mme Tourseiller).
-
- Retour sommaire
En 1862, les Messieurs, qu’encourageait Mgr Cruise, évêque de Marseille, proposèrent de rechercher l’opportunité d’ouvrir une succursale à La Ciotat ; le curé y était favorable et, nous dit M. de Barbarin, Monsieur de l’Œuvre qui écrivit l’histoire des premières années de l’Œuvre de la Ciotat, « on s’aperçut que les principaux habitants du pays étaient flattés que des Messieurs de Marseille, encouragés par leur évêque, viennent s’occuper de la jeunesse de la ville »…« On alla voir, continue-t-il, une assez grande propriété rurale située assez près du mur d’enceinte et d’une superficie de 23 000 m². La propriétaire, Mme Hiver, en accepta la vente qui fut conclue le 10 octobre 1862. En fait, le terrain était trop grand pour nos besoins… Non seulement il fallait penser à revendre une partie du terrain, mais de plus il était nécessaire d’aménager une voie d’accès pour rendre l’Œuvre moins isolée. Il fallait également créer des rues et les faire remblayer peu à peu car le sol était très bas… Tout cela prit beaucoup de temps et, il faut bien le dire, nous créa des préoccupations en rapport très indirect avec notre apostolat. Heureusement, la bienveillance du Maire et de la Cie des Messageries impériales1 aplanit bien des difficultés ». Malgré l’implantation projetée d’un cimetière à proximité, le préfet2 donna, par arrêté du 26 octobre 1863, l’autorisation de diviser et de construire. Le projet de lotissement avait été établi par l’architecte Bérengier, 37 cours Devilliers3 à Marseille. Il comprenait, outre la parcelle que se réservait l’Œuvre, une soixantaine de lots de terrain que reliaient six rues : rue de l’abbé Allemand, rue Saint-Patrice, rue de la Jeunesse, rue Chabaud, rue Brunet, rue Bruchon. Les bâtiments de l’Œuvre, spacieux, comprenant chapelle, salles de jeux et logements, furent édifiés sur les plans de l’architecte Berengier. Les vitraux de la chapelle sont dus au renommé maître verrier Didron, dont on peut voir les œuvres dans des églises telles que Saint Germain l’Auxerrois à Paris ou celle des Réformés à Marseille.L’Œuvre ouvrit le 13 mars 1864 ; elle y fut installée par l’abbé Vitagliano, vicaire général de Mgr Cruise. Trois Messieurs, Messieurs Olivieri, Héraud et Emy, affectés à l’Œuvre de La Ciotat, venaient régulièrement depuis Marseille pour l’animer. À la différence de ce qui s’était produit pour les Œuvres de Cassis et de Roquevaire, l’Œuvre rouvrit après la guerre franco-prussienne de 1870 et elle continua d’être fréquentée par la jeunesse de La Ciotat. Un de ses membres, Louis Maurin, devint prêtre, puis évêque et cardinal archevêque de Lyon.
Les archives nous révèlent que pendant cette période, la Communauté des Messieurs accorda un soin particulier au respect du cahier des charges du lotissement qui excluait toute activité susceptible de porter atteinte aux bonnes mœurs ; elle intenta un procès (qu’elle gagna) à un de ses acquéreurs qui louait le local qu’il avait construit, 15 rue de l’abbé Allemand, à un sieur Pietro Sperati. Celui-ci avait installé un débit de boissons en exerçant officiellement la profession de restaurateur4.
En 1898, l’Œuvre changea… d’adresse ; en effet, par délibération du 1er septembre 1898, la commune décida que les noms des rues, qui avaient été incorporées dans la voirie communale, seraient modifiés en précisant qu’il y avait lieu « de donner une dénomination plus conforme à l’intérêt public (sic) » ; le nom de Michelet remplaça celui de l’abbé Allemand et la rue Saint-Patrice (qui était le prénom de Mgr Cruise) devint la rue Pasteur.
Après la guerre de 14-18, il apparut que la charge de l’animation devenait lourde pour la Communauté des Messieurs qui gérait par ailleurs à Marseille l’Œuvre du boulevard Tellène et celle des Iris, rue du Cdt Rolland. Au soir de l’Épiphanie 1925, les Messieurs quittèrent la maison de La Ciotat, la confiant à la paroisse. Le 1er décembre 1932, la Communauté céda l’immeuble au diocèse en laissant à la disposition de la paroisse tout ce qui se trouvait dans les locaux (objets de la chapelle, ornements, meubles, etc.). La paroisse poursuivit la tâche que s’était assignée l’Œuvre. Une section de la JOC5 s’installa dans les locaux en 1928 et en 1929 l’association sportive « La Vaillante » y fut créée. Dès l’été 1937, elle organisa une première colonie de vacances, puis elle donna naissance à un mouvement Cœurs Vaillants6 en 1938 et à un groupe scout, en 1950. La paroisse continua d’animer l’Œuvre jusqu’en 1970, date à laquelle, elle la confia à l’association La Vaillante.
12 mars 1989, La Vaillante et la paroisse célébrèrent le 125e anniversaire de la fondation de l’Œuvre. Des représentants de la Communauté des Messieurs et des anciens de l’Œuvre de St-Sa y assistaient. Les locaux accueillent actuellement les rassemblements paroissiaux, des groupes de jeunes, un centre de préparation au mariage, mais aussi le patronage Notre-Dame de l’Œuvre qui a ouvert ses portes en 2016…
On peut découvrir le bâtiment à l’adresse suivante : 19 Bd Michelet, La Ciotat et demander à visiter la chapelle. On remarquera que le buste de Jean-Joseph Allemand a conservé sa place au sommet de la façade principale.
Association des Anciens, Équipe du mémorial
-
-
- Plus tard dénommées Messageries maritimes, fusionnées avec la Cie Générale Transatlantique, le tout repris par CGM.
- Charlemagne de Maupas (1818-1888). Il avait été un des organisateurs du coup d’État du 2 décembre 1851. Nommé en 1860 « administrateur du département des Bouches du Rhône », il fit édifier l’actuelle préfecture et ouvrir la rue de la République.
- Aujourd’hui cours Franklin Roosevelt
- Comme en témoigne un document resté dans les archives de l’Œuvre et qui détaille ses prestations (Zuppa, Vino, Brodo, etc.).
- J.O.C. : « Jeunesse ouvrière chrétienne », association chrétienne de jeunes du milieu ouvrier fondée en 1925.
- Cœurs Vaillants : Mouvement de jeunesse catholique créé en 1936, devenu l’Action catholique des Enfants (A.C.E.).
-
Sources :
-
- Notre Écho décembre 1988, janvier, mars, avril 1989.
- Archives de l’Œuvre.
- Archives diocésaines.
- Retour sommaire
La « Congrégation Allemand »
et la création de l’Œuvre Timon-David
1. L’Assistance
Quand, dans les années 1870, les jeunes membres lui demandaient comment avait été fondée leur Œuvre, le Père Joseph Timon-David répondait : « Je vais vous dire en premier lieu qui sont ceux qui nous ont établis. Ils constituent une lignée. Avant tout, les prêtres du Bon Pasteur, puis Monsieur Allemand, l’Abbé Julien et enfin Monsieur Brunello1. C’est une longue histoire dont nous ne devons pas perdre la mémoire ou la conserver seulement dans la poussière des archives de notre Œuvre. »
Nous allons dire cette histoire, mais d’abord quelques mots pour mieux connaître Joseph Timon-David, né à Marseille en 1823. Bien que nous ne trouvions aucune trace de son inscription, Joseph mentionne dans ses écrits qu’il fut inscrit à l’Œuvre de Monsieur Allemand en septembre 1831. Sa véritable formation fut celle qu’il reçut au Collège de Fribourg (Suisse) chez les Jésuites. Il en fut durablement marqué et découvrit une méthode d’éducation qu’il n’oubliera pas. En 1842 Joseph part pour le séminaire Saint-Sulpice à Paris car il a choisi la prêtrise. En 1845 il est à Marseille pour de courtes vacances passées auprès de sa mère. Il entre en contact avec l’Abbé Julien, vicaire de la paroisse Notre-Dame du Mont. Cette rencontre va changer sa vie et donner une orientation décisive à son apostolat. Le Père Julien lui détailla sa vocation : aider et christianiser la jeunesse ouvrière issue de la révolution industrielle et laissée à l’abandon. L’Abbé Julien avait organisé une Œuvre de jeunesse rue de la Loubière à Marseille. Le futur Père Timon-David est immédiatement conquis. Il rejoint Saint-Sulpice mais revient rapidement à Marseille près de sa mère gravement malade. Il en profite pour prendre contact comme diacre avec les jeunes de la Loubière. Le 28 juin 1846, il est ordonné prêtre par Monseigneur de Mazenod, évêque de Marseille, dont il est très proche. Mais la collaboration avec l’Abbé Julien s’avère difficile. L’optique de ce dernier est surtout sociale, alors que celle de Joseph est catéchétique et privilégie une éducation religieuse. À cela s’ajoutent de graves difficultés financières dues aux dépenses excessives de l’Abbé Julien. Au printemps 1847 c’est la séparation.
Monsieur Timon subit alors des pressions, sans doute de l’évêque, pour prendre la direction de l’Œuvre de Saint-Raphaël fondée en 1835 par un ancien de l’Œuvre Allemand, l’Abbé Payen, à qui fut finalement laissée la direction.
Début août 1847 Joseph Timon-David est contacté par l’Abbé Brunello, directeur de l’Œuvre Allemand, nommé par Monseigneur de Mazenod. Son but est d’adjoindre à la Congrégation Allemand destinée à la jeunesse bourgeoise, une annexe qui admettrait des jeunes de la classe populaire. L’abbé Félix Brunello lui proposa à cet effet d’acheter un terrain rue Chape qui était loué à un cercle de boulomanes ainsi qu’un terrain permettant d’avoir un accès par la rue d’Oran. Le montant total de l’acquisition, majoré des frais, s’est élevé à 74 235 francs (un ouvrier percevait 2,50 F par jour). Il fallait ajouter à cela les frais d’entretien et d’équipement qu’a supportés la Congrégation Allemand. Monsieur Brunello et ses « Coopérateurs » (Les Messieurs de l’Œuvre et le Grand Conseil) désiraient « l’adjonction de nouveaux prêtres ». Le projet de l’abbé Brunello, incomplet, fut approuvé par l’évêque qui en était certainement à l’origine et dont le but était de créer un institut de prêtres pour travailler avec un Institut de laïcs. Il s’agissait de déterminer si le Supérieur de l’Institut des prêtres (de Timon-David) serait soumis au Directeur de l’Œuvre de la jeunesse, ou si ce dernier devait être subordonné à un Supérieur général des deux Instituts. Le grand Conseil de l’Institut Allemand précisa qu’il était impossible de changer les règles de fonctionnement. Le Directeur de l’Institut qui était en même temps celui de l’Œuvre de la jeunesse ne devait relever que de Monseigneur l’Évêque. Ces pourparlers eurent lieu en même temps que se déroulaient les formalités d’acquisition. On put voir ainsi que les réticences étaient déjà vives. Les futures tensions trouvent ici leur origine. Le projet fut donc proposé à l’Institut Allemand. Devait-on aider à la création d’une « Œuvre ouvrière », devait-on acheter ou louer ? Il fallait aussi se déterminer sur le fait de détacher un ou plusieurs membres de la Communauté pour aider le Père Timon. Cependant il semblait intéressant de créer une Œuvre populaire, car des enfants étaient régulièrement refusés à l’Œuvre Allemand à cause de leur origine sociale. Cet argument emporta la décision. Pour faire face aux dépenses, deux membres de la Communauté, Messieurs Esprit Heyraud et Pellat vendirent chacun une maison.
L’Œuvre Timon-David ouvrit ses portes le 10 octobre 1847 (soit trois mois après les premiers contacts !) avec 36 enfants « rescapés » de l’Œuvre de la rue de la Loubière. Si elle était dirigée par le Père Timon, il était dans la pensée de tous que l’Œuvre de la rue d’Oran était sous la direction de l’Institut et de l’Abbé Brunello. Le Directeur de l’Œuvre de la rue d’Oran suivait avec constance les « conseils » de l’Institut et les traditions de Monsieur Allemand. Il partageait son temps entre la rue d’Oran et l’Œuvre Allemand « où il s’imprégnait de l’esprit du Père fondateur ». À son imitation, il fonde le 18 avril 1849 la réunion du Sacré-Cœur qui doit être le « foyer ardent de l’Œuvre ». Joseph Timon-David était entré le 17 septembre 1847 au noviciat de la Communauté sur l’insistance personnelle de Monsieur Brunello car les membres laïcs de la Communauté n’appréciaient pas l’arrivée d’un prêtre en son sein. En vérité, la nouvelle Œuvre fut mise en place spirituellement et financièrement par les deux membres de la Congrégation Allemand détachés à cet effet, Messieurs Olivieri et Saver que l’abbé Timon-David appelait « Membres administrateurs ».
Joseph Timon-David déclare lui-même en 1849 « qu’il n’a aucun souci matériel » Mais il ajoute qu’il est à la tête « d’une Institution de bric et de broc » dont la chapelle est une « ancienne salle d’auberge et dont les bancs et les quinquets » proviennent de la place de Lenche, l’ancien local de l’Œuvre Allemand. Les travaux et l’entretien étaient pris en charge par la Congrégation (l’Œuvre Allemand) qui versait, à la demande de l’Évêque, un « demi-traitement » soit 500 francs mensuels à l’Abbé Timon-David. Le montant fut porté à 800 francs à la demande du bénéficiaire, soit le même montant que celui perçu par Monsieur Brunello. La totalité des frais d’installation et de fonctionnement s’est élevée à 97 000 francs.
Le Directeur de l’Œuvre de la rue d’Oran a cependant considéré qu’il se trouvait mal traité par la Congrégation Allemand qu’il ne nomme plus que « la première Œuvre ». Manifestement l’argent lui manque pour réaliser ses projets et il supporte mal la tutelle de la Communauté. Dans une lettre adressée au Directeur le 3 septembre 1849 il écrit : « Je ne veux continuer l’Œuvre que sur les bases d’un parfait accord. »
La recherche de cet accord va faire l’objet de négociations à l’issue desquelles la séparation est intervenue. Un prochain article sera consacré à cette période.
2. La Séparation
Bien après les événements relatés dans le présent propos, Joseph Timon-David écrira dans ses Annales : « Vous n’attendez pas, mes chers enfants, que je vous raconte l’histoire de notre abandon par les Directeurs de l’Œuvre de Monsieur Allemand. »
C’est l’histoire de cet « abandon » que nous allons évoquer. Très vite, nous l’avons vu, Monsieur Timon se sent à l’étroit dans les règlements de la Congrégation Allemand. De plus il est hanté par une conviction : « Il faut que le prêtre soit à la tête afin de donner une dimension spirituelle à son apostolat. » Il propose au Grand Conseil de la Congrégation Allemand de constituer un groupement mixte de laïcs et de prêtres. Cette idée correspond peu ou prou à la vision initiale de l’Abbé Brunello, alors Supérieur de la Congrégation. Il apparaît que le but de Monsieur Timon et de son mentor l’Abbé Guiot (ami de l’Abbé Julien et de l’Abbé Brunello) était de pousser le Supérieur de la Congrégation Allemand à la démission et de le remplacer par l’Abbé Guiot comme Supérieur des deux Œuvres (lettre de l’Abbé Brunello à Mgr de Mazenod en date du 11 avril 1850). Sitôt testée, la nouvelle formule (prêtres/laïcs) crée des dissensions insurmontables dues à la partie laïque. Le Supérieur souhaite alors se séparer de Joseph Timon-David.
Ce dernier évoque dans les Annales de son Œuvre sa séparation d’avec l’Abbé Julien effectuée avec la promesse de « l’autre Œuvre » de fournir un local, d’assurer les frais d’entretien et même de le gratifier d’un demi-traitement. Mais, précise-t-il, il s’agissait d’une convention verbale qui ne pouvait être pérenne. Le Directeur de la « nouvelle Œuvre » pense que dès 1849 son expulsion est résolue. Le soutien de Monseigneur de Mazenod et les propriétaires du local lui laissant, sous la pression de l’évêque, la jouissance des lieux, son renvoi ne put avoir lieu. Mais il dut accepter des conditions onéreuses réussissant à repousser les plus inacceptables. Joseph Timon-David écrit : « Les torts réciproques que personne ne doit voir ne peuvent être révélés. » Son traitement est supprimé et l’entretien de la Maison lui incombe totalement. De plus il est toujours sous la menace d’un expulsion. Cette rude convention fut signée le 24 novembre 1849.
Joseph Timon entend cependant rester fidèle à l’esprit et aux méthodes de Jean-Joseph Allemand. Son Œuvre ne sera pas une quelconque garderie mais un rassemblement durable et religieux d’enfants du milieu populaire. Une critique revient régulièrement à l’encontre de la Congrégation Allemand. Il ne comprend pas qu’une telle organisation disposant de moyens aussi importants n’a jamais cru devoir accroître et embellir la chapelle de la rue Saint-Savournin. L’Œuvre de Monsieur Timon se développe malgré les difficultés financières, et le nombre de membres augmente régulièrement. Les dons et les subventions satisfont à peu près aux besoins de financement. « Abandonné à mes propres ressources, je me réduis à devenir quêteur » (Annales Œuvre TD T 1). Les premières communions et les confirmations se déroulent cependant dans la chapelle de la rue Saint-Savournin. Par contre le « Monsieur Allemand » qui l’avait si bien secondé dans la direction spirituelle lui est enlevé.
Monseigneur de Mazenod suit de près l’évolution de l’Œuvre et l’érigera canoniquement le 20 novembre 1852. Puis c’est au tour des dirigeants de la Congrégation Allemand de lui donner un coup de main sous la pression de l’évêque, en consentant un nouveau bail de 14 ans, jusqu’au 29 septembre 1866. Les Messieurs Allemand se retireront définitivement le 15 janvier 1855.
Joseph Timon-David a alors 32 ans et il est désormais seul maître du destin de son Œuvre. Il restera toujours fidèle à l’enseignement de Jean-Joseph Allemand auquel il empruntera, selon ses dires, « Les usages, la méthode et surtout l’esprit. »
Bien sûr, le temps relativisera bien des choses et normalisera les relations entre les deux Œuvres de la Jeunesse marseillaises.
Jean-Magalon
Commission du Mémorial – Association des Anciens
- Il s’agit, comme on le lira plus loin, de l’abbé Félix Brunello, alors directeur de l’Œuvre Allemand.
Sources
- Archives OJJA.
- Annales de l’Œuvre pour la classe ouvrière de Marseille, T.1, Joseph Timon-David, Marseille, Ed. Cayer Hachette / BNF.
- Jean Chelini, Au cœur des jeunes. Timon-David, Nouvelle Cité, 1988.
- F. Brunello, Vie du Serviteur de Dieu J.J. Allemand Fondateur de l’Œuvre de la Jeunesse, Marseille, Éd Chauffard, 1852.
- Méthode Timon David, SJC, Éditions de l’École, 1930.
- Extraits des notes de Monsieur Delobre, ancien supérieur de l’Institut de l’Œuvre Allemand.
- Archives du Diocése de Marseille.
- Merci à mon ami Gilbert Riou Timonien de toujours.
L’Œuvre à l’exposition catholique de Marseille
26 mai – 18 juin 1935
On a parfois l’impression, lorsqu’on cherche à mieux connaître quelle a été la vie de l’Œuvre dans le passé, notamment en parcourant Notre Écho qui, à partir de 1931 fut l’organe de liaison de l’Institution, qu’elle vivait une vie assez indépendante au sein de l’Église de Marseille. Il n’en fut pourtant rien, comme en témoignent notamment ses relations fructueuses avec le scoutisme et sa participation à l’Exposition catholique de 1935. C’est Mgr Maurice Dubourg, nommé évêque de Marseille fin 1928, qui souhaite alors rendre visible le diocèse de Marseille et à travers lui l’Église catholique. Il lance donc le projet d’une exposition diocésaine et missionnaire. Une très importante exposition missionnaire avait eu lieu au Vatican en 1925.
Le chapitre sur l’Église à Marseille1, dû à Robert Maumet dans la brochure sur l’Église Saint Louis, a permis de remettre en valeur cette exposition qui s’est tenue au Parc Chanot du 26 mai au 16 juin 1935. Il cite Mgr Dubourg : « L’intérêt d’une telle manifestation saute aux yeux. Marseille, plus qu’aucune autre ville, est indiquée comme centre d’Exposition missionnaire… Par ailleurs, du point de vue purement religieux, notre cité a une magnifique histoire. C’est par elle que le christianisme pénétra dans les Gaules. Son culte pour la Vierge Marie est légendaire : de l’antique crypte de Notre-Dame de Confession, il s’épanouit sur la colline que domine aujourd’hui la basilique de Notre-Dame de la Garde… » Il évoque également la mise en valeur des richesses artistiques dans les églises et la dynamique de la vie catholique actuelle « intensifiée par le grand évêque que fut Mgr de Mazenod, elle n’a cessé de produire des œuvres de bienfaisance pour le soulagement des misères humaines et des œuvres d’éducation pour la formation de la jeunesse. La ville de M. Allemand, de l’abbé Timon-David et l’abbé Fouque est encore aujourd’hui la ville des œuvres de jeunesse. Nous avons pensé qu’il ne convenait pas de garder jalousement pour soi de tels trésors , mais qu’il fallait les faire admirer et ne pas craindre d’exposer à tous les yeux les grandes œuvres inspirées par la foi et la charité chrétienne dans tous les domaines de l’activité humaine »
Deux domaines de présentation vont structurer ce programme : le diocèse et les missions. Le diocèse présente des œuvres d’art (tableaux, sculptures, objets du culte) prêtées par les paroisses, les communautés religieuses et aussi des particuliers. Les actions de charité, de bienfaisance (on n’utilisait pas encore le terme de solidarité), d’instruction et de formation sont naturellement mises en valeur à travers les congrégations, les établissements de l’enseignement libre, les mouvements de jeunesse. Les paroisses ont également leur stand.
L’autre domaine concerne l’exposition missionnaire : plus de quarante instituts missionnaires étaient présents ainsi qu’une quarantaine d’œuvres pontificales. Il passait dans notre ville plus de 4 000 missionnaires par an ! C’est une des justifications de cette exposition !
C’est dans la section Diocèse que l’Œuvre va être présente au Parc Chanot et c’est Monsieur Émile Perault (1898-1985), membre de la communauté et architecte2 qui va réaliser son stand . Il peut être décrit grâce aux cartes postales éditées à cette occasion. Celui-ci est très structuré. Une copie surélevée de la statue de Jean-Joseph Allemand sculptée par François Carli qui se trouve sous les arcades, est située au centre devant un immense panneau le présentant. Ce panneau est surmonté d’une croix et encadré de deux panneaux plus petits portant de part et d’autre « Ici on joue » et « Ici on prie ». L’arrière du stand est orné de photos qui doivent correspondre aux 4 colonnes sur le devant : de gauche à droite : le scoutisme, les jeux, la prière, les vacances, chacune comportant un grand médaillon photographique ou diorama avec un texte en dessous.
Enfin, de part et d’autre, un espace d’accueil probablement couvert a été constitué, chacun porte la date de fondation en gros caractères :1799 .Et puis, il y a la statue de l’Assomption de la Vierge qui n’apparaît pas sur les cartes postales dont nous avons disposé.
La partie Jeunesse de l’Exposition comprenait l’enseignement secondaire privé et les écoles paroissiales, les mouvements de jeunesse et d’action catholique, les colonies de vacances, les patronages. Il faudrait essayer de retrouver les archives de ces institutions et mouvements. En ce qui concerne l’Œuvre, nous n’avons pas trouvé d’archives, notamment pour la construction du stand, contrairement aux manifestations du centenaire de la mort de Jean-Joseph Allemand le 21 mai 1936.
Il aurait été ensuite naturellement intéressant de connaître la fréquentation de ce stand et les retombées, par exemple, en matière d’inscription ou encore qui étaient les personnes présentes (Messieurs, Grands, Anciens ?). La durée de l’Exposition et les larges plages d’ouverture devaient nécessiter des équipes importantes et formées.
Nous emprunterons à Notre Écho, bulletin de l’Œuvre de la jeunesse, divers échos de l’exposition. D’abord dans le numéro 44 du 1er juin 1935 :« Je ne ferai pas à mes lecteurs l’injure de leur poser une telle question : avez-vous visité l’Exposition catholique ? Non. Comment non ? Mais c’est inimaginable, incompréhensible, ridicule. Descendez-vous de la lune ou sortez-vous des entrailles de la terre pour ignorer l’E.C et ne pas l’avoir visitée ! Ils me répondraient fort justement que la presse marseillaise les renseigne suffisamment… J’exposerai donc particulièrement la part de l’Œuvre dans l’exposition et sa collaboration aux grandes manifestations ».
Bizarrement, ce texte n’est signé que par des initiales G. . La préparation du stand et son exécution n’ont pas été aussi rapides que l’on aurait voulu. (Cela rappelle-t-il pas certaines kermesses ?). Le 24 mai au soir, le diorama de la chapelle formait encore deux parties distinctes : la carcasse et la toile. Le matin de l’inauguration, pas de décoration, mais tout était en place 30 secondes avant le passage de Mgr Dubourg !
Dans la section de l’art chrétien, deux œuvres proviennent de l’Œuvre : « Le Tableau des “Ames du purgatoire” qui se trouvait ordinairement au-dessus de la porte latérale de la chapelle » et « notre belle statue la Sainte Vierge à laquelle s’attachent tant de souvenirs historiques. M. Car (alors directeur de l’Œuvre ) après bien des hésitations… a cédé aux instances de Monseigneur et la belle statue est partie de l’Œuvre depuis le lundi 27 mai. » La statue n’était probablement pas documentée !
L’Œuvre a également participé aux deux grandes manifestations de l’Ascension et du dimanche 2 juin avec la présence de deux cents jeunes environ « qui auront montré l’importance qu’attachent les membres de l’Œuvre aux manifestations catholiques du diocèse ».
L’article se termine par un long chapitre sur la présence du stand et son rayonnement. « Notre stand est digne de l’Œuvre et digne de l’exposition. Puisse-t-il servir efficacement à la gloire de Dieu et à la cause de béatification de notre saint Fondateur. »
Le numéro 45 du 1er juillet 1935 s’ouvre par « un dernier écho de l’Exposition » avec un texte de Mgr Dubourg sur la grande fête marseillaise finale. « Elle a surpassé tout ce que l’imagination pouvait concevoir. Tous les assistants ont été ravis et – je ne crains pas d’ajouter – édifiés dans le sens le plus exact du mot… [Les acteurs] ont tous bien mérité de leurs œuvres et du diocèse. Ce m’est une joie de le leur dire. »
Plus intéressant est le texte de presque 3 pages et demi signé G.H. (?) dans l’Écho des anciens, contenu dans ce numéro, intitulé « Après l’exposition catholique ». L’auteur analyse le résultat de cette exposition et le rôle éminent de Mgr Dubourg . Il insiste sur le rôle de l’Église dans ses différentes missions et sur l’influence de la religion dans la civilisation de l’époque ; bien entendu, il ne peut que se réjouir de l’effort missionnaire dans les colonies ; il n’évoque pas le contexte international à l’exception de la campagne d’Ethiopie (invasion par l’Italie le 3 octobre 1935). La conclusion s’achève par un appel au sentiment de fierté : « Nous serons fiers de la magnifique floraison d’œuvres que nous avons entrevue, parce qu’elles sont nos œuvres ; nous serons fiers de la foi qui anime tous leurs dirigeants, qui lance et soutient dans le monde tant de missionnaires, parce qu’elle est notre foi ; nous serons fiers de l’Église qui garde le précieux dépôt de cette foi et lui fait produire de si admirables fruits de dévouement et de salut, parce qu’elle est notre Mère. »
Nous ignorons naturellement si ce texte a entraîné quelques réactions, mais il faut le replacer dans le contexte des années 1930 où l’Église entend affirmer son rôle caritatif, civilisateur et désintéressé. GH n’a fait que l’évoquer. À Marseille, il n’y a pas eu ensuite de grandes manifestations équivalentes et, à notre connaissance, il n’y a pas eu non plus d’études universitaires sur cette exposition qui a été le reflet d’un moment de l’Église diocésaine mais aussi de l’Église Universelle..
Jean-Claude Gautier
Commission du Mémorial – Association des Anciens
- Années 1930, à Marseille, une Eglise conformiste? » dans le livre paru en 2020, L’église Saint-Louis à Marseille une Mémoire en devenir, Éditions Maltae que Jean-Claude Gautier a dirigé.
- Architecte, notamment des églises Sainte Rita aux Trois Lucs et Saint Jean Bosco au Redon..
Sources
- Archives OJJA.
- Annales de l’Œuvre pour la classe ouvrière de Marseille, T.1, Joseph Timon-David, Marseille, Ed. Cayer Hachette / BNF.
- Jean Chelini, Au cœur des jeunes. Timon-David, Nouvelle Cité, 1988.
- F. Brunello, Vie du Serviteur de Dieu J.J. Allemand Fondateur de l’Œuvre de la Jeunesse, Marseille, Éd Chauffard, 1852.
- Méthode Timon David, SJC, Éditions de l’École, 1930.
- Extraits des notes de Monsieur Delobre, ancien supérieur de l’Institut de l’Œuvre Allemand.
- Archives du Diocése de Marseille.
- Merci à mon ami Gilbert Riou Timonien de toujours.
L’Œuvre de la jeunesse de Nîmes
L’association des Anciens de l’Œuvre Allemand a été interrogée, voilà quelques mois, par l’association « Nouvelle route d’Arles », propriétaire depuis 1893 du site dédié à « l’œuvre Argaud », œuvre de jeunesse de Nîmes qui fut affiliée par le chanoine Argaud aux Œuvres timoniennes de 1909 à 2012, et qui, sachant que celles-ci avaient été portées à l’origine par l’Œuvre Allemand, souhaitait mieux connaître notre institution.
L’Œuvre de jeunesse vit le jour à Nîmes en 1837, à l’initiative de l’abbé Emmanuel d’Alzon(1810-1880) qui fonda plus tard la congrégation des Assomptionnistes1. Il avait eu connaissance de l’Œuvre de Monsieur Allemand, en connaissait le règlement et se proposait de l’appliquer dans l’Œuvre qu’il venait de créer.
La direction de cette œuvre, qui comprenait deux sections, Saint-Louis de Gonzague, patron des étudiants et Saint-Stanislas, plus orientée vers les classes populaires, fut confiée en 1839 à l’abbé Daudet lorsque Emmanuel d’Alzon fut nommé vicaire général.
En 1854, l’abbé C. Argaud (1814-1901) en fut nommé directeur, fonction qu’il conserva jusqu’en 1872. À cette date, elle passa aux mains de la Communauté Assomptionniste. À partir de 1882, l’Œuvre, reprise par le diocèse, fut dirigée à nouveau par l’abbé Argaud jusqu’à sa mort. Elle a finalement été confiée de 1919 à 2012 à l’association Jeanne d’Arc, dans la mouvance des pères de l’Œuvre Timon-David qui, depuis les années 1890, apportaient leurs conseils et incitaient les responsables de l’Œuvre Argaud à acquérir son indépendance en devenant propriétaire de ses locaux. Nous verrons plus loin dans quelles conditions cela se fit.
Depuis le retrait des pères de Timon-David, l’Œuvre Argaud, qui regroupe actuellement des Anciens et des amis de l’Œuvre, poursuit sa mission initiale : préserver ce lieu pour accueillir la jeunesse nîmoise, au travers de la présence, depuis 2021, de l’Ogec de l’institut d’Alzon. Elle met à sa disposition, 5 avenue Général Leclerc, à Nîmes, son patrimoine de 4800 m2, cour, chapelle et salons.
Les responsables de l’Œuvre Argaud nous ayant confié des documents relatifs aux contacts qui eurent lieu un temps avec l’Œuvre Allemand et qui avaient été réunis par le P. Sauvagnac, des pères de Timon-David, nous avons sollicité de sa Communauté des informations sur les relations qui furent alors établies. En voici la relation, à partir des écrits du Père Timon-David, qui effectuait alors son noviciat auprès de l’Institut Allemand.
13 novembre 1848, les responsables de l’Œuvre de Nîmes firent porter à l’Institut Allemand par l’abbé Daudet une lettre dont une copie a été conservée. On y lit que les deux communautés se connaissent bien et même que la Société de Nîmes, qui a sollicité un appui financier auquel il n’a pas été donné suite, demande « aux Messieurs de Marseille » qu’un ou plusieurs membres de l’Institut Allemand viennent l’aider à conduire l’Œuvre de Nîmes sur le modèle de celle de Marseille. Fait original, l’Œuvre de Nîmes propose de trouver pour les Messieurs qui viendraient de Marseille et s’installeraient à Nîmes des activités professionnelles pour qu’ils puissent y gagner leur vie et ainsi financer l’Œuvre… L’Institut écarte cette proposition mais accepte qu’un de ses membres y soit temporairement détaché. Le 2 décembre, l’abbé Brunello, qui fut directeur de l’Œuvre Allemand de 1845 à 1858, informe l’Institut de la démarche qu’il vient d’effectuer à Nîmes, avec trois Messieurs, auprès de l’évêque. Mgr J.-F. Cart2 qui a donné son accord pour que l’abbé Daudet commence son noviciat dans l’Institut, comme celui-ci en fait la demande, et pour qu’un des Messieurs de l’Œuvre s’installe à Nîmes. Dès le 8 décembre, Emmanuel Olivieri3, de l’Institut Allemand, est à Nîmes pour mettre en application le programme qui a été prévu, c’est-à-dire « 1° de faire une réunion spirituelle tous les soirs comme à l’Œuvre, 2° de faire admettre les enfants exclus jusqu’ici de l’association de M. Daudet (on ne sait pourquoi), 3° de former au plus tôt, une association sur le modèle de l’une des deux qui se font à l’Œuvre (sur le modèle des associations des Anges ou du Sacré Cœur).Le projet de coopération a donc démarré sans tarder ; peut-être est-ce l’empressement dans lequel il a commencé à être exécuté qui n’a pas permis son aboutissement.
Nous venons de présenter l’Œuvre de la jeunesse de Nîmes qu’avait fondée l’abbé Emmanuel d’Alzon en 1837 en s’inspirant de celle de Jean-Joseph Allemand et les relations qui s’étaient nouées, à la fin de l’année 1848, entre les deux institutions. L’Œuvre de Nîmes avait alors sollicité l’Œuvre de Marseille pour « l’aider à conduire celle de Nîmes sur le modèle de celle de Marseille » et l’abbé Brunello, alors directeur de l’Œuvre de Marseille, s’était rendu à Nîmes pour rencontrer l’évêque, Mgr Cart. Monsieur Emmanuel Olivieri, de l’Institut Allemand, avait été détaché le 8 décembre auprès de l’abbé Daudet, directeur de l’Œuvre de Nîmes, pour mettre en application le programme convenu avec l’évêque.
« Les choses, note ensuite l’Institut (Allemand), avancent lentement » mais on relève dans son agenda que le jour de l’Épiphanie 1849, Emmanuel Olivieri est bien à Nîmes. En février, les Messieurs constatent qu’il est difficile de trouver un local et de réunir les fonds nécessaires pour l’ouverture d’une maison. Ils remarquent que le directeur (l’abbé Daudet), ne semble pas réunir toutes les conditions requises.
Le 27 mars, le rappel de Monsieur Olivieri à Marseille est évoqué car l’évêché de Nîmes ne peut rien « pour l’établissement matériel de l’Œuvre », le chapitre de la cathédrale non plus et le lancement d’une souscription est jugé aléatoire. D’autres raisons apparaissent : cette nouvelle Œuvre nécessiterait de la part de l’Œuvre de Marseille un soutien financier qui lui paraît trop important ; il ne faut pas oublier qu’au cours de la décennie écoulée l’Œuvre a réalisé de grands travaux (notamment la construction des deux ailes du bâtiment central) et que, lorsqu’il s’est agi d’aider le Père Timon-David lors de la création de son Œuvre en 1847, deux Messieurs ont dû vendre des biens personnels pour lui avancer le capital nécessaire. Par ailleurs, et surtout, semble-t-il, l’abbé Daudet « ne conduit pas son Œuvre d’une manière conforme à (notre) “esprit” ».
Le 3 avril, l’Institut rejette le plan de financement que présente Mgr Cart, car l’engagement que prendrait l’Institut lui paraît difficile à cerner. Un nouveau projet est finalement adopté le 23 avril ; il prévoit que « le curé de la cathédrale et Monsieur Olivieri, Membre de l’Œuvre de la Jeunesse de Marseille, agissant chacun en leurs dites qualités et au besoin en leur nom personnel » s’engagent à avancer les fonds nécessaires à l’investissement et au fonctionnement de l’Œuvre à créer, à hauteur respectivement de 20 000 francs et de 12 000 francs.
On ne sait si cette convention fut signée mais le 20 juin 1849 « le curé de Nîmes ne donnant que de bonnes paroles » dit l’Institut, l’affaire est abandonnée. « On ne refuserait pas de la renouer une autre fois » note le Conseil de l’Institut « mais sur d’autres bases ». Ces opportunités ne sont pas apparues.
L’Œuvre de Nîmes a cependant, nous l’avons vu, poursuivi son chemin ; après avoir été hébergée par le Diocèse de Nîmes, elle se trouva dans l’obligation en 1882 de disposer d’un nouveau local. Une association d’anciens se constitua pour soutenir l’Œuvre et son directeur, l’abbé Argaud devenu chanoine. En 1893, semble-t-il sur les conseils des Pères de Timon-David, elle fit l’acquisition d’un local sur lequel ont été édifiés les locaux actuels grâce essentiellement à la générosité des anciens de l’Œuvre. En 1894, la chapelle dessinée par l’architecte Louis Poinsot, était terminée ; les peintures dues aux artistes locaux Jules Gaspard Rastoux et Joseph Beaufort furent achevées quelques années plus tard. Le cadre dans lequel l’Œuvre a poursuivi sa mission pendant plus d’un siècle était en place.
•••
Nous aurons certainement l’occasion de reparler de nos « cousins de Nîmes » lorsque les Anciens de « l’Œuvre Argaud » inaugureront leur Mémorial qui nous éclairera sur ce qui a fait que les cours de nos deux institutions n’ont pas été identiques. Les deux se retrouvaient dans leur objet et leur méthode, « Ici on joue et on prie », mais les moyens en ont sans doute été différents.
Commission du Mémorial – Association des Anciens
Qui remercient pour la communication de leur documentation :
Paul Bertrand, des anciens de l’Œuvre Argaud.
Le Père Michel Brondino, des Pères de Timon-David
- La congrégation des Augustins de l’Assomption, plus connue sous le nom des Assomptionnistes a été une congrégation missionnaire, notamment en Europe centrale ; elle est à la tête du groupe « Bayard-Presse » bien connu par ses titres La Croix et Le Pèlerin.
- J.-F. Cart (1799-1855) , évêque de Nîmes de 1837 à 1855.
- Emmanuel Olivieri était de ceux qui ont accompagné Monsieur Allemand dans ses derniers instants. C’est lui qui ira en 1871 à Rome recevoir du pape l’approbation de l’Institut.
La chapelle au fil du temps
Le 20 novembre 1820, l’Oeuvre acquit «une maison avec jardin», au numéro 20 de la rue Saint Savournin et entreprit aussitôt la construction d’une chapelle (dont le coût s’est élevé à près de la moitié du prix d’achat de la propriété).
La chapelle fut édifiée contre la façade nord de la maison. Les deux ailes du bâtiment actuel, qui s’avancent à l’Est et à l’Ouest, ont été ajoutées en 1839 et 1840. Le chœur, faisant saillie à l’Est du bâtiment , était éclairé par des fenêtres hautes; les fenêtres du côté sud du chœur ont été occultées lors de la construction de l’aile Est en 1840.
La chapelle était sensiblement plus courte que maintenant; elle ne comprenait que 3 travées; sa façade Ouest s’ouvrait sur une cour à laquelle on accédait depuis la traverse St Savournin, devenue plus tard, avec quelques modifications, la rue Gérando et qui était à l’époque approximativement à son niveau. Cette façade a disparu lors de l’allongement de la chapelle et de la création d’une tribune susceptible de recevoir un orgue. En 1837 et 1838, d’importants travaux d’embellissement ont été menés à bien, notamment la création des voûtes factices qui ont remplacé le plafond plat, l’édification des deux colonnes qui délimitent le chœur et sa décoration avec deux cartouches symboliques aujourd’hui disparus ainsi que la pose de deux frises, dues au sculpteur parisien Dupré.
L’autel, de style tombeau, en bois recouvert de stuc de teinte claire, s’élevait de trois marches au-dessus du sol duchœur dont le niveau a été exhaussé lors de l’installation du nouvel autel dans les années 1970. Trois hauts chandeliers étaient disposés de part et d’autre du tabernacle, surmonté d’un globe, dans laquelle était fichée la croix qui est actuellement au Musée. Pour les grandes fêtes, un vaste tapis était déployé, que les sacristains appelaient le «Grand Turc», et qui occupait l’essentiel de la première travée de la chapelle à partir du chœur.
La statue de l’Assomption de la Vierge était placée sous un baldaquin, sur le côté gauche de la chapelle. Lui faisant face, une chaire en bois avait été installée, à laquelle le prédicateur accédait par une petite porte ouvrant sur le demi- palier du grand escalier de la maison. Lorsque la chaire a été enlevée, une niche a été aménagée pour la statue. A l’emplacement de la statue, un emplacement avait été réservé pour recevoir une fresque représentant une copie de l’Annonciation de Fra Angelico; le projet a été abandonné lors de la restauration qui a précédé le bi-centenaire de la fondation de l’Oeuvre.
A l’occasion des fêtes importantes, les murs étaient revêtus de tentures de velours rouge ou noir. Les différentes stations du Chemin de croix étaient marquées par des tableaux peints qui ont été remplacés en 1942 par les fresques de Gabriel Bougrain. Un lambris bas courrait au long des murs latéraux. Devant lui, sur une petite estrade étroite, étaient disposées les chaises des «Grands», les petits s’asseyant sur des bancs en bois sans dossier, disposés longitudinalement, et se faisant donc face. Un de ces bancs est conservé au Musée. Les stalles dans lesquelles les Messieurs prenaient place occupaient le mur du fond de la chapelle, de part et d’autre des bénitiers. C’est depuis ces stalles que chaque année, un dimanche de Novembre, étaient proclamées les Charges qui affectaient une fonction pratiquement à chaque membre de l’Oeuvre ( sacristain, choriste, enfant de chœur, etc).
Dans la chapelle, les titulaires de charges occupaient une place bien définie: les choristes prenaient place à la tribune, les 24 sacristains se disposaient en demi-cercle autour de l’autel, et les portiers, qui ouvraient et fermaient les portes et s’occupaient de l’éclairage, ainsi que les trésoriers de service qui présentaient les bourses de la quête à la sortie de la messe, s’installaient près des portes. Les lecteurs, qui donnaient la lecture en français de l’Epitre et de l’Evangile que le célébrant disait en latin, prenaient place à proximité du chœur.
Les fenêtres du côté gauche étaient garnies de vitraux avec grisailles; Ils ont été remplacés en 2010/2011 .Les fenêtres du côté droit, crées par souci de symétrie lors de la construction de la chapelle, ont toujours été aveugles et n’ont reçu des vitraux qu’en 2011. L’éclairage était assuré par des chandeliers en appliques, auxquels ont succédé des becs de gaz, puis des lustres munis d’ ampoules électriques. Ils ont été remplacés par des projecteurs fixés aux clés de voûte, puis par des luminaires d’une nouvelle génération peu avant le Bi-centenaire.
Deux autres lieux de culte étaient aménagés dans l’Oeuvre, la chapelle dite des Anges et un oratoire, au sein des locaux réservés à la Communauté des Messieurs. La chapelle des Anges, aménagée en 1851 occupait la totalité du deuxième étage de l’aile Est du bâtiment; elle était destinée aux réunions d’une des associations de perfectionnement auxquels étaient invités à adhérer les membres de l’Oeuvre désireux de parfaire leur imprégnation de la spiritualité du Fondateur. Ces associations ont disparu, remplacées par des groupes de prière; désaffectée, la chapelle des Anges a été réaménagée dans les années 1980, primitivement en chapelle puis pour l’accueil d’activités diverses. L’oratoire de la Communauté a changé de place; il se trouve au rez-de-chaussée de l’aile de la Communauté, mais est ouvert à tous et ceux qui arrivent à l’ Oeuvre sont toujours invités à « saluer le Maître de la maison « comme disait Monsieur Allemand.


L’autel et le tabernacle
Le patrimoine de l’Œuvre Jean-Joseph Allemand vient de s’enrichir de deux belles pièces. La Communauté des Sœurs Franciscaines Missionnaires de Marie a récemment fait don à l’Œuvre d’un autel et d’un tabernacle que vous pouvez voir depuis le mois d’avril 2019 dans la chapelle. Cet autel et ce tabernacle étaient depuis 1970 dans la chapelle des Sœurs dans leur maison au 202, rue Breteuil à Marseille.
Le maître autel est en pierre noire, venue de Belgique. Il est d’aspect strié avec incrustation du texte doré sur le plateau: «Et le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous plein de grâce et de vérité».
La hauteur de l’autel est de 90 cm. Le plateau a une largeur de 100 cm et une épaisseur est de 13 cm. Le plateau semble à l’écoute avoir un parement en métal, reproduisant l’aspect fini de la colonne et du socle qui sont en pierre.
Le visiteur attentif remarquera que sur le pied de l’autel, l’Annonciation est particulière car l’ange Gabriel est à droite, alors que Marie est à gauche. Sur la majorité des Annonciations c’est l’inverse.
Le tabernacle présente une finition identique à celle de la table d’autel. Ils forment un très bel ensemble.
Cette oeuvre a été réalisée par Jean Bernard qui a également réalisé l’autel et le tabernacle de l’Abbaye Saint-Victor, consacrés en 1966.
Jean Bernard est né le 17 décembre 1908 et est mort le 12 mai 1994. Artiste complet, il était aussi écrivain, tailleur de pierre, illustrateur, sculpteur et peintre. Il devient Compagnon du devoir, tailleur de pierre, à Bordeaux en 1938 bien qu’il n’a pas conclu de Tour de France ni de chef d’oeuvre. Il prend le pseudo de «Fidélité d’Argenteuil». En 1983, Il reçoit le Grand Prix des Métiers d’Art. Jean Bernard est à l’origine, avec d’autres Compagnons, de l’Association Ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France, une des trois organisations compagnonniques françaises actuelles. L’AOCDTF est une association loi de 1901 destinée à la formation et à l’apprentissage de plusieurs métiers suivant les traditions du compagnonnage. Son objet est de permettre à chacun et chacune de s’accomplir dans et par le métier dans un esprit d’ouverture et de partage. Avec Yvonne de Coubertin (1893-1974), nièce de Pierre de Coubertin, il crée en 1950 une association pour le développement du Compagnonnage rural qui devient en 1973 la Fondation de Coubertin, installée à Saint-Rémy-lès-Chevreuse. Cette Fondation a pour objet de parfaire la formation professionnelle, intellectuelle et culturelle de jeunes issus des métiers manuels et de leur transmettre les valeurs du souci de la perfection et de la qualité du travail, du sens de l’honnêteté et des responsabilités. L’institution reçoit chaque année une trentaine de jeunes gens, appartenant aux métiers de menuisier, ébéniste, métallier, maçon, tailleur de pierre, plâtrier et chaudronnier, issus pour la plupart de l’AOCDTF.
L’Institut des Franciscaines Missionnaires de Marie a été fondé en Inde en 1877 par la bienheureuse Hélène-Marie-Philippine de Chappotin de Neuville, en religion sœur Marie de la Passion (1839 – 1904) béatifiée en Octobre 2002 par Jean Paul II. Reconnu par Rome comme Institut des Missionnaires de Marie, affilié à l’ordre franciscain en 1885 par choix de la fondatrice et de ses premières compagnes, elle compte plus de 6000 sœurs dans 74 pays. Son siège est à Paris.
Sept sœurs furent martyrisées à Tai Yuen Fou, en Chine, lors de la persécution des Boxers en 1900. Agées de 28 à 36 ans, elles soignaient les malades et recueillaient les orphelins abandonnés. Sœurs Hermine, Nathalie, St-Just, françaises, Chiara et Maria della Pace, italiennes, Amandine, belge, Adolphine, hollandaise ont été canonisées en 2000 par Jean Paul II.
La première communauté de Marseille est fondée le 27 mars 1885 au 174 de la rue Breteuil (actuelle rue Lacédémone), son premier but était de recevoir et d’accompagner les Soeurs en partance pour les missions lointaines d’Asie et d’Afrique. Très vite les Sœurs furent sollicitées par la paroisse pour ouvrir un patronage, un ouvroir pour les jeunes filles du quartier, une œuvre des catéchismes pour les petites filles des écoles laïques puis un atelier de broderie et de vêtements liturgiques, un jardin d’enfants, un foyer d’accueil de jeunes filles avec toujours comme motivation première: la mission.
Jusqu’à leur déménagement il y a quelques mois la Maison de la rue Breteuil, sous le patronage de St-Raphaël, était essentiellement une maison de retraite pour les sœurs aînées qui ont pour la plupart derrière elles des missions en Chine, Vietnam, Maroc, Madagascar, Congo, Guyane, etc. Certaines ont encore une activité bénévole pour des visites aux malades en soins palliatifs, dans un service du Secours Catholique, auprès des migrants d’Afrique, et surtout dans les services fraternels auprès de leurs sœurs de la maison. Dès 1892, des Franciscaines Missionnaires de Marie de la rue Breteuil ont assuré un service à Notre-Dame de la Garde.
Il existe depuis 1991 une fraternité Franciscaine Missionnaire de Marie dans la cité d’Air Bel, implantée à l’appel du Secteur Pastoral de la Vallée de l’Huveaune. Les Sœurs animent des partages de foi, des Mouvements d’Action Catho Sauvegarder lique et assurent la catéchèse et les liturgies, en lien avec l’équipe pastorale et le Conseil de Secteur. Elles coopèrent avec les Associations pour aider adultes et jeunes à vivre dignement, avec un souci spécial des femmes seules. C’est leur vie de prière personnelle et communautaire qui se concrétise tous les jours.


Vitraux
Ces vitraux sont de type allégorique et s’ordonnent à partir du thème «Les mains tout au long du chemin de croix».
Le choix de ce thème a fait l’objet de nombreux échanges lors de la préparation du chantier. Cette étape a été la plus importante et la plus enrichissante car elle a permis de connaître les points de vue de tous les participants, artistes créateurs, Messieurs de l’Œuvre et verriers.
Les dessins initiaux, leurs commentaires et les prières les accompagnant sont l’œuvre de Félix Girard, qui les avait conçus dans les années soixante-dix. Ils ont été légèrement remaniés par Robert Franceschi pour les rendre compatibles avec la technique du vitrail; ils ont été ensuite retranscrits sur les vitraux par Chantal Gimmig, spécialiste de la grisaille. On signalera ici que Félix Girard était également sculpteur sur bois et qu’un chemin de croix, à partir de ces mêmes mains sculptées en bois, se trouve dans l’église des Accates.
On remarquera qu’il a été nécessaire de faire un choix parmi les 14 stations habituelles de la via crucis, la chapelle ne comprenant que 11 baies.
En regardant les vitraux…
(Le texte de méditation est de Félix Girard)
Coté gauche
Chœur
Jésus est condamné à mort: «Mains de lumière et de miracles! Mains de Jésus… Mon Dieu! Mains gonflées de Souffrance… Données… Sans force aux liens que serrent nos péchés!»
Jésus est chargé de sa croix: «Votre croix qui va vous briser, votre main largement ouverte, votre main l’accepte et la prend».
Nef
Jésus tombe pour la première fois: «De votre main tendue, mon Dieu, puissiez-vous amortir nos chutes».
Jésus rencontre marie: «Communion suprême dans l’offrande! Main qui consacre et qui bénit!»
Simon de Cyrène aide Jésus a porté sa croix: «Est-ce le bois d’une charrue que soutient cette rude main?.. Pour quel sillon?.. Pour quelle pluie de sang?..»
Tribune
Jésus tombe pour la seconde fois: «Sous le poids de la lourde croix, incrustez vos doigts dans la terre, dans la chair de notre terre, de notre terre de misère que féconde votre douleur!»
Coté droit
Chœur
Jésus est mis au tombeau: «Vos pauvres mains d’enseveli, les avons-nous suffisamment lavées, lavées de pleurs, baignées de larmes… Vos pauvres mains de torturé! Vos pauvres mains aux plaies béantes, aux plaies vidées! Sources taries aux merveilleuses résurgences, aux résurgences de pardon! Saintes mains! Mains de lumière et de force, vous qui venez guider nos âmes aux splendeurs des résurrections!»
Jésus est cloué sur la croix: «Pour qui cette main qui broie? À qui cette main qui cloue? Est-ce moi? Mon Dieu?»
Nef
Jésus est dépouillé de ses vêtements: «Pour qui cette main qui arrache?.. À qui cette main de bourreau? Est-ce la nôtre?..»
Jésus tombe pour la troisième fois: «Heurté, brisé, forces vaincues, votre main ne vous sert de rien! Votre main écorchée. Aux cailloux du chemin… Votre main qui déjà se tend au supplice!»
Jésus console les femmes: «Ne pleurez pas sur la victime dans vos tristes mains désolées! Sur vous… Sur nous, Souillés!»
La réalisation
Ces vitraux ont été réalisés par l’Association Massalia VITRAIL, régie par la Loi de 1901, qui a été créée en 2006 par quelques amis animés par la passion du vitrail. Elle organise des formations (ludiques) à la technique du vitrail et accepte également quelques chantiers, uniquement pour faire face aux frais généraux de son exploitation.
Massalia Vitrail – 40 Rue de Lorette – 13002 Marseille Tél. 04 91 90 67 13. www.massaliavitrail.com
L’installation des vitraux
Sous la responsabilité de Massalia Vitrail, les vitraux ont été installés par la Société Azurbaie (Jean-Yves Ribiollet et Didier Maurel). Les vitraux côté droit ne donnant pas sur l’extérieur il a fallu les éclairer de l’intérieur, ce qui a été fait par une équipe d’anciens de l’œuvre conseillés par Georges Dubost.
Le chantier a débuté en octobre 2010 pour se terminer à la fin de l’année 2011.


Chemin de croix
Les fresques des quatorze stations du chemin de croix actuel sont dues à Gabriel Bougrain.
Gabriel Bougrain est né au Caire le 24 octobre 1915. Nous ignorons dans quelles conditions sa famille est arrivée à Marseille. Il est présenté à l’Oeuvre en décembre 1929.
Il a probablement commencé des études d’art à l’Ecole des Beaux-Arts de Marseille qui se trouvait alors, place Carli, tout en continuant de fréquenter l’Oeuvre. Pensionnaire de la Ville de Marseille au concours triennal de peinture en 1935, il poursuit ses études à l’Ecole des Beaux-Arts de Paris. Il est cité très brièvement dans le dictionnaire des arts plastiques modernes et contemporains de Jean-Pierre Delarge avec la mention Ecole des Beaux-Arts de Paris.
Il rédige pour Notre Echo d’avril 1937 le compte-rendu d’un voyage en Corse qu’il illustre largement.
Il commence à avoir une certaine notoriété puisqu’il expose au Salon d’automne de Paris en 1938
une nature morte. Il y exposera encore en 1943 et 1944. De 1903 à 1945, ce salon annuel qui réunissait des artistes de tous les horizons a été un événement majeur de la vie artistique française
C’est dans le cadre de la restauration de la chapelle en 1942 qu’a été réalisé le nouveau chemin de croix qui remplaçait des tableaux de médiocre qualité. Les maçons avaient préparé dans le mur quatorze petites niches en plein cintre avec un retrait de 4 à 5 cm; il lui revenait de réaliser un chemin de croix plus adapté. Chaque dessin était piqueté pour être reproduit dans la niche au moyen d’un sachet de poudre. Un certain nombre de stations portent soit sa signature soit ses initiales et quelquefois une date. Son travail s’est prolongé jusqu’en 1943.Ce chemin de croix fut béni par le Père Félix Ricard, franciscain, ancien de l’Oeuvre.
En 1950, Gabriel Bougrain est lauréat du prix Abd-El-Tif. Ce prix de peinture, créé en 1907 et qui a perduré jusqu’en 1961 permettait à de jeunes artistes de séjourner un an ou deux à la Villa Abd-El-Tif à Alger, devenue Maison des artistes, qui était un peu l’équivalent de la Villa Médicis. Le tableau pour lequel il a été lauréat, «Femmes de la Casbah» est probablement au Musée National des Beaux-Arts d’Alger.
Dans le cadre de «l’Exposition artistique de l’Algérie Française», il est présent à Monte Carlo en 1951 (tableau: « Joueurs de cartes») et à Constantine en 1953 (tableau: « Palmeraie») .Il expose également en 1956 à la galerie Comte-Tinchant à Alger qui avait été reprise par Edmond Charlot,
On perd ensuite sa trace, même si de temps en temps des dessins ou des peintures apparaissent en vente aux enchères ou sur internet. Nous savons toutefois qu’il décède le 4 décembre 1998 à Tournan-en-Brie (Seine et Marne).

Tableau de l’Adoration des Mages
400x300cm, date: 1824.
Restauration effectuée en 2000 par Francine Grisard.
L’auteur : Augustin Aubert fréquente le musée des Beaux Arts de Marseille très jeune, son père en étant un des administrateurs ; dès 1796 il suit les cours de l’école de dessin, avec son maître Joachim Guenin, jusqu’en 1802. Ensuite il fréquente l’atelier du peintre aixois Pierre Peyron.
Il revient à Marseille où il ouvre un atelier et deviendra directeur adjoint de l’école de dessin en 1806 puis directeur en 1810. En 1812 il est nommé à l’Académie de Marseille. Il reçoit une médaille d’or au Salon de 1817 pour « Le Premier Sacrifice de Noé à la sortie de l’Arche» ), que la ville de Marseille achète pour son musée (A.Alauzen: la Peinture en Provence, Marseille,La Savoisienne 1962 ; réédition Marseille ,Jeanne Laffitte , 1984).
L’oeuvre:
400×300 cm, datée: 1824. Restauration effectuée en 2000 pat F.Grisard.
Nous sommes en présence d’une Adoration des Mages très inspirée par celle de Rubens (photo ci-contre), peinte en 1634 (328 cm/249 cm) et conservée au King’s Collège à Cambridge.


Statue de l’Assomption de la Vierge
L’Assomption de Marie est l’événement au cours duquel la Mère de Jésus, au terme de sa vie terrestre, entre directement dans la Gloire du Ciel, âme et corps sans connaître la corruption physique qui suit la mort.
Cette conviction très ancienne dans les Eglises d’Orient (Dormition) et d’Occident est fêtée liturgiquement dès le VIIIe siècle. Elle a été érigée en dogme en 1950 par la Pape PIE XII. Pour les Chrétiens d’Orient l’Assomption reste une fête et non pas un dogme. Marie a toujours été fêtée le 15 août , date présumée de la consécration de la première église à Elle dédiée à Jérusalem.
Il est rare que les personnes qui visitent l’Œuvre ne remarquent pas la belle statue de l’Assomption de la Vierge Marie qui est dans une niche sur le côté droit de la chapelle ; par ailleurs, depuis le renouveau de la dévotion mariale encouragée par les derniers papes, les fidèles sont invités après la messe à se tourner vers la statue pour une oraison.
La Commission du Mémorial a consigné en 2015, dans la plaquette éditée lors de la restauration de l’orgue de la chapelle, les informations dont elle disposait sur cette statue. Elles provenaient de l’ouvrage Le directeur de la jeunesse ou la vie et l’esprit du serviteur de Dieu Jean-Joseph Allemand, publié en 1867 par l’abbé J.P. Gaduel (1811-1888) qui avait connu Monsieur Allemand et qui était, au moment où son livre fut édité, vicaire général de Mgr Dupanloup, évêque d’Orléans, auteur d’une des préfaces. Elles étaient également tirées de La Vie étonnante de Jean-Joseph Allemand, Apôtre de la Jeunesse, d’Henry Arnaud1 (1966). Selon ces deux sources, cette statue avait initialement été offerte en 1788 à la Société des Prêtres du Sacré Cœur qui animaient l’Œuvre du Bon Pasteur, par un de ses anciens membres retourné dans sa famille en Espagne. C’est dans cette institution, fondée en 1731, que Jean-Joseph Allemand avait trouvé sa vocation. La statue fut acquise pendant la Révolution par la famille Reimonet qui recueillait alors Jean-Joseph. Elle avait failli alors être gravement endommagée lors d’une visite de police, à l’issue de laquelle Jean-Joseph Allemand passa, en expiation des outrages qui l’avaient visée , une nuit en prière, les bras en croix2.
La Commission du Mémorial a pu récemment prendre connaissance des documents qui ont été utilisés par les biographes mentionnés. Ils donnent des éclairages supplémentaires sur cette statue et son histoire. Il s’agit du Coutumier3 des Prêtres du Sacré Cœur, et d’un recueil de notes manuscrites d’un neveu de l’abbé Reimonet. Ces documents sont dans les archives de l’Œuvre. D’autres informations sont également apparues à la lecture de documents jusqu’alors négligés ou inconnus, parmi lesquels une brochure publiée en 1902.
1. Le Coutumier des prêtres du Sacré Cœur relate les faits marquants de cette société, jusqu’à sa disparition en 1791. On y lit que la statue avait été offerte à l’Œuvre du Bon Pasteur par un certain Jean Galin qui l’avait fréquentée dans sa jeunesse puis était retourné dans sa famille à Carthagène4. Nous n’avons pu mieux cerner à quel titre Jean Galin avait séjourné à Marseille. l’Histoire des Prêtres du Sacré Cœur, rédigée en 1876 par le chanoine Brassevin, ne retient pas son nom dans la liste des prêtres de cette société. Il mentionne simplement que le donateur de la statue avait quelque temps exercé des fonctions de supérieur, sans doute dans l’une des congrégations qui formaient l’Œuvre du Bon Pasteur. La découverte récente de l’état nominatif des Charges5, c’est à dire des responsabilités, au sein de la congrégation du Très Saint Enfant Jésus, nous apprend que Jean-Baptiste Galin y fut élu conseiller et « anti-choriste » (?) pour l’année 1781, puis Supérieur en 1782. 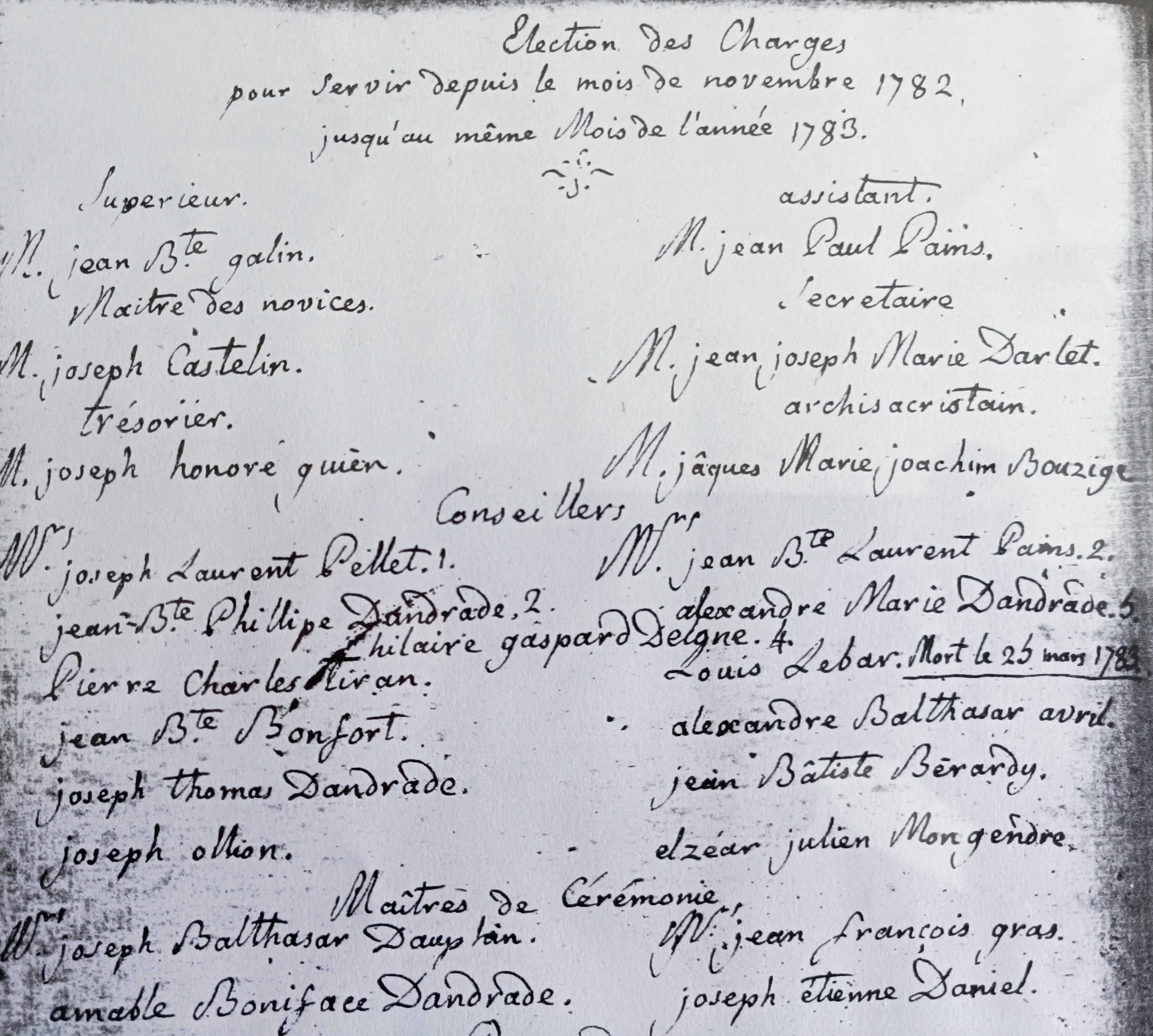 Dans la mesure où la congrégation accueillait ses membres seulement jusqu’à l’âge de dix-huit ans, on relèvera que la statue offerte six ans seulement après qu’il ait été supérieur de la Congrégation était l’expression de la reconnaissance d’un très jeune homme… ou de sa famille, dont nous ignorons encore quelle était l’activité6.
Dans la mesure où la congrégation accueillait ses membres seulement jusqu’à l’âge de dix-huit ans, on relèvera que la statue offerte six ans seulement après qu’il ait été supérieur de la Congrégation était l’expression de la reconnaissance d’un très jeune homme… ou de sa famille, dont nous ignorons encore quelle était l’activité6.
La qualité du don de Jean Galin fit que, bien que destinée à l’Œuvre du Bon Pasteur, la statue fut bénie et placée dans l’église des prêtres du Sacré Cœur le jour de l’Ascension 1789. Le Coutumier mentionne que la statue était due à Don Joseph Esteve, directeur de l’Académie royale Saint-Charles de Valence, « sculpteur renommé et jouissant d’un grand crédit à la Cour (d’Espagne) ». La statue, poursuit le Coutumier, « représente Marie dans son Assomption glorieuse, portée sur un nuage, entourée d’anges dont elle est la Reine et fixant ses regards vers le Ciel où se trouve son trésor ». Elle coûta « avec la couronne et autres frais… 2780 réaux ». En reconnaissance du don, la Congrégation s’était engagée à dire pour le donateur un Pater et un Ave… » toutes les fois que les statues de Marie sont exposées à la vénération ».
2. Les « Notes manuscrites sur Monsieur l’abbé Allemand… remises par Monsieur Henry Reimonet » permettent de mieux connaître l’histoire de la statue à partir du moment où a disparu la société des Prêtres du Sacré Cœur. Nous ne disposons que d’une photocopie de ces Notes , qui ne sont pas datées ; par ailleurs, on ne sait qui en fut le destinataire et le rédacteur. Il paraît probable qu’il s’agissait d’un des Messieurs de l’Œuvre, Henry Reimonet était un des neveux de l’abbé Reimonet. Sa famille avait recueilli Jean-Joseph Allemand pendant la Révolution. Il est vraisemblable que l’abbé Gaduel a travaillé à partir de ces Notes, comme le donnent à penser des annotations en marge du manuscrit. C’est dans ce manuscrit qu’est rapporté le récit de la journée dramatique au cours de laquelle la statue outragée fut défendue par une des tantes d’Henry Reimonet. On y apprend aussi qu’acquise comme bien national par un menuisier puis vendue en 1794 à la famille Reimonet, qui la conserva pendant la Terreur, elle fut transportée en 1804 de sa maison de la rue Bernard du Bois à une maison de campagne que la famille possédait à Saint-Louis. Là, elle fut prêtée quelques fois à la paroisse des Aygalades… Nous ajouterons à ces Notes, pour donner une idée des pérégrinations de la statue, qu’en 1809, elle fut vendue à Monsieur Allemand dont l’Œuvre était alors rue du Laurier ; on ignore où elle fut conservée pendant la fermeture de l’Œuvre de 1809 à 1814 ; elle fut transportée ensuite Place de Lenche, pour finalement être installée rue Saint-Savournin en 1820. En 1935, à l’occasion de l’Exposition catholique de Marseille, elle quitta la chapelle pour être exposée dans le stand de l’Œuvre, au Parc Chanot.
Ces informations ont pu être récemment complétées par la découverte d’autres publications, notamment l’ouvrage d’un historien de l’art sur l’auteur de la sculpture. Nous nous proposons de les présenter dans un prochain article.
- Henry Arnaud (1914-2000) ; membre de l’Œuvre Allemand ; on lui doit également en 1987 La vie rayonnante de Pierre Ruby » ( Supérieur de l’Œuvre de 1947 à 1971) et en 1988 ,« 1789 ; l’Eglise de Marseille dans la tourmente ».
- En mémoire de cet évènement ,il était jadis demandé aux jeunes gens, lorsqu’ils arrivaient à l’Œuvre, de prier quelques minutes devant cette statue, à genoux et les bras en croix.
- Coutumier : Cahier contenant les règles d’une congrégation ou d’une paroisse ainsi que la chronologie des activités .
- Carthégène : ville portuaire sur la côte Est d la province de Murcie, en Espagne .
- Cf. les rubriques sur les Charges et sur l’Œuvre du Bon Pasteur ,sur le site de l’Oeuvr5 Cf l’article sur les Charges qui peut être consulté sur le site de l’œuvre, rubrique Patrimoine.
- On peut supposer qu’elle était en rapport avec le négoce maritime car les relations commerciales entre Carthagène et Marseille étaient importantes au milieu du xviiie siècle.

Nous allons maintenant compléter ces informations par celle recueillies dans d’autres ouvrages et notamment dans celui consacré au sculpteur de la statue.
Il est ainsi apparu que le nom mentionné dans le Coutumier des Prêtres du Sacré-Cœur et repris par les biographes de Jean-Joseph Allemand, Don José Estève, était inexact. Nous l’avons en effet retrouvé sous le nom de Jose Esteve Bonet. Sa vie et son œuvre ont fait l’objet en 1971 d’un livre d’Antonio Igual Ubeda1, José Esteve Bonet, L’imaginaire valencien au xviiie siècle2. Ce livre contient, outre une biographie de l’artiste, le catalogue complet de ses œuvres, accompagné de notices sur les sculptures les plus remarquables… au nombre desquelles figure « notre » statue.
Fils d’un sculpteur de Valence, il y est né en 1741 et y mourut en 1802, après avoir été, à partir de 1781, directeur général de l’académie Saint-Charles de Valence. Son biographe considère que son œuvre traduit l’influence, notamment, du sculpteur espagnol José Vergara (1714-1776) ; « exerçant en tant que sculpteur d’œuvres sur des thèmes religieux, il a réalisé de nombreuses œuvres en bois, à la manière de l’imagerie baroque traditionnelle ». Certaines ont été détruites pendant la guerre civile espagnole (1936-1939) mais on en voit encore dans les cathédrales de Valence, de Seville, de Murcie, de Jerez de la Frontera… et dans la chapelle de l’Œuvre Allemand !
José Estève Bonet a réalisé cette statue à l’apogée de sa carrière ; on lit, dans son journal : « Décembre 1785. 23 (J’ai conclu) Une Vierge de l’Assomption de 5 Pals.(empans ?) avec un trône de nuages et 5 séraphins et 2 enfants anges, son socle et sa caisse (?)… commandée par Roverto, par l’intermédiaire du Sr. Don Prisco Nunès, commissaire de Marine pour la ville de Marseille, et qui reste (ou resta ?) à Carthagène ? 100 l (Livres ?), 50 s. (sous ?) ».
Peut-être s’agissait-il simplement de la mention d’une commande et la livraison eut-elle lieu un an plus tard car on retrouve en date du 22 décembre 1786 : « Une Assomption de 5 Pals. pour Marseille, avec trône de 5 séraphins (angelots) et 2 enfants et son socle, par l’intermédiaire de Don Simon Nunès, commissaire de Marine, payée par Don Simon Cassurrar, commandée par Don Juan Garin, commerçant à Carthagène. 100 L (livres ?), 50 s. (sequins ? sous ?).
A. Igual Ubeda note qu’il est curieux que Juan Galin ait choisi un sculpteur à Valence alors qu’il s’en trouvait de bons à Murcie, ville plus proche de Carthagène. Sans doute la renommée de Jose Esteve Bonet s’étendait-elle bien au-delà de Valence.
Nous ignorons par ailleurs par quel concours de circonstance A. Igual Ubeda a eu connaissance de cette statue qui n’est pas mentionnée dans d’autres ouvrages et dont il n’a vraisemblablement vu qu’une photographie.
Celle-ci représente la Vierge dont le visage s’inscrit dans une Gloire constituée de rayons. Cette gloire, qu’on peut voir sur la photographie qui accompagne la notice du biographe, est aujourd’hui remplacée par un nimbe étoilé ; on remarquera avec une certaine surprise que sur une autre photographie de la statue que contient une brochure de souvenirs publiée par d’anciens membres de l’Oeuvre en 1902 et que nous avons également récemment retrouvée… la Vierge ne portait ni Gloire, ni nimbe d’étoiles…
Plus intéressantes sont les observations d’Igual Ubeda sur la statue. Il note qu’Esteve « s’abandonne à la plus pure tradition baroque(.) Le mouvement d’ascension, d’élévation vers le ciel s’exprime par la position des bras de la Vierge ouverts comme des ailes, ainsi que par le tourbillon des enfants et des cinq séraphins qui l’entourent (…) dans les plis flottants du manteau et les volutes des nuages… » Il note également « le soin délicat des bordures du manteau et le semis de fleurs sur la tunique ». Le groupe sculpté mesure 1,20 m de haut et 0,80 m de large ; la faible profondeur (0,50 m) permet de penser qu’il a dès l’origine été conçu pour être placé dans une niche ou contre un mur.
La statue a récemment bénéficié de l’examen qu’en a fait Élisabeth Mognetti, conservateur général du Patrimoine et ancienne directrice scientifique du CICRP3. Elle confirme qu’il s’agit d’une œuvre de qualité, en bon état de conservation. Le bois massif présente quelques petites fissures, mais on n’y relève pas de signe d’infestation. Elle note qu’un des séraphins, sous le pied droit de la Vierge a disparu et que certains d’entre eux ont perdu leurs yeux en verre qui donnent une belle intensité au regard. Quelques détails, comme la coloration de la frange du manteau, ou celle des nuées du trône revêtues de peinture dorée, donnent à penser que le groupe a pu être partiellement repeint, peut être en raison d’altérations subies à l’époque révolutionnaire mais dont on ne voit plus la trace, dans une esthétique qui pourrait être celle du début du xixe siècle, à l’exception du visage et des mains de la Vierge. L’ensemble mériterait un dépoussiérage par un intervenant qualifié et peut-être serait-il préférable de restituer à la Vierge une Gloire exprimant son Assomption plutôt que d’une couronne d’étoiles qui fait plutôt référence à la femme de l’Apocalypse4 ou à la Vierge de l’Immaculée Conception. Élisabeth Mognetti considère que l’œuvre est très représentative du style baroque finissant, qu’expriment le mouvement un peu affecté des doigts et la délicate carnation du visage.
•••
Peut-être découvrirons-nous plus tard qui fut Jean Galin qui eut la reconnaissance d’offrir cette statue à cette Œuvre à qui il devait tant et dont la sûreté de goût lui fit choisir José Esteve Bonet. L’important est que nous puissions, en nous tournant vers la statue de la Vierge Marie, nous remémorer les vertus qui lui ont valu cette Assomption mais aussi nous rappeler le sens de l’institution que nous fréquentons ou qui nous y a accueillis.
Commission du Mémorial
Association des Anciens
PS. Nous remercions Mme Élisabeth Mognetti pour son expertise ainsi que MM. Jean-Pierre Girousse et Arturo Juanco pour leurs traductions de l’ouvrage d’A. Igual Ubeda.
- Antonio Igual Ubeda (1907-1983) Historien de l’art.
- Ce livre, rédigé en espagnol, nous a été prêté par l’Université de Pau qui détient les deux exemplaires de l’ouvrage qu’on peut consulter dans des bibliothèques publiques.
- CICRP : Centre interdisciplinaire de Conservation et de restauration du patrimoine.
- Apocalypse de saint Jean, chapitre 12
Orgue Ducroquet
Le 26 octobre 1850 eut lieu la bénédiction solennelle de l’instrument par Monseigneur de Mazenod, évêque de Marseille. L’orgue est alors joué alternativement par Louis Bignon, organiste de Notre-Dame du Mont, et G. Genoud, organiste des Chartreux. Un document d’archives relate scrupuleusement les moindres détails de cet événement.
Cet orgue financé grâce à une souscription, est sorti des ateliers de la Maison Ducroquet à Paris, laquelle avait déjà livré, trois ans auparavant, un grand orgue à Notre-Dame du Mont. Au départ, c’est un petit orgue romantique de 11 jeux sur 2 claviers et un pédalier, initialement destiné à l’église des Chartreux. Quelques jeux sont ensuite ajoutés en 1860 par Théodore Sauer: l’orgue comporte alors 16 jeux.
Sa composition initiale
- Le buffet mesure 3m 84 de large, 2m 54 de profondeur, sa plus grande hauteur jusqu’à la croix qui la couronne est de 5m 10; la surface au sol est de près de 10m². La façade en bois de noyer possède trois tourelles, le reste du buffet est en sapin.
- L’orgue possède deux claviers de 54 notes (plaquées ivoire et ébène) et un pédalier de 18 notes en «beau chêne». La tuyauterie du 2e clavier, le Récit, est enfermée dans une «boîte expressive» en sapin.
- L’instrument possède 5 pédales de combinaison. La 1re est l’accouplement qui permet de réunir le 2e clavier «Récit» sur le 1er «Grand Orgue». La 2e permet d’accoupler le Grand Orgue sur lui-même à l’octave grave. Les 3e et 4e «font sortir et entrer le plein jeu et la trompette», la 5e agit sur la boîte expressive.
- Le Grand Orgue possède 7 jeux (de la note la plus grave à la note la plus aigüe) avec places sur le sommier (caisse d’air sur laquelle sont disposés les tuyaux) pour l’ajout d’un Clairon et d’un Euphone.
- Le Récit «expressif» a 3 jeux avec place sur le sommier pour un hautbois ou une voix humaine et une flûte de 8
Les divers relevages
Pendant trois décennies, l’instrument fonctionna à la satisfaction de tous. Les responsables de l’Œuvre ont eu certainement à cœur son entretien régulier (accords, réglages de la mécanique, colmatage des fuites d’air…).
En 1880, le facteur marseillais François Mader procède à une importante restauration et augmente ses possibilités sonores en le portant à 19 jeux :
- Installation d’une machine pneumatique pour compenser la dureté des touches.
- Modification de la console.
- Installation d’un pédalier de 27 notes avec un bourdon de 16 pieds.
- Réfection du sommier du récit.
- Changement de certains jeux.
En 1943-1945, la manufacture Jacquot-Lavergne de Rambervilliers agrandit encore l’instrument (23 jeux) et procède à une restauration qui va modifier l’instrument d’une manière irréversible. L’orgue se rapproche de l’esthétique néo-classique:
- Installation d’un système de transmission électrique commandé par une nouvelle console tournée vers le choeur.
- Avancée du buffet pour pouvoir donner plus d’importance à la pédale qui passe de 27 à 30 notes.
- Ajout d’un certain nombre de combinaisons (accouplements, tirasses) grâce au système électrique.
En 1962, Jean-Albert Negrel, facteur d’orgue de Roquevaire, déplace la console sur le côté pour permettre à la chorale d’être mieux disposée. Certaines sonorités sont modifiées selon le goût de l’époque.
Au service des offices liturgiques qui se déroulent dans la chapelle, l’orgue a également été joué à l’occasion de divers concerts tant sacrés que profanes accompagnant souvent la chorale; il a même accueilli un temps la classe d’orgue du Conservatoire de Marseille. Il a permis à de nombreux jeunes de s’ouvrir à la musique, à certains de se découvrir une vocation et aux plus doués d’entre-eux d’embrasser une carrière musicale.
Malheureusement, pour différentes raisons, l’orgue s’est tu voilà plus de 35 ans et il devenait plus qu’urgent de procéder à une rénovation la plus complète possible. En 2013, la Communauté des Messieurs de l’Œuvre, soutenue et aidée par l’Association des Anciens, a décidé de se lancer dans ce chantier en lançant une souscription complétée par l’Œuvre et en organisant 3 concerts de soutien.
Au-delà du travail de restauration, les travaux réalisés sont :
- La rénovation de la soufflerie.
- La transmission électro-pneumatique de 1943 a été remplacée par une transmission numérique.
- L’étendue des claviers a été portée de 54 à 56 notes.
- L’installation d’une console neuve dans la nef.
- La pose d’un combinateur permettant d’enregistrer à l’avance des mélanges de jeux.
- La restauration de toutes les parties en bois.
L’Orgue a ainsi retrouvé sa voix ou plutôt ses voix puisqu’il comporte très exactement 1259 tuyaux. La transformation de 1962 en orgue néo-classique a été très intelligemment réalisée, en effet, l’éclaircissement des sonorités s’est fait en préservant la plupart des sons romantiques, ce qui est rarement le cas. On peut ainsi jouer la musique du XIXe siècle ainsi que la musique ancienne allemande et française et aussi celle du XXe.


Tombeau de Jean-Joseph Allemand
Les funérailles de Jean-Joseph Allemand, décédé le 10avril 1836, ont eu lieu le 12avril, rassemblant une foule immense avec une messe, corps présent, dans l’Église de St-Vincent-de-Paul qui n’était pas encore celle que nous connaissons.
Le corps fut déposé provisoirement dans un caveau du cimetière St-Charles et transféré, peu de temps après, dans le monument que les membres de l’Œuvre érigèrent à leur Saint Fondateur, au moyen d’une souscription. Sur ce monument, on lisait une inscription latine dont la traduction est :
«Ici repose Jean-Joseph Allemand, prêtre de la Société du Sacré-Cœur de Jésus, Fondateur de la pieuse Congrégation de la Jeunesse; qui, embrasé du zèle d’Elie pour le salut des âmes des jeunes gens, put dire comme (St) Paul: je donnerai tout, et je me donnerai moi-même pour le salut de vos âmes. À ce bien-aimé Père, qui fut un homme simple et d’un cœur droit, les enfants qu’il engendra en Jésus-Christ ont élevé ce modeste monument.»
Trois mois après son décès, le 13juillet 1836, son cœur, enfermé dans une boîte en plomb, fut placé dans l’urne qui domine le monument érigé en son honneur dans la chapelle de l’Œuvre. Sur la pierre, on grava ces mots : « Omnibus omnia factus sum ut omnes facerem salvos : je me suis fait tout à tous, pour sauver tout le monde ».
Quelques années avant la fermeture et l’abandon du cimetière St-Charles, qui devait disparaître totalement en 1876, ses restes ont été transférés dans un caveau au pied du monument, le 25novembre 1868, comme le rappelle la plaque.
L’emplacement fut un temps protégé par une grille, dessinée par Monsieur Émile Perrault, architecte (Église des Trois Lucs, du Redon, de Belcodène…) et Monsieur de l’Œuvre.
Sources :
- Abbé Pontier, Éloge funèbre de messire Jean-Joseph Allemand, prêtre, directeur de l’Œuvre de la jeunesse, prononcé le 13juillet 1836, à la cérémonie de la déposition de son cœur dans le Monument érigé dans la chapelle de l’Œuvre, Marseille, Imprimerie de Marius Olive, 47rue Paradis, 1836, 31 p.
- Abbé Gaduel, Oraison funèbre de M. Jean-Joseph Allemand, fondateur de l’Œuvre de la jeunesse de Marseille (1772-1836), prononcée le 25novembre 1868, dans la Cathédrale de Marseille à l’occasion de la Translation de ses restes mortels, du cimetière Saint-Charles, dans la chapelle de son Œuvre…, Marseille, Veuve Chauffard, Libraire, 20 rue des feuillants, 1868 30 p.
Ces deux brochures se trouvent dans la vitrine 5 du Musée.
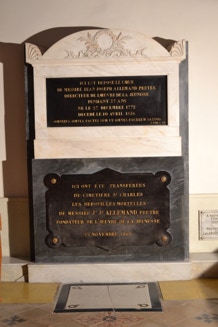
Le lutrin en forme d’aigle
Les moins curieux de ceux qui sont venus dans la chapelle depuis le mois d’avril auront sans doute remarqué à la tribune une imposante sculpture en bois représentant un aigle. Sa présence mérite quelques explications.
Il s’agit , en effet, d’un lutrin en forme d’aigle. Le lutrin est un pupitre de lecture sur lequel on posait évangéliaires et antiphonaires (c’est-à-dire les recueils des partitions grégoriennes de la liturgie des Heures). D’après les archives, l’Œuvre a fait l’acquisition de ce lutrin en 1842. On ignore quand il fut réalisé et qui en est l’auteur, s’il s’agit d’une commande de l’Œuvre ou s’il s’agit de l’achat d’une œuvre réalisée pour une autre communauté religieuse. Felix Delobre, Monsieur de l’Œuvre de 1854 à 1907 et supérieur de la Communauté de1885 à 1895, a laissé une Histoire (manuscrite) de l’Institut de l’Œuvre de la Jeunesse. On y lit qu’en 1860, le lutrin était placé devant la grande porte de la chapelle qui s’ouvrait dans le mur qui fermait la chapelle à l’ouest (à la hauteur du tombeau de Monsieur Allemand ) et qui a été démoli lors de l’allongement de la chapelle; cette porte ne servait pas puisqu’on entrait et sortait par la porte latérale. La grande porte, qui donnait sur une petite cour (à l’emplacement du vestibule actuel de la chapelle et de la première travée), n’était ouverte que pour faire de celle-ci une annexe pour les parents, le jour de la Première communion . C’est cette petite cour qui fut ouverte et qui donna, en longueur, une travée de plus à la chapelle. Après les travaux de 1860, le lutrin fut placé sur le côté gauche de la chapelle, autrefois côté de l’Evangile, près de la statue de l’Assomption de la Vierge (aujourd’hui, dans la niche côté droit). On perd ensuite un peu la trace du lutrin, qui fut plusieurs fois déplacé et qui finit par être conservé au musée.
Tenant compte du caractère exceptionnel de ce lutrin, l’équipe du Mémorial a proposé à la direction de l’Œuvre de l’exposer à la tribune de la chapelle pour qu’il continue d’interpeler tous ceux qui le voient.
Composé de plusieurs éléments en bois, superposés et pivotants, le lutrin mesure 2,06 m de haut (dont 0,48m pour l’aigle ) et 0,86m de large. Une base, reposant sur quatre pieds en bois naturel sculptés de feuillages, supporte une ove peinte couleur vert Empire, décorée de douze cabochons dorés; au-dessus s’élève le fut du lutrin, décorée de palmettes; la hampe est ceinte de trois couronnes, représentant, la première, un motif floral inclus une décoration sinueuse, une autre des pampres et pour la dernière, des fleurs quadrilobées. Au sommet, s’épanouit une gerbe de palmes décorée de trois croix dorées, que surmonte une sphère peinte en bleu supportant l’aigle tenant un serpent dans ses serres. À noter que deux éléments du corps de serpent font défaut et que la sphère représentant la Terre a été, on ne sait quand, (mal) repeinte, comme en témoignent des traces de peinture bleue sur une aile. La sculpture en ronde bosse de l’aigle, ailes déployées, est particulièrement délicate; sur les ailes est fixé le petit pupitre en fer destiné à recevoir les ouvrages qui devaient être lus.
L’aigle choisi pour porter l’Évangile tient dans ses serres un serpent, symbole du Mal depuis la Genèse. La majesté de l’animal, sa vue perçante et les hautes régions dans lesquelles il évolue renvoient au Ciel et à la majesté de Celui qui l’habite. La capacité, qui lui était attribuée autrefois, de pouvoir fixer le soleil en face , en fait un symbole de l’aptitude à la contemplation. Attribut de l’évangéliste saint Jean, l’aigle invite à la contemplation des réalités éternelles; il est signe d’ascendance et il invite au dépassement.
En sortant de la chapelle, c’est en quelque sorte un ultime encouragement que nous pourrons puiser en élevant notre regard vers l’aigle de la tribune.

Statue de Jean-Joseph Allemand
La statue en marbre de Jean-Joseph Allemand a été réalisée dans le cadre du 1er centenaire de l’Œuvre, donc en 1899. Elle a été offerte par les Grands de l’Œuvre alors que les anciens avaient lancé une souscription pour offrir l’ostensoir. C’est au sculpteur François Carli qu’échut la commande.
François Carli (1872-1957) est le frère cadet d’Auguste Carli (1868-1930). Celui-ci est connu notamment pour une partie des sculptures du grand escalier de la gare Saint-Charles (Marseille, porte de l’Orient, et Marseille, colonie grecque) ou Sainte Véronique et le Christ, dans la cathédrale de la Major. Leur père avait un atelier de moulage, rue Jean-Roques, qu’il reprend. Il enseigne cette matière à l’École des Beaux-Arts de Marseille. Parallèlement, il mène une carrière de sculpteur, plus précisément dans le domaine religieux: nombreuses œuvres pour les églises et les tombeaux. La place qui se trouve devant le Palais des Beaux-Arts, actuel conservatoire et ancienne Bibliothèque Municipale et École des Beaux-Arts porte le nom d’Auguste et François Carli.
Un journaliste qui signe E.R (qui est probablement Elzéard Rougier, journaliste, écrivain, critique d’art et défenseur des santons marseillais – il a longtemps habité au 53, cours Franklin Roosevelt et un bas-relief de Maurice Mangepan-Flégier y rappelle son souvenir) décrit le travail du sculpteur dans Le Petit Marseillais du 9mai 1899:
«François Carli, en effet, n’excelle pas uniquement dans l’art d’imiter les chefs-d’Œuvre de la plastique ancienne et moderne, il sait créer, quand il le veut, une œuvre de toutes pièces et avec une habileté consciencieuse et très personnelle…
Le saint prêtre est représenté grandeur nature, assis au bord de son pauvre fauteuil, le buste penché, la figure illuminée par la pensée intérieure, dans la pose qui lui fut habituelle. Sous la soutane on distingue la maigre anatomie de son corps usé par les veilles et les privations. Ses mains sont longues et minces, d’un modelé admirable. De l’ensemble de l’œuvre il se dégage une harmonie sincèrement religieuse, une vérité d’expression extraordinaire. C’est bien l’abbé Allemand ascétique et détaché de toutes les choses d’ici-bas.»
Le 10mai eurent lieu la bénédiction et l’inauguration officielle:
«Arrivé devant la statue du saint Prêtre, le R.P. aumônier ayant commencé les prières de la bénédiction, une main d’artiste enleva délicatement la toile qui, jusqu’à cet instant, la recouvrait, les traits vénérables de Monsieur Allemand apparurent en ce moment aux regards émerveillés et émus de ses enfants…
En ce moment, un silence profond régnait dans la salle, on entendait seulement la voix du prêtre qui récitait les prières de la Sainte Liturgie et qui, s’éloignant avec ses trois servants, continuait la cérémonie de la bénédiction des nouveaux locaux.
Pendant ce temps, les jeunes gens, et nous avec eux, étant toujours réunis dans le vestibule de la chapelle, autour de la statue de notre vénéré fondateur, le 1er choriste entonna le cantique “Heureux qui d’un cœur docile”. Le couplet repris en chœur par tous les assistants, servit de refrain à quelques couplets composés pour la circonstance chantés par le 1er choriste seul…»
(Extrait de la relation manuscrite du 1er centenaire de la fondation de l’Œuvre mai1799 – mai 1899 conservée dans les archives).
La manifestation la plus importante du centenaire eut lieu le 28mai et sa solennité est largement décrite dans cette relation.
Cette sculpture vaudra à son auteur une médaille de bronze au Salon des artistes français en 1920. La mention est portée sur le socle arrière avec une erreur de datation: 1921 C’est la seule récompense qui ait été attribuée à l’art religieux, section de sculpture.
François Carli réalise une réduction de l’Œuvre de 0,30cm de hauteur en plâtre qu’il vend 10F. S’il s’agit d’un souvenir pour les acquéreurs, c’est également un moyen de financer la taille du marbre. Il est probable que c’est le modèle qui est présenté dans une des vitrines du Musée.

Mémorial et Musée Jean-Joseph Allemand
Aucune archive spécifique n’existe sur la création du Musée et sur l’origine des objets. En 1868, lors du transfert des restes du fondateur dans la chapelle, les vêtements sacerdotaux dans lesquels il avait été inhumé furent soigneusement conservés dans une vitrine de l’oratoire. C’est en 1907 que ces vêtements furent placés dans une châsse et exposés dans la chambre reconstituée de Monsieur Allemand. On peut penser que c’est à cette époque que le Musée fut organisé.
Une carte postale, extraite d’un carnet édité par les éditions Tardy, à l’occasion de l’exposition catholique de Marseille (mai-juin 1935) représente le Musée. L’Œuvre avait à cette exposition un stand réalisé par Monsieur Perrault, architecte et membre de la Communauté des messieurs.
Dans la perspective du bicentenaire (1999), la volonté a été de prolonger le Musée en créant un Mémorial présentant outre la biographie du fondateur, les activités de l’Œuvre, les autres œuvres et structures proches, le périodique Notre Écho, la Communauté des Messieurs… Ce Mémorial est en cours d’actualisation… Le Musée actuel regroupe le Trésor ainsi que le cabinet de travail et la chambre mortuaire de Jean-Joseph Allemand et le Mémorial. Ce trésor est quelque peu comparable aux trésors des églises puisqu’il comprend des vêtements et objets liturgiques… mais aussi des documents originaux relatifs aux différentes étapes du fondateur (en particulier attestation d’ordination, autorisation de Mgrde Cicé de 1804, actes d’état civil…). Nombre de ceux-ci ont été retranscrits ou traduits. On trouve également des portraits de JJA (tableaux la plupart non datés et non signés et gravures), mais aussi des pères Dandrade (1704-1762) et Truilhard (1689-1749) membres de la congrégation du Sacré Coeur ainsi que de l’abbé Reimonet (1767-1803), maître et ami.
Sont conservés près de 80 titres d’ouvrages religieux (biographies, ouvrages de piété, Écriture sainte des XVIIe, XVIIIe et XIXesiècles) dans le Musée, mais aussi dans le cabinet de travail. Certains sont annotés de sa main et pouvaient donc lui appartenir. Nombreux sont ceux qui possèdent un ex-libris (marque d’appartenance). Un inventaire a été établi. Deux in folio, imprimés par l’imprimeur Plantin à Anvers en 1606 et 1702? sont également présentés.
L’oratoire de la grande cour
On prête généralement peu d’attention, sans doute du fait de son emplacement, à l’oratoire qui est contre le mur Sud de la cour de l’Œuvre qui domine la rue Jaubert. La question s‘est posée de savoir quand il a été édifié , car il n’apparaît pas sur la gravure qui représente la cour de l’Œuvre vers 1850. On y voit en effet la salle de gymnastique, devenue salle de cinéma puis de spectacle qui n’a été bâtie qu’en 1846. À l’emplacement du mur que nous connaissons se trouve la « balustrade en fer à hauteur d’appui » qui est mentionnée dans l’acte d’achat par Monsieur Allemand en 1820. On se souviendra qu’alors le terrain se continuait vers le sud par des restanques qui ont disparu lors du tracé de la rue Jaubert au milieu du xixe siècle.
La même gravure montre également qu’à cette époque s’élevait sur le côté ouest de la cour, à la hauteur du calvaire actuel, un édifice assez important. Il s’agissait sans doute du premier monument à la sainte Vierge. Sa construction avait été décidée par le Conseil de la Communauté qui, le 30 août 1840, avait adopté « le projet de couronner les travaux d’embellissement réalisés dans l’Œuvre (notamment la construction des deux ailes flanquant le bâtiment acquis en 1820) par l’édification d’un beau monument à la très Sainte Vierge, dans le bosquet de droite ». L’oratoire proprement dit, coiffé d’une toiture en forme de pomme de pin, s’inscrivait, semble-t-il, dans une colonnade circulaire, mais nous ne disposons pas d’image plus précise. Nous n’avons pas trouvé trace de la date à laquelle ce monument fut démoli, sans doute pour agrandir les espaces de jeux.
En revanche, nous savons que la décision de construire l’oratoire que nous connaissons fut prise par la Communauté des Messieurs en 1878 et le 23 Mai 1880, Mgr Robert, évêque de Marseille « inaugura l’Oratoire de la Très Sainte Vierge dont le plan et l’exécution avaient été confiés à Messieurs Tourret et Rey. »
L’oratoire
Adossé au mur qui surplombe la rue Jaubert, l’oratoire mesure 5 mètres de haut et 3,5 m de large. Il a été construit en « pierre du Midi », nous indique Jean Philip, professeur émérite de géologie à la Faculté des Sciences de Marseille. Cette pierre, qui bénéficie actuellement d’une IGP (!), est une roche calcaire d’origine marine, de couleur uniformément grise et de texture relativement grossière. Elle est riche en débris coquilliers, aisée à tailler et à sculpter. De nombreux édifices marseillais, tels que le Palais de la Bourse ou la Préfecture, sont en pierre du Midi. Il pourrait ici s’agir d’une pierre extraite des carrières de Rognes ou des Alpilles .
L’oratoire comprend trois parties :
Au centre, une niche semi cylindrique de 1,5 m de hauteur, de 0,7 m de largeur et de 0,40 m de profondeur, encadrée de part et d’autre par un colonnette de style composite précédée des dés en pierre sur lequel étaient scellés des vases destinés sans doute à l’ornementation florale ; un arc dentelé souligne le sommet de la niche voutée en cul de four. La niche abrite une statue représentant la Vierge Marie ; la tradition veut qu’il s’agisse de la scène de l’Annonciation.
Surmontant cette niche, un fronton triangulaire sur lequel était scellée une croix en pierre , se prolonge par deux pilastres engagés qui encadrent le monument.
L’ensemble repose sur un soubassement en pierre du Midi.On distingue avec peine trois inscriptions gravées dans la pierre, partiellement effacées par l’érosion du temps et sans doute aussi par les jets de ballons qui ont pu atteindre le monument.
La statue
L’élément essentiel de l’oratoire est une statue de la Vierge Marie à qui le Conseil, en 1877 a décidé de consacrer le monument. La statue est en marbre blanc, d’un grain très fin. Sculptée en ronde bosse (c’est-à-dire qu’elle est détachée du fond et qu’elle repose sur un socle) elle mesure 1,2 m de haut, 0,37 m de largeur et 0,40 de profondeur .Elle représente une jeune femme en pied qui croise les mains sur sa poitrine. La tête, sans nimbe ni auréole, est couverte d’un voile. Elle est légèrement inclinée sur l’épaule gauche. Le visage est levé et les yeux regardent au loin. La chevelure, retenue en bandeaux, et la finesse du cou lui confèrent une allure noble. Le sujet, en appui sur la jambe gauche, porte une robe à manches longues nouée à la taille qui descend jusqu’aux pieds. Un pan du manteau, posé sur les épaules et qui recouvre partiellement la robe, est retenu dans la ceinture. Les drapés de la robe et du manteau sont traités avec une grande habileté. Un examen récent a permis de découvrir que la Vierge foule aux pieds en serpent dont la queue, comme la langue, se terminent par une pointe dentée.
La statue repose sur un socle en pierre du Midi sur lequel on peut relever, sculpté, le cœur percé de flèches du Sacré Cœur, surmontant un écusson actuellement impossible à déchiffrer, et une tête d’ange. On distingue au-dessous des inscriptions qui seront analysées plus loin.
Sur le côté droit du socle de la statue , on découvre , gravé, « dn.que.Molchnekt.1844 ». Cette statue est donc signée et datée.
Nous savons ainsi que l’œuvre, datée de 1844, est de Dominique Molknecht. Ce sculpteur eut une assez grande notoriété au xixe siècle, puisqu’entre autres commandes, il participa à la décoration du Palais du Quai d’Orsay lorsqu’il fut édifié pour le ministère des Affaires Etrangères.
Dominique Molknecht était né sujet autrichien dans le Val Gardena en 1793. Il fut élève du grand sculpteur Antonio Canova. Installé en France en 1827, où il mourut en 1876, il a travaillé pour les plus grandes églises parisiennes, pour le théâtre Graslin à Nantes et a réalisé diverses sculptures qu’on peut voir encore tant en France qu’en Italie.
Nous avons cherché à savoir à quelle date et dans quelles circonstances cette statue d’un sculpteur qui bénéficiait alors d’une grande notoriété était parvenue dans notre Œuvre. Peut-être était-ce une copie d’une statue qui fut présentée au Salon de 1843 ? Nous n’avons pas trace de cet achat dans les archives de l’Œuvre. Peut-être la statue a-t-elle été offerte à l’Œuvre ? En tout état de cause, il semblerait que sa destination première dans l’Œuvre n’était pas cet oratoire, qui n’était pas encore construit, mais la chapelle des Anges qui fut aménagée en 1851 au deuxième étage de l’aile Est. Une photographie des années 1930 la montre derrière l’autel. La chapelle disparut dans les années 1975/1980. On ne sait où fut entreposée la statue. On ne sait pas non plus à quelle date elle fut installée dans l’oratoire de la cour ; son positionnement imprécis dans la niche confirme qu’elle n’aurait pu être ainsi placée à l’origine. Cette installation relativement récente nous a donc amenés à nous demander ce qu’on pouvait voir dans l’oratoire avant que la statue Molknecht y soit déposée. Des photographies prises dans les années 1930 montrent qu’il y avait là une reproduction de celle de la chapelle des Anges. Elle était légèrement plus haute que celle qui s’y trouve et mieux adaptée au volume de la niche. Sans doute avait elle été sculptée dans la même pierre du Midi, assez tendre, que les autres éléments de l’oratoire et était-elle très abîmée ? À moins qu’elle n’ai pu résister à quelques tirs malencontreux de ballons de foot. N’oublions pas que le terrain était autrefois orienté nord-sud. Nous préférerons mettre en cause la nature de la pierre qui a, en effet, favorisé l’effacement des inscriptions que portait l’oratoire.
Les inscriptions sur l’oratoire
1/ Une photographie des années 1930 permet de lire sur le socle placé sous la statue : Cor Mariae Immaculatum, ora pro nobis : « Cœur Immaculé de Marie, priez pour nous » ; l’inscription est surmontée d’une sculpture représentant le Sacré Cœur.
2/ Plus lisible est, gravée sur une baguette en marbre placée sous la niche, l’invocation que le Conseil a décidé dans sa séance du 17 décembre 1879 d’y faire figurer :« O Marie, conçue sans pêchés, priez pour nous ». Ceci conduit à se demander si cette statue longtemps considérée comme une représentation de Marie au jour de l’Annonciation, n’est pas plutôt à rattacher au dogme de l’Immaculée Conception qui avait été proclamé en 1854. Le fait que la Vierge soit représentée écrasant de son pied le serpent du démon nous paraît étayer l’hypothèse, mais des avis plus autorisés que le nôtre seront bien venus.
3/ Sur le soubassement, on déchiffre avec difficultés : « 40 jours d’indulgence », ce qui, aujourd’hui, est difficile à comprendre. Il faut, pour cela, relier cette mention à l’invocation à Marie. C’est cette invocation , cet acte de foi en son Immaculée Conception, qui peut permettre au chrétien de bénéficier d’une « indulgence », c’est-à-dire d’un effacement partiel du mal que ses pêchés ont causé.
On est aujourd’hui moins sensible à ce que l’Eglise appelle les « Indulgences ». Le Catéchisme de l’Église catholique de 1992 rappelle qu’il s’agit de grâces dont peut bénéficier le pêcheur pardonné pour réparer les conséquences de sa faute. Le sacrement de réconciliation qu’il reçoit rétablit bien la confiance que lui accorde le Christ, mais il n’affecte pas les effets que son péché a pu avoir sur le cours de sa vie ou sur celui d’autres personnes. La possibilité d’obtenir une indulgence encourage le croyant dans la voie de la perfection. Autrefois, dans le prolongement de la logique de l’Ancien Testament proportionnant le châtiment à la faute, les indulgences ouvraient droit à une rémission quantifiée ; à telle « bonne action » devait être attaché tel encouragement, ce qui explique l’indication « … jours d’indulgence » .
•••
Lorsque nous jouions à la « balle au pied » devant l’Oratoire, sans nous soucier des outrages que causait au monument la balle bourrée de crin sans cesse recousue par Monsieur Chabert, nous n’avions sans doute pas réellement conscience de bénéficier de cette protection qui, à n’en pas douter, s’étend depuis près de 200 ans certainement sur nos jeux de cour et, sans doute, bien au-delà.
Commission du Mémorial
Association des Anciens
Les « Charges » à l’Œuvre
Il y a un peu plus d’un demi-siècle disparaissait la tradition de la « proclamation des charges » le deuxième dimanche de novembre, qui remontait aux premières années de l’Œuvre. On nommait « charges » les divers services que les membres de l’Œuvre étaient appelés à rendre. Elles étaient, pour l’essentiel, en relation avec les offices religieux qui structuraient alors la vie de l’Œuvre.
Dès 1801, alors que l’Œuvre était à peine installée rue du Laurier, nous dit l’abbé Gaduel, un des premiers biographes de Monsieur Allemand, « afin d’intéresser et d’attacher davantage à l’Œuvre (les plus fidèles de ses membres), Monsieur Allemand avait établi divers dignitaires, un supérieur, un assistant, un maître des novices et même un trésorier… ». Ce fut là l’origine des charges, inspirées de celles que Monsieur Allemand avait connues à l’Œuvre du Bon Pasteur qu’il avait fréquentée lorsqu’il était adolescent. Nous nous proposons d’évoquer ultérieurement quelles étaient les différentes catégories de charges à l’Œuvre du Bon Pasteur.
Lors de la réouverture de l’Œuvre en 1814 après les cinq années de fermeture imposées par le régime napoléonien, Monsieur Allemand les rétablit. Par la suite, chaque année, le second dimanche de novembre, nous dit encore l’abbé Gaduel, Monsieur Allemand nommait un supérieur et un assistant, un maître des novices, un trésorier, vingt-quatre conseillers, vingt-quatre sacristains et un nombre plus ou moins grand d’infirmiers, de portiers, de choristes et de lecteurs. « Sur chacune de ces charges, il disait quelques mots agréables et édifiants ; les conseillers, il les comparait aux vingt-quatre vieillards de l’Apocalypse, les sacristains, aux anges qui dans le ciel entourent le trône de Dieu. Au sujet des portiers et des lecteurs, il faisait remarquer que dans l’Église ces offices sont des ordres ecclésiastiques. Parmi toutes ces charges, il y en avait qui n’étaient guère qu’honorifiques comme celles de conseillers, car le conseil ne se réunissait qu’une fois l’an, et il n’était pas long… Le sage directeur les avait multipliées au-delà des besoins, afin d’honorer les jeunes gens et de les intéresser à l’Œuvre ».
Le même biographe ajoute plus loin » : « (Monsieur Allemand) faisait considérer comme un bonheur et un grand honneur de répondre à la messe, d’avoir soin de la chapelle et de la sacristie, de parer l’autel, de remplir les offices de lecteurs et de choristes, d’ouvrir la porte pendant les exercices ».
On voit par là que, s’inspirant de fonctions dévolues autrefois dans l’Église aux titulaires des ordres mineurs et en valorisant le service de l’autel, Monsieur Allemand veillait à ce que le plus grand nombre possible de jeunes se sentent responsable de la vie de l’Œuvre.
Les moins jeunes des Anciens de l’Œuvre ont connu le rite annuel de la proclamation des charges par le directeur. L’après-midi du deuxième dimanche de novembre, avant le Salut du Saint Sacrement, tous les membres étaient réunis dans la chapelle. Les plus jeunes occupaient les bancs, alignés dans le sens de la longueur de la chapelle ; les plus grands étaient assis sur les chaises disposées le long des murs. On attendait ; le directeur lisait alors les noms de ceux à qui était attribuée une charge ; ceux qui allaient occuper les charges de sacristain ou de choriste se levaient à l’appel de leur nom pour gagner, pour les uns, l’une des 24 chaises disposées de part et d’autre de l’autel, pour les autres, la tribune. Tout le monde n’était pas appelé ; le fait de se voir confier une charge consacrait en effet une présence régulière et la reconnaissance d’une bonne appropriation de « l’esprit de l’Œuvre ». Par ailleurs, pour certaines catégories de charges, notamment celles des sacristains et des choristes, une hiérarchie avait été établie, en fonction de l’expérience et des aptitudes. Lorsque toutes les charges étaient attribuées, l’Œuvre était « en marche » pour une nouvelle année.
L’Œuvre conserve les registres papier des charges de 1845 à 1965. La période s’étend donc de quelques années après la mort de Monsieur Allemand (1836) à quelques années après la fin du concile de Vatican II. 120 ans sans interruption ! Leur lecture retient l’attention à divers titres ; certaines catégories de charges, comme celle de conseiller, ont rapidement disparu ; d’autres, comme celle d’enfant de choeur, apparaissent seulement bien après 1845, ce qui paraît étonnant. Par ailleurs, les effectifs des différentes catégories de charges ont, à l’exception notable des sacristains, varié de façon très importante. Les Archives ne fournissent pas d’explication, non plus que les premiers biographes de Monsieur Allemand1. Peut-être les évolutions importantes sur une courte période étaient-elles dues à l’impulsion donnée par un nouveau Supérieur de l’Œuvre ; ou bien à la volonté de motiver les jeunes gens, ou encore, nous le verrons plus loin à propos des choristes, parce que telle ou telle année ne furent nommés que ceux qui avaient fait leur communion solennelle ? Cela peut faire l’objet de recherches complémentaires intéressantes.
Nous présenterons successivement les différentes catégories de charges et leur évolution dans le temps en suivant leur ordre de proclamation tel qu’il résulte des trois registres conservés. Nous avons eu recours aux archives de l’Œuvre, aux travaux des premières biographies, mais aussi aux souvenirs d’anciens qui, en leur temps, ont occupé diverses charges.
Ne disposant pas encore d’informations susceptibles d’expliquer les variations numériques dans le temps, parfois considérables d’une année sur l’autre (de 120 à 186 entre 1903 et 1904, mais aussi de 174 à 100 entre 1951 et 1952), nous constaterons simplement que le nombre des charges proclamées s’est inscrit dans une fourchette entre 100 et 265 et que la moyenne sur l’entière période s’établit à 171. On voit par là que tous les membres de l’Œuvre ne souhaitaient pas assumer une charge ou n’étaient pas jugés assez impliqués pour mériter cet honneur.
Association des Anciens. Équipe du Mémorial
- L’abbé Brunello, auteur de la Vie du Serviteur de Dieu Jean-Joseph Allemand, paru en 1852 fut, de 1844 à 1853, directeur de l’Œuvre.
L’abbé Gaduel, qui avait été membre de l’Œuvre pendant 14 ans et qui a connu Monsieur Allemand, a publié en 1867, alors qu’il était vicaire général d’Orléans, Le directeur de l’Œuvre de la Jeunesse ou la vie et l’esprit du serviteur de Dieu Jean-Joseph Allemand.
Nous présentons dans cette deuxième partie les « charges » qu’il était proposé aux jeunes gens de l’Œuvre de remplir pour aider à la bonne marche de la maison.
1) Les Conseillers : le nombre des conseillers avait été fixé à 24 par Monsieur Allemand. Le Conseil était censé assister le Directeur lors de la prise de décisions. Il s’agissait là d’une charge essentiellement honorifique, car le conseil ne se réunissait que quelques fois par an, le cinquième dimanche du mois (!). À l’époque de Monsieur Allemand, cependant, la prière du chapelet pouvait être placée sous la responsabilité d’un conseiller.
Leur nombre fut réduit peu à peu à une vingtaine ; il n’y eut plus de conseiller nommé après 1862.
2) Le Maître des novices : le terme même de « Maître des novices » fait sans doute référence au nom originel de l’Œuvre : « Congrégation du Très saint Enfant Jésus ». Les jeunes gens présentés par leurs parents étaient d’abord « admis ». Cette admission, n’était pas une simple formalité car les registres, également conservés par l’Œuvre, montrent que certaines candidatures étaient écartées. Après une période de « noviciat », les « admis » étaient « reçus » dans la congrégation, au terme d’une cérémonie spéciale.
Le Maître des novices avait pour charge de faire découvrir ce qu’on a appelé à une certaine époque « l’esprit de l’Œuvre » aux jeunes gens qui n’avaient pas encore été « reçus » dans la congrégation. Il s’agissait généralement d’un Monsieur de l’Œuvre. Il fut assisté partir de 1864 par un « suppléant ». À l’époque de Monsieur Allemand, nous dit l’abbé Brunello, une des fonctions particulières du Maître des novices était de conduire la prière quotidienne du chapelet. La charge de Maître des novices ne fut plus attribuée à partir de 1953.
3) Le Trésorier : il n’y eut qu’un trésorier jusqu’en 1868. On lui adjoignit ensuite un « auxiliaire » puis des « trésoriers adjoints » en petit nombre ; leur rôle consistait à se poster aux portes de la chapelle pour y recueillir les offrandes de la quête, à en calculer le montant total et à les remettre à la direction de l’Œuvre .
L’abbé Brunello rapporte qu’à l’époque de Monsieur Allemand, le Trésorier se plaçait au moment de l’Offertoire, au pied de l’autel, pour recevoir les oboles que ceux qui assistaient à la messe apportaient en procession.
4) Les officiants : il y eut dès l’origine des officiants chargés des matines et des laudes de l’office de la Très Sainte-Vierge, mais leur présence dans la liste des charges n’est attestée qu’à partir de 1863. Ils avaient alors pour mission de diriger la prière des offices qui ne nécessitent pas la présence d’un prêtre. Une quinzaine d’officiants étaient nommés chaque année. À partir de 1942 leur nombre a été sensiblement réduit. Cette charge disparut en 1962 après quelques années d’intermittence.
Ceci dit, les moins jeunes des Anciens se souviennent que, dans les années 1960, des grands, officiants sans charge officielle, continuaient de remplir la fonction.
5) Les portiers : Monsieur Allemand a tenu, dès les origines de l’Œuvre, à ce qu’on retrouve dans les charges un rappel de ce qu’on appelait autrefois les « ordres mineurs » que recevaient les séminaristes avant d’être admis dans les ordres majeurs (diaconat et prêtrise ). Le premier degré des deux ordres mineurs1 comprenait l’« ostiariat » (les portiers) et le lectorat.
Les charges de portier occupaient un nombre important de bonnes volontés. Leur nombre a oscillé entre 15 et 79 (!) en 1935. le nombre annuel moyen sur les 120 ans de la période d’observation est de 33.
Ils avaient pour mission d’ouvrir et de fermer les portes de la chapelle, d’éclairer et d’éteindre les lustres, de s’assurer du bon alignement des bancs et des chaises. Sans doute avaient-ils aussi à remettre à chacun de ceux qui assistaient à la messe ou au Salut du Saint Sacrement son « Manuel de piété » puis à le ranger. En effet, chaque membre de l’Œuvre, à partir du moment où il était « reçu » ( cf. plus haut ), avait un manuel à son nom, relié et imprimé sur papier bible, qui lui était remis lorsqu’il était nécessaire pour suivre l’office. Ces manuels étaient rangés dans un placard sous les arcades, où on les retirait avant l’office pour les y déposer en sortant. On soulignera que, bien avant le concile Vatican II, ces manuels étaient bilingues et que les membres de l’Œuvre avaient sous les yeux la traduction en français des textes et prières de l’office qu’ils suivaient en latin.
6) Les infirmiers : ils furent assez nombreux jusqu’en 1927 (25 par an en moyenne) ; au-delà, sans que l’on en connaisse la raison, leur nombre fut considérablement réduit (de 0 à 10). Pendant la guerre de 39/45, étaient infirmiers, nous dit le Registre des Charges, « les chefs scouts qui ont leur brevet de secourisme ». Les infirmiers avaient pour mission de soigner les bobos et écorchures que les jeux de cour pouvaient entraîner, voire les migraines dont certains pouvaient être affectés. Leur charge comprenait surtout la visite des malades, que ce soit dans leurs familles ou dans les hôpitaux. L’Œuvre restait attentive à ceux qui en étaient temporairement éloignés. La diminution, au début du xxe siècle, des durées des périodes où il fallait « garder la chambre », en raison des progrès de la médecine, rend peut-être compte des moindres besoins en « visiteurs médicaux ».
7) Les sacristains : autant le nombre des infirmiers a pu varier dans le temps, autant celui des sacristains, fixé à 24 par Monsieur Allemand, est resté assez constant, même si leur nombre a pu se trouver réduit à 21 (dont 2 sacristains hors cadre !) en 1952 après avoir atteint (avec 4 sacristains hors cadre !) le nombre de 28 en 1951.
Les 24 sacristains avaient le soin des deux chapelles (la Grande et celle des Anges, au 2e étage) et de leurs sacristies. Le samedi après-midi, ils balayaient le sol, une première fois à sec, puis une nouvelle fois avec de la sciure humidifiée ! N’oublions pas qu’on assistait alors à la messe à genou sur le sol nu. Il leur revenait de maintenir leur domaine en parfait état, d’épousseter les statues et la chaire, de veiller au bon fonctionnement de l’éclairage mais aussi, selon les solennités, de mettre en place les tapis, ou de garnir les murs de tentures rouges ou noires, ou encore d’installer le catafalque (le Jour des morts) ou le reposoir (le Jeudi Saint). Pendant la Semaine Sainte, ils se livraient au nettoyage rigoureux de la chapelle, n’hésitant pas à se jucher sur des échelles pour enlever la poussière des lustres. Ils entretenaient l’éclat des chandeliers, crucifix, ostensoirs, encensoirs et navettes. Ils veillaient sur les vêtements liturgiques et préparaient ce qui était nécessaire pour les offices (cierges, hosties, vin de messe, fleurs, charbon pour l’encensoir, encens, eau des bénitiers, etc). Enfin, ils encadraient les enfants de chœur, les formant, les faisant répéter pour les grandes fêtes et en s’assurant qu’ils soient en nombre suffisant pour chaque office.
Ils avaient le privilège d’occuper, en suivant un ordre hiérarchique, les 24 chaises disposées à gauche et à droite de l’autel.
8) Les lecteurs. Les charges de lecteur furent une des premières instituées par Monsieur Allemand ; on rappelle ici que le lectorat était alors l’un des deux premiers ordres mineurs. Le nombre de lecteurs a oscillé entre 14 et 36 puis a progressivement diminué à partir de 1942.
À l’origine, ils avaient notamment la charge de faire, après la récitation quotidienne du chapelet, une lecture de 7 à 8 minutes, tirée de livres de piété dont les titres, mentionnés par l’abbé Brunello retiennent l’attention : La Perfection chrétienne, de Rodriguez, le Guide des pêcheurs, de Grenade, La Connaissance de notre Seigneur Jésus Christ, du P. Saint-Jure, les Pensées de Bourdaloue, etc. Une glose de Monsieur Allemand, d’un demi-quart d’heure, ne devait pas être inutile pour rendre profitable l’instruction.
Les lecteurs avaient aussi pour mission de lire, au temps où on célébrait la messe en latin, depuis un pupitre installé au seuil du chœur, les traductions en français des textes de l’Épître et de l’Évangile que le prêtre disait à l’autel, en célébrant le dos tourné à l’assistance. La célébration de la messe en français et la sonorisation de la chapelle ont rendu cette charge inutile. On a noté cependant en 1965 l’existence d’une « Équipe liturgique » dont les fonctions devaient se rapprocher de celles des lecteurs.
9) Les choristes. Monsieur Allemand, nous dit un de ses biographes, préférait le silence au chant ; il tenait à ce que les chants soient simples et à la portée de tous. Il y eut cependant de tout temps une importante chorale qui comptait en moyenne une trentaine de membres (avec de grandes variations puisque, s’il n’y avait que 9 en 1899, leur nombre a atteint un maximum de 66 en 1965). Les choristes prenaient place à la tribune et, pour les cérémonies portaient l’aube. Ils disposaient d’une salle de répétition, au 2e étage. La chorale était particulièrement mise à contribution pour la Veillée de Noël et lors de l’Épiphanie. Pendant la Semaine Sainte elle chantait surtout du chant grégorien.
Les aptitudes vocales et l’expérience induisaient une hiérarchie des compétences qui s’exprimait lors de la proclamation des charges. En 1963, la Chorale changea de nom pour devenir la Maîtrise chantante. Les six premiers choristes formaient le Conseil de la chorale ; les voix étaient réparties en « Voix d’hommes » (Ténors et basses) et « Voix d’enfants »(Alti et soprani) ; certaines années on distingua même parmi les voix d’enfants, les choristes « titularisés » et les « postulants » ! Le Registre des charges précise, en 1951 et 1952, que seuls furent nommés choristes ces années-là « ceux qui (avaient) fait leur communion solennelle ». Cette remarque peut expliquer les importantes variations d’effectifs des autres catégories de charges constatées d’une année sur l’autre, selon qu’étaient nommés seuls ceux qui avaient fait leur communion solennelle ou non.
La chorale se produisait peu hors de l’Œuvre, sinon à Notre-Dame de la Garde et à l’église Saint-Joseph dont Sauveur Bruschini (voir plus loin ) était titulaire de l’orgue. La qualité de cet ensemble vocal façonné par deux Messieurs de l’Œuvre, Monsieur Ange Musso puis par Monsieur Eugène Cima lui permit d’enregistrer deux disques 33 tours en 1960 et 1962, le premier, édité par les Éditions H.M., 34 rue Paradis à Marseille, l’autre « Noëls de Provence » par les Disques Trident, 66 promenade de la Plage à Marseille.
10) Les organistes. On ne voit apparaître de charge d’organiste qu’à partir de 1925, ce qui étonnera puisque l’Œuvre disposait d’un orgue depuis le milieu du xixe siècle. Cela s’explique sans doute par le fait que l’orgue, dont le jeu nécessite une grande maîtrise, ne pouvait être confié à des jeunes gens. L’orgue était sans doute tenu jusqu’alors par des organistes proches ou amis de l’Œuvre. Le nombre d’organistes lors des proclamations des charges n’a jamais été élevé, le nombre le plus important d’organistes nommés au cours d’une année étant de 7 en 1935. Les Anciens se souviennent de Monsieur Emile Pérault, d’Edmond Fize, de René Verdot, de Raymond Mathieu, de Guy Morançon et, bien sûr, de Gérard Gelly (toujours en activité en 2022 à Notre-Dame-du-Mont ). On évoquera aussi les concours précieux qu’apportaient deux amis de l’Œuvre, Henri Luc (qui accompagna avec Gérard Gelly les choristes pour leur premier disque) et Sauveur Bruschini ( qui tenait l’orgue pour le second disque).
11) Les enfants de chœur. Curieusement, les enfants de chœur n’apparaissent dans le registre des charges qu’à partir de 1852, bien qu’il y ait eu nécessairement des servants de messe à l’œuvre… Ils furent toujours très nombreux, en moyenne 34 par an, jusqu’à atteindre le nombre de 81 en 1936 ! De façon inexpliquée, le registre ne mentionne pas d’enfant de chœur en 1903… Les Enfants de chœur devinrent « Maîtrise servante » en 1963. Comme les portiers, ils remplissaient leur charge par roulement, ce qui ne nécessitait pas une présence constante de tout l’effectif.
Les enfants de chœur étaient employés aux rôles des titulaires de l’ordre mineur des acolytes. Il y avait donc des thuriféraires (chargés de l’encensoir), accompagnés de naviculaires (qui portent la navette qui contient l’encens), et des céroféraires (qui portent les cierges – mais ce terme n’était pas utilisé à l’Œuvre).
Pour les messes « ordinaires », avant le concile Vatican II, leur service consistait à assister le célébrant, l’accompagnant à l’autel, répondant aux prières, transférant le pupitre du missel (du coté Épître au coté Évangile) en évitant de dévaler les marches de l’autel (!), faisant tinter la sonnette ou le carillon aux moments désignés par la liturgie, lui présentant à la fin de la messe le canon (tablette) du dernier Évangile, etc.
Les grandes fêtes de l’Église requéraient cependant un nombre plus important d’enfants de chœur qui remplissaient alors l’ensemble des fonctions des acolytes. Ils étaient précédés dans la procession par un cérémoniaire tenant une masse cérémonielle que surmontait une statue argentée de la Vierge Marie ; dans le langage des enfants de chœur et des sacristains, on appelait l’objet et celui qui le tenait du même nom : le « baculot », sans doute du latin « baculum » (gros bâton). Les mouvements étaient réglés par un claquoir discret .
Le dernier registre des charges, commencé le 15 novembre 1931, s’arrête le 17 octobre 1965. Les services les plus importants que rendaient les titulaires de charges n’ont pas pour autant disparu. Ils continuent d’être assurés de façon proche de celles que nous avons décrites ou selon des modalités différentes. Les portiers, les trésoriers, les infirmiers sont retirés dans le domaine des souvenirs, mais le service de la liturgie continue d’être assuré par de nombreux membres de l’Œuvre ; il suffit d’assister à la messe de l’Épiphanie ou à celle de la Kermesse, ou simplement à la messe du dimanche, pour en être convaincu.
Nous remercions par avance les Anciens qui pourront apporter des précisions, signaler des inexactitudes qui nous auraient échappées ou nous communiquer des éléments permettant de mettre en évidence la persistance de la proclamation des charges.
Association des Anciens. Équipe du Mémorial
Les Associations de l’Œuvre
Une des particularités de l’Œuvre a été, pendant longtemps, de réunir les plus fervents et les plus attachés de ses membres dans ce qu’on nommerait maintenant des « groupes de prière » et qu’on appelait alors les « associations ». Ils y recevaient une formation particulière et se « ressourçaient », comme on dit aujourd’hui , pour ensuite aider à la bonne marche de l’Institution.
Monsieur Allemand, s’inspirant de ce qu’il avait connu à l’Œuvre du Bon Pasteur, suscita l’Association des Anges, celle du Sacré Cœur et enfin celle de la Grande Réunion, pour les jeunes gens âgés de plus de 25 ans . Cette dernière association devint la congrégation de l’Institut de la Jeunesse Jean-Joseph Allemand qui regroupe uniquement les « Messieurs de l’Œuvre ». Dans le courant du xxe siècle, l’Œuvre suscita une autre association affiliée au mouvement de la Croisade Eucharistique (devenue en 1962 le Mouvement eucharistique des jeunes). Nous évoquerons seulement l’Association des Anges et celle du Sacré Cœur ; en effet la Croisade n’a pas marqué profondément la vie de l’Œuvre et l’histoire de l’Institut excède le cadre de cet article .
L’association des Anges
L’association fut créée dès les premières années de l’Œuvre. Elle accueillait les jeunes gens âgés entre 12 et 16 ans qui avaient fait leur première communion. Il leur était proposé d’entrer dans l’association parce qu’ils s’étaient distingués tant par leur régularité à venir à l’œuvre que par le bon exemple qu’ils donnaient. Il s’agissait de les aider à « s’avancer dans la vertu et les faire concourir au bien général ». Il leur était demandé de travailler à « (leur) sanctification personnelle et (d’)entraîner les camarades à la pratique des vertus chrétiennes… surtout par l’apostolat du bon exemple ». Ils devaient cultiver principalement trois vertus : celle de pureté, en évitant les occasions de pécher, celle d’obéissance, en s’acquittant exactement de ce qui était attendu d’eux, et celle de zèle. Le zèle consistait, en se montrant aimable et prévenant envers les autres, à les entraîner au bien, pour qu’ils aiment l’Œuvre. Les membres devaient s’appliquer à être « de véritables serviteurs de Dieu » et, pour cela, à suivre un règlement que Monsieur Allemand avait établi. Il exigeait qu’on l’observât à la lettre : « On peut être membre de l’Œuvre sans faire partie de l’Association des Saints Anges ; ainsi on est libre d’en sortir ou d’y rester. Mais si l’on est bien aise d’y rester, j’exige absolument qu’on ait une conduite très édifiante et qu’on observe le règlement à la lettre ». Initialement, l’Association se réunissait deux fois par mois. Le rituel a évolué dans le temps ; les dernières années, les membres se réunissaient deux fois par semaine, le jeudi matin pour la messe (avant d’aller au lycée ) et le dimanche en fin de matinée. Monsieur Allemand, pour qui discerner sa vocation était essentiel, demandait de réciter à chaque réunion la prière « Notam fac… »1 pour aider à la connaître. Les réunions comprenaient en outre la récitation du chapelet, une lecture commentée, une prière pour les malades et la lecture du règlement.
Les devoirs particuliers des membres étaient, en outre, de faire chaque jour un quart d’heure d’adoration et un quart d’heure de méditation ainsi qu’une prière à l’Ange gardien. Ils se devaient également de se confesser toutes les semaines ou toutes les quinzaines. Ces pratiques pourront aujourd’hui paraître un peu formalistes pour des adolescents, mais ce qui sans doute faisait qu’elles n’étaient pas ainsi perçues était qu’à côté de cela les Anges, qui partageaient cette vie exigeante avec des camarades qui adhéraient avec enthousiasme aux mêmes buts, avaient le sentiment de bénéficier d’une considération qui leur permettrait de rendre encore de plus grands services dans l’Œuvre.
Parvenus à l’âge de 16 ans, ceux des membres de l’Association des Anges qui paraissaient suffisamment avancés dans la démarche spirituelle qui leur avait été proposée, étaient invités à entrer dans l’Association du Sacré Cœur, que nous évoquerons dans un prochain article.
•••
Les offices et réunions avaient lieu dans la chapelle des Anges qui avait été créée en 1851 dans l’aile Est du bâtiment central, au deuxième étage. L’autel était placé dans une abside peu profonde aménagée contre le mur nord. Les murs latéraux étaient bordés d’une double rangée de banquettes. Des appliques murales et les deux fenêtres au Midi en faisaient une pièce très lumineuse. Elle a été restaurée dans les années 1980 car, à la suite de la dissolution de l’Association et de la désaffectation de la chapelle, les aménagements originaux avaient été enlevés. Le plan a été modifié (la chapelle étant orientée vers l’Est) et la décoration des panneaux mise au goût de l’époque. Cette chapelle n’étant pas actuellement utilisée, le local a été mis à la disposition de l’association Zebra, qui l’occupe toujours en 2023.
L’association du Sacré-Cœur
L’association du Sacré-Cœur, comme l’association des Anges, a été créée dès les premières années de l’Œuvre. Un des biographes de Monsieur Allemand définit ainsi son objet : « Pour entretenir et diriger le zèle… pour fortifier, animer, soutenir, en les groupant ensemble tous ses plus pieux jeunes gens, il fallait… dans l’Œuvre des foyers de ferveur et de perfection ».
Les associations, ainsi les appelait-on, paraissaient de nature à favoriser l’émulation tant dans la recherche de la perfection que dans le désir d’aider à la bonne marche de la maison. C’est tout particulièrement sur la trentaine de membres de l’association du Sacré-Cœur que Monsieur Allemand s’est appuyé, lorsque l’Œuvre a été interdite, de 1809 à 1814, pour maintenir le réseau de ses membres, les réunir de façon discrète et éviter que le lien entre le fondateur et les jeunes gens ne se distende.
Le but de l’association n’était pas sensiblement différent de celui de celle des Saints Anges, puisqu’il s’agissait « d’aimer le Bon Dieu », de découvrir sa vocation et de servir l’Œuvre en toute occasion. Le questionnement sous-jacent était cependant, à l’association du Sacré-Cœur, de savoir si la meilleure façon de vivre sa vocation et de servir l’Œuvre n’était pas d’aller encore plus loin dans l’engagement et de postuler pour entrer dans la congrégation de l’Institut.
Seuls étaient pressentis les jeunes gens vraiment fervents, âgés entre 16 et 24 ans. L’association n’a jamais connu plus d’une trentaine de membres. Les membres devaient particulièrement s’attacher, comme le détaillent les biographes, à cultiver :
– l’humilité : c’est-à-dire, être sincère, accepter ses défauts et ceux des autres, éviter toute recherche et vanité ;
– l’esprit de pénitence, qui consiste à acquérir une âme libre et détachée, en évitant les occasions de pêcher, à consacrer tous les moments libres à l’Œuvre, et à apprendre à ne pas s’enliser dans la médiocrité et le matérialisme ;
– l’obéissance : savoir renoncer à sa volonté pour faire celle de Dieu, respecter le règlement, se donner entièrement aux charges qui sont confiées en faisant tout ce qui est attendu de vous ;
– la charité : rendre service, se refuser aux critiques même justifiées, en préférant une explication fraternelle ;
– l’apostolat : en famille, auprès des jeunes de l’Œuvre, et dans le milieu professionnel. Dès que les membres de l’Association étaient libérés de leurs occupations professionnelles et familiales, ils se devaient de se rendre à l’Œuvre pour y être les auxiliaires des directeurs.
Monsieur Allemand, qui dirigea personnellement l’Association, avait composé à leur intention un recueil de maximes, inspirées de la spiritualité de sainte Chantal, « adaptées à une réunion de jeunes gens » et dont les mots-clés étaient : Humilité, Obéissance, Mortification. Le règlement de vie était exigeant. Il était prescrit :
– chaque jour : de faire un quart d’heure d’adoration en présence du Saint Sacrement, un quart d’heure de méditation, précédée de la récitation du Notam fac1, de réciter le chapelet, de lire un ouvrage pieux, de procéder à un examen de conscience et de lire un passage du règlement de l’Association ;
– chaque semaine : de se confesser, d’assister à la messe dite pour l’Association et à la réunion de l’association ;
– d’être présent à toutes retraites, réunions et autres activités.
Les candidatures des postulants étaient examinées par le directeur de l’Œuvre et par les membres du Conseil de l’Association qui était renouvelé tous les ans. Chacune faisait l’objet d’une étude attentive, étalée souvent sur plusieurs mois qui consistait dans l’examen du parcours antérieur, des motivations réelles, de l’assiduité, et, pour tout dire « l’esprit » .
Les postulants étaient reçus après une période de noviciat et une retraite. Le dernier cahier de séances, tenu de 1935 à 1961, est riche d’informations sur une période plus contemporaine. Les unes relèvent de l’anecdote, comme la postulation, en 1936, de Gaston Rebuffat qui fut plus tard guide de haute montagne et l’un des vainqueurs de l’Annapurna ; d’autres sont plus éclairantes, comme le rappel de l’incompatibilité de l’appartenance à un autre mouvement, tel que la J.O.C. On apprend, de même, que chaque mois était donnée une intention de méditation, par exemple l’Esprit de Foi, l’Esprit d’union, la fidélité aux devoirs d’état… Les échanges entre les membres du conseil et le supérieur de l’association, directeur de l’Œuvre, n’étaient pas de pure forme, puisqu’on n’hésitait pas, à certaines époques, à relever que la ferveur diminuait, que la cohésion entre les membres laissait à désirer ou encore que les livres de la bibliothèque n’étaient pas assez consultés. Il arrivait aussi qu’on demandât à un nouvel entrant de dire les insuffisances qu’il avait trouvées dans l’association.
Les exercices se sont progressivement adaptés aux développements de la vie de l’Œuvre (ainsi, il n’y eut plus de réunions pendant les périodes des camps), mais aussi à l’évolution de la condition sociale des familles ; il y eut moins de « commis » ou de négociants qu’à l’époque de Monsieur Allemand, et nombre des membres de l’association eurent la possibilité d’effectuer des études supérieures. Des ecclésiastiques extérieurs à l’Œuvre furent invités à y donner des conférences sur des sujets divers.
Le souci de perfection spirituelle était resté premier, comme le confirme une remarque relevée dans le cahier de séances de 1961 : « Le but premier de l’Association est la sanctification personnelle de chacun de ses membres, l’Apostolat n‘étant qu’un des moyens pour parvenir à cette fin ». Comme l’a récemment écrit un ancien membre du Sacré-Cœur, « venir dans cette association était interprété comme un appel discret à se préparer à être peut-être plus tard Monsieur de l’Œuvre. On se retrouvait lorsque les activités de l’Œuvre (jeux par exemple) étaient terminées… On montait au dernier étage de la grande maison centrale (…) dans une petite salle, qu’on appelait, je crois, le pigeonnier. On priait et partageait une méditation à partir de lectures de textes. Si je ne me trompe pas, une des prières favorites était le Notam fac1. J’ai ressenti… un sentiment d’élévation et de soutien vers un idéal plus fort, une poussée discrète à aller plus loin dans notre engagement pour l’Œuvre et, concrètement, le sentiment d’être associés aux meilleurs, d’avoir un lien plus fort avec eux et de partager les exigences du rôle de chef. Incontestablement, poursuit-il, la Direction de l’Œuvre devait en attendre la constitution d’un noyau fort (on pourrait presque dire d’une élite) et le recrutement pour renforcer l’équipe des Messieurs »
L’association du Sacré-Cœur se réunissait dans l’unique pièce du dernier étage du bâtiment central, à laquelle on accède par un escalier qui s’ouvre à l’entrée de l’ancienne chapelle des Anges. Elle est éclairée au midi par une fenêtre que surplombe le buste de Jean-Joseph Allemand. Il s’agissait d’une modeste pièce au décor sommaire, qu’en raison de sa situation – et peut-être de sa destination originale avant l’acquisition de la maison par l’Œuvre – on appelait le pigeonnier… ce qui permettait aux membres de se qualifier entre eux en plaisantant de « pigeons »…
•••
Comme l’Association des Anges, celle du Sacré-Cœur a cessé d’accueillir des membres à partir du milieu des années 1970, d’autres modalités de formation et d’apostolat étant proposées aux membres de l’Œuvre. L’important est que la vie vécue à l’Œuvre continue d’aider les jeunes qui la fréquentent à trouver leur vocation en s’entraidant mutuellement dans leur parcours de chrétien.
Association des Anciens.
Équipe du Mémorial
Bibliographie :
– Henry Arnaud, La vie étonnante de Jean-Joseph allemand, Apôtre de la Jeunesse, 1966.
– Abbé Félix Brunello, Vie du serviteur de Dieu J.-J. Allemand, fondateur de l’Œuvre de la jeunesse, 1852.
– Abbé Gaduel, Le directeur de la jeunesse ou la vie et l’esprit du serviteur de Dieu Jean-Joseph Allemand, 1867.
– Abbé J. Mauquois ; Le message d’un Père de jeunesse J.-J. Allemand, Éditions F.N.P., Gilly, 1956.
1 « Notam fac, Domine, mihi viam in qua ambulem » : Fais moi connaître, Seigneur, le chemin où je dois marcher.
La Création des groupes à l’Œuvre
Les plus âgés de nos anciens ont tous connu les Groupes ; ils ont été, selon le nombre d’années qu’ils ont passées à l’Œuvre, Benjamins, Cadets, Grands Cadets puis Aînés… mais cette répartition par tranches d’âge n’a pas toujours existé. Notre propos sera de montrer comment on est parvenu à cette organisation qui n’avait pas été envisagée par Monsieur Allemand.
On sait qu’il établit sa méthode sur le jeu et sur la prière. Répondant au policier qui, en 1809, venait, sur instruction, l’obliger à fermer l’Œuvre et lui demandait ce qu’on y faisait, il répondit : « Ici on joue et on prie ! » On soulignera qu’il mentionna alors le jeu avant la prière, même si, dans son projet, le jeu devait permettre aux jeunes qui lui étaient confiés d’accéder à la prière. Nous confesserons volontiers qu’en nos jeunes années le jeu n’était pas la moindre de nos motivations pour venir à l’Œuvre.
L’abbé Gaduel, qui avait été membre de l’Œuvre et avait connu Jean-Joseph, note dans sa biographie publiée en 1867 : « On a vu la grande place qui était faite dans l’Œuvre aux amusements : en hiver on se livrait en plein air aux jeux de course, tels que les barres1 et autres semblables. C’étaient les jeux que Monsieur Allemand préférait à tous les autres parce qu’ils occupent davantage et sont très favorables à la santé. On restait dans la cour tant que le jour durait ; le soir venu, on entrait dans les salles pour s’y livrer aux jeux de salon. L’été on avait une foule de jeux… tels que les billes, la balle, le cerceau, les jeux de course car les enfants aiment à courir en toutes saisons ; mais le plus grand jeu d’été, c’était “Le jeu de boules” »… Seuls étaient interdits les jeux de billard et les représentations théâtrales. L’abbé Gaduel indique simplement que les plus grands encadraient les plus jeunes. Sans doute, pour toutes ces fonctions d’encadrement, Monsieur Allemand n’avait-il pas de difficulté pour trouver des bonnes volontés2.
Ni l’abbé Gaduel, ni l’abbé Brunello, autre biographe de Jean-Joseph Allemand et directeur de l’Œuvre de 1844 à 1857, ne mentionnent l’existence de structures d’encadrement des jeunes. Il semblerait que cette disposition ait convenu pendant de nombreuses années. Les jeux se déroulaient pour l’essentiel dans les locaux de l’Œuvre. Les archives ont conservé certaines des règles des jeux, rédigées souvent de façon humoristique, tels que la balle aux pieds, le ballon anglais, le jeu d’Abraham, la guerre « indienne ». On jouait aussi au Tambourin3, au jeu de paume, à la course en sac, au voleur à passer… Cela n’a pas empêché l’ouverture progressive à d’autres activités sportives en relation avec leur diffusion dans la société française de l’époque, telles que la gymnastique, dans la salle créée en 1848, et plus tard le tennis ou le foot-ball, au tournant du xxe siècle. Au cours de la même période, des loisirs se déroulant hors les murs de l’Œuvre ont été proposés, telles que des excursions, ou des séjours au Plan d’Aups sous la conduite des Messieurs les plus jeunes. On allait aussi aux bains de mer et on rapporte que Gaston Rébuffat (1921-1985), guide de haute montagne, membre de l’expédition française de l’Anapurna, fit ses premières escalades sous la conduite de Monsieur Puncet. Des photos conservent le souvenir de vacances de ski en 1934 et de « camps volants » (en Corse).
En parallèle des jeux de cour, progressivement étendus bien au-delà de celle-ci, des activités d’intérieur étaient proposées. On jouait aux échecs, aux dominos. Les plus jeunes étaient assidus aux « Histoires » que leur contaient les Messieurs et l’on jouait des « pasquinades » (comédies). Plus tard apparurent « Chapuzot », théâtre de marionnettes qui connut une longue histoire, puis le cinéma, sous la forme du Pathé-Baby. Chaque année, le jour de la Toussaint (ou des Morts ?) avait lieu la Grillade du Diable : un procès était intenté au Diable représenté par un mannequin bourré de pétards : l’acte d’accusation et les plaidoiries fantaisistes aboutissaient inéluctablement à sa condamnation. Il était brûlé dans un grand feu allumé dans la cour tandis qu’explosaient les pétards et que grillaient des châtaignes dans les braises.
Une des activités connut un succès particulier : la Foire de Pékin, qui proposait à intervalles réguliers des jeux d’esprit, des devinettes et des énigmes. Les vainqueurs gagnaient des « cachets » qui étaient comptabilisés et utilisés pour la Kermesse. Cette Foire de Pékin, née à la fin du xixe siècle, au moment où l’Europe a commencé à s’intéresser à la culture chinoise, a perduré pendant un demi-siècle. Les participants étaient répartis en deux groupes, les Éléphants gris et les Tigres dorés.
Nous n’avons pas trouvé d’informations permettant de penser que l’organisation des activités de loisir à l’Œuvre ait été grandement modifiée jusqu’à la guerre de 1914-1918. Sans doute les jeunes se regroupaient-ils assez spontanément en fonction de leurs affinités et de leurs capacités physiques, indépendamment de leur âge. De même, se retrouvaient-ils sans doute pour les jeux à partir des relations nées dans les « bandes » organisées pour le raccompagnement des plus jeunes. Les plus grands étaient en effet chargés, chacun pour un quartier de la ville, de reconduire chez leurs parents un petit groupe fixe des plus jeunes qui les attendaient sous les arcades. C’était, écrit le Père Ruby, ancien Supérieur, dans ses souvenirs, l’occasion d’une rencontre régulière entre grands, moyens et plus jeunes habitant le même quartier.
Le besoin d’assurer un encadrement pérenne des différentes activités se faisait cependant sentir et, quelques années après la fin de la guerre de 14-18, fut instituée la Fédération des Jeux.
En 1924 apparut une première amorce d’organisation des jeux par la création de la Fédération des Jeux (FDJ). Cette Fédération avait été voulue pour mieux préparer et encadrer les jeux. Comme l’indiquait le rédacteur du Bulletin de la FDJ, il était proposé aux plus grands de prendre un engagement pour faire vivre l’« Œuvre jouante » au même titre que s’engageaient pour le bon fonctionnement de l’« Œuvre priante » ceux qui acceptaient une Charge et dont la liste était proclamée chaque année dans la chapelle4. L’éditorial du président de la Fédération, Monsieur Emile Perault, relevait : « Rien de très neuf dans la FDJ…, les Grands s’étant toujours chargés… de faire jouer les plus jeunes. Forme modernisée… ? Oui… Tradition, au fond. » Réorganisée en « sections », réunissant chacune un groupe de jeux et placées sous la responsabilité d’un président renouvelable chaque année, la FDJ témoignait de sa vitalité en faisant paraître un Bulletin dans lequel étaient proposés mais aussi commentés les concours, jeux, séances récréatives, etc. Elle avait pris sous son contrôle la vente des accessoires de jeux, balles, maillots, raquettes, etc. La FDJ comptait au nombre de ses sections : les Boules, la Gymnastique, les Jeux de salon, les Jeux des « petits », les Jeux de cour et la Foire de Pékin. On apprend au détour d’une phrase du Bulletin la présence de « groupes ». Des anciens aujourd’hui disparus nous ont indiqué, il y a maintenant un certain nombre d’années de cela, qu’il y avait les Grands, qui étaient encadrés par les Messieurs les plus jeunes, que les Moyens étaient animés par des Grands, qui s’occupaient également des Petits qui étaient ceux qui n’avaient pas encore fait leur communion solennelle… La FDJ avait développé une règlementation assez détaillée puisque le numéro 2 de la FDJ donne la répartition des jeux de salon auxquels peuvent s’adonner les jeunes : si tout le monde peut jouer aux Dames, aux Échecs ou au Billard japonais (mais dans des sections différentes), les jeunes ne jouent pas aux cartes et les grands n’ont pas à jouer au « Sébastopol » (variante du jeu de Domino).
En octobre 1931, le Bulletin de la Fédération des Jeux disparaît, remplacé par Notre Écho, qui, depuis 1921 était diffusé pendant les trois mois des vacances d’été et qui maintenait le lien entre les membres de l’Œuvre. Il proposait des devinettes, des charades, des « traits d’esprit » et une chronique appelée les Tablettes. Notre Écho, est en effet, nous dit l’éditorialiste, l’écho de notre devise : « Ici on joue et on prie » La mission de la FDJ se poursuivra jusqu’à la fin de la décennie.
Dans le même temps, le scoutisme, qui s’était structuré en France à partir de 1911, avait connu un important développement à Marseille. S’il avait suscité à l’origine quelques réserves chez certains Messieurs, son intérêt fut rapidement perçu puisque dès 1920 Jean Vidal, qui deviendra Monsieur de l’Œuvre, et l’abbé Castellin, ancien de Saint-Savournin, fondèrent la 1re troupe Scoute catholique de Marseille. En 1931, deux Messieurs suscitent la création de la troupe de l’Œuvre des Iris ; en 1937 la troupe de l’Œuvre du Bd Tellène est créée et, en 1938, sous l’impulsion de Monsieur Car, Supérieur de l’Œuvre, est lancé le Groupe Saint Georges qui deviendra la 37e troupe.
Il est très vraisemblable que la structuration du mouvement Scout a conduit alors à une réflexion sur l’opportunité de répartir les membres de l’Œuvre par tranches d’âge, voire d’infléchir les activités.
De fait, on découvre dans Notre Écho de janvier 1942, sous la plume d’A.C.5, qu’une nouvelle organisation vient d’être mise en place, notamment pour pallier diverses insuffisances dont on faisait le constat :
Le défaut de régularité des Grands pour encadrer les jeux des petits
La mobilisation de nombreux jeunes Messieurs (prisonniers de guerre en Allemagne ou appelés aux Chantiers de jeunesse).
L’auteur de l’article annonçait que cette organisation était « conçue selon la forme moderne adoptée par tous les mouvements de jeunesse » et que les membres de l’Œuvre seraient alors répartis par tranches d’âge en quatre groupes qui seraient constitués d’équipes de 6 à 8 membres, conduites chacune par un chef. Il y aura donc désormais : Les Benjamins (de 8 à 11 ans) ; les Cadets (de 12 à 14 ans) ; Les Grands Cadets (de 15 à 16 ans) ; les Aînés de 17 à 20 ans.
Du scoutisme, relevait l’auteur, l’Œuvre retenait l’uniforme, le salut et la promesse, mais il soulignait aussitôt que la finalité du scoutisme et celle de l’Œuvre différaient. Alors, avançait-il, que l’originalité de la méthode scoute était de proposer un retour vers la nature, la particularité de l’organisation à laquelle procédait l’Œuvre était d’aider au développement d’une vie intérieure intense et du sens des responsabilités. Nous lui laisserons la responsabilité de cette analyse. Cette organisation, un temps appelée la Phalange, en référence, sans doute, au nom qu’on donne à un groupe artistique ou littéraire de personnes unies pour un objectif commun, changea rapidement de dénomination pour devenir l’organisation des Groupes. Ilcn’est pas à exclure que ç’ait été pour ne plus avoir à mentionner un nom qui dans un pays voisin évoquait une toute autre forme d’organisation.
Jusqu’en 1945, la composition des groupes fut assez fluctuante ; par exemple le groupe Benjamin était constitué de deux sous-groupes : a) pour les enfants de 8 ans, le groupe St-Nicolas , composé des « légions » St-François et St-Jean ; b) pour ceux de 9 à 11 ans, le groupe Benjamin, avec les légions St-Georges et St-Denis. Chez les Cadets, on comptait quatre équipes qui portaient les noms de Lyautey, Bayard, Foch et Charcot. Les Grands cadets comptaient 5 équipes et le groupe Ainé devait être assez réduit puisque les annales ne retiennent que le nom du chef de groupe.
Un uniforme, qui n’était porté que lors des activités hors de l’Œuvre avait été dessiné ; il sera en vigueur, à quelques variantes près, jusqu’à la fin des années 1960. Il comprenait : un blouson et une culotte courte de couleur bleu marine en drap assez grossier ( un ancien se souvient encore que les culottes irritaient souvent les cuisses par temps froid !) ; d’une chemise en coton ; d’un béret. Un écusson portant les initiales JJA était cousu sur le béret, le blouson et la chemise. L’uniforme comprenait également un foulard, de couleur bleu de France, gansé de blanc, roulé et maintenu par une bague en cuir. Les familles se fournissaient de ces articles auprès de l’Œuvre. Des mi-bas en coton blanc complétaient la tenue .
L’appartenance aux différents groupes était indiquée par des barrettes en métal cousues sur la chemise et sur le blouson ; le bleu avait été retenu pour le Groupe des Benjamin, le rouge pour les Cadets, le jaune pour les Grands Cadets et le vert pour les Aînés. Les chefs avaient pour signe distinctif une étoile sur leur barrette et ils avaient un sifflet tenu par un cordon rouge (ou blanc).
À partir de novembre 1945, la structure a été remaniée. Chaque groupe avait un chef, éventuellement accompagné d’un Premier assistant ou de co-chefs de groupe. Ils avaient auprès d’eux des assistants ou des assistants stagiaires. Des locaux distincts étaient affectés à chacune des maîtrises. À l’origine, les chefs et seconds d’équipes ainsi que les chefs de légion du groupe Benjamin et les porte fanions des légions faisaient l’objet d’une nomination solennelle mais cette pratique est tombée en désuétude.
Le nombre de groupes n’a pas varié dans le temps, mais, le « baby-boom « a conduit à certaines époques à la démultiplication des groupes Cadet (KD 1, KD2 et même KD 3) et Grands Cadets (GKD 1 et GKD 2). Puis, l’évolution de la société ainsi que des mentalités a conduit à un aménagement de ces structures.
C’est cependant cette organisation par tranches d’âge qui, à quelques variantes près, persiste depuis de 80 ans. Sa pertinence, qui reste d’actualité, a permis de trouver les ajustements nécessaires pour tenir compte de l’évolution de la société, de la mixité et de la façon dont les loisirs sont vécus.
Jean-Pierre Girousse
Commission du Mémorial
Association des Anciens
- Les barres opposent deux équipes constituées d’un nombre de joueurs à peu près équivalent qui s’affrontent sur un terrain rectangulaire. Le but du jeu est de faire prisonnier les membres de l’équipe adverse.
- L’idée de demander aux plus âgés de s’occuper des plus jeunes était sans doute tirée de l’expérience que Jean-Joseph Allemand avait vécue à l’Œuvre du Bon Pasteur.
- Un exemplaire de tambourin est exposé au Mémorial.
- Cf notre article sur les Charges, publié dans Notre Écho et mis en ligne sur le site de l’Œuvre.
- Sans doute Albert Chipponi.
Ici on joue, ici on prie