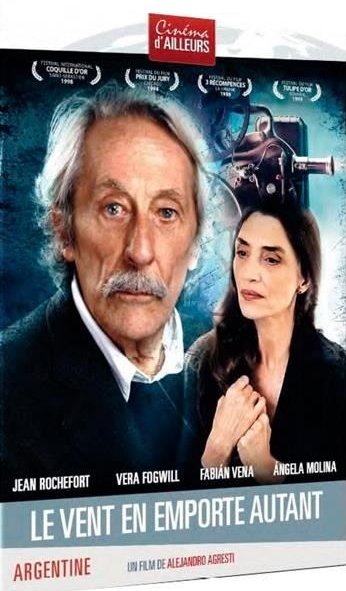Édito décembre 2020 > Célébrer
L’année 2020 devait être marquée par les célébrations du bicentenaire de l’installation de l’Œuvre à la rue Saint-Savournin, c’était en 1820. La crise sanitaire a bouleversé ce programme et toutes les festivités ont été annulées au fur et à mesure que nous nous enfoncions dans les restrictions et les confinements. C’est un paradoxe de parler de la notion de célébration dans ce contexte. Dans la liste des notions qui définissent la mission de l’Œuvre, cette dimension est essentielle et je l’avais gardée pour le dernier numéro de cette année toute spéciale afin de mettre en valeur son importance.
Rendre le Christ fréquentable
Ce mot, célébrer, a diverses significations. Dans cet édito je voudrais parler de la célébration au sens religieux du terme, bien que les autres définitions ne soient pas étrangères à ce que nous vivons à l’Œuvre. Quand nous disons que l’Œuvre est un lieu de célébration, c’est aussi avec le désir de rendre célèbre, c’est-à-dire fréquentable, le Christ et sa Bonne Nouvelle. Le message chrétien n’a pas pour vocation d’être restreint à la confidentialité de la sphère privée ni confiné dans les murs de nos maisons ; au contraire il doit être annoncé hors les murs, urbi et orbi, pour les chrétiens et pour tout le monde, car il concerne toute l’humanité et vise à changer notre manière de vivre en société. Une conception erronée de la laïcité voudrait qu’elle consiste à réduire l’impact des religions en les cantonnant à une histoire seulement individuelle, alors que la laïcité a pour objet au contraire d’assurer la bonne cohabitation de tous les principes de vie – religieux, philosophiques ou politiques – en leur assurant la liberté d’expression et en évitant toute main-mise de l’un sur les autres. Nous avons le droit de penser par nous-mêmes, nous pouvons avoir des points de vue différents et des orientations particulières, nous avons le devoir de donner le meilleur de nous-mêmes et de vouloir que la société fasse des choix qui nous semblent les plus judicieux, donc nous avons la responsabilité d’exprimer ce que nous pensons être le plus juste, le plus vrai. Pour ce qui est de la décision finale et des grandes orientations de nos sociétés, nous avons aussi le devoir de respecter la pluralité des opinions et nous devons faire confiance à l’intelligence humaine pour que les décisions qui concernent tout un pays soient prises démocratiquement en tenant compte des conseils que tous peuvent exprimer, les religions ayant leur voix particulière à donner dans cette dynamique.
Célébrer la messe
Pour ce qui est de la dimension religieuse de la notion de célébration, la vocation de l’Œuvre est d’accompagner les jeunes afin qu’ils découvrent la joie de célébrer le culte qui revient au Seigneur. Le sommet de cette célébration est vécu lors de la messe du dimanche, car elle récapitule ce qu’est la vie pour un chrétien : nous nous rassemblons, avec toutes nos différences qui sont des richesses à partager, nous faisons corps dans ce lieu que nous appelons Église et qui symbolise l’appartenance à un corps, à une communauté. Nous nous mettons à l’écoute de la Parole de Dieu, en découvrant qu’elle est une Bonne Nouvelle pour nous aujourd’hui. Nous répondons à l’invitation du Christ qui veut partager sa vie avec nous dans le repas eucharistique durant lequel nous communions à son corps, et nous comprenons que nous faisons partie à notre tour de ce corps. Nous sommes invités à sortir de l’église pour vivre cela concrètement tout le reste de la semaine, en mettant en pratique ce que nous avons vécu pendant cette célébration : à savoir l’amour reçu de Dieu que nous partageons avec les autres en les aimant comme Dieu les aime.
Toute notre vie est célébration
Si le sommet de la vie chrétienne est vécu lors de la messe du dimanche, la célébration de la Bonne Nouvelle chrétienne ne se réduit pas à cette pratique dominicale : elle est le tout de notre vie. Ce que nous vivons tout le reste de la semaine est une manière de célébrer le Seigneur. Par nos gestes, nos paroles, nos regards, nos engagements, nous célébrons dans le quotidien de nos vie l’engagement de Dieu dans le monde. Nous pouvons comprendre cela d’autant mieux en ces semaines de confinement durant lesquelles nous avons été privés de la célébration communautaire de la messe. Cela ne doit pas nous empêcher de vivre toute la semaine comme une manière de célébrer le véritable culte que nous estimons devoir rendre à Dieu : aimer notre prochain, détruire les barrières de la haine et de l’indifférence, combattre les injustices, vivre la solidarité et la fraternité, œuvrer pour la paix. Monsieur Allemand, l’exprimait avec des mots adaptés à la réalité de ce que les jeunes vivent dans nos maisons : jouer et prier sont les deux mouvements d’une même dynamique de célébration !
Olivier