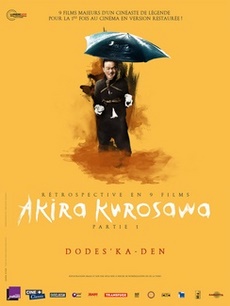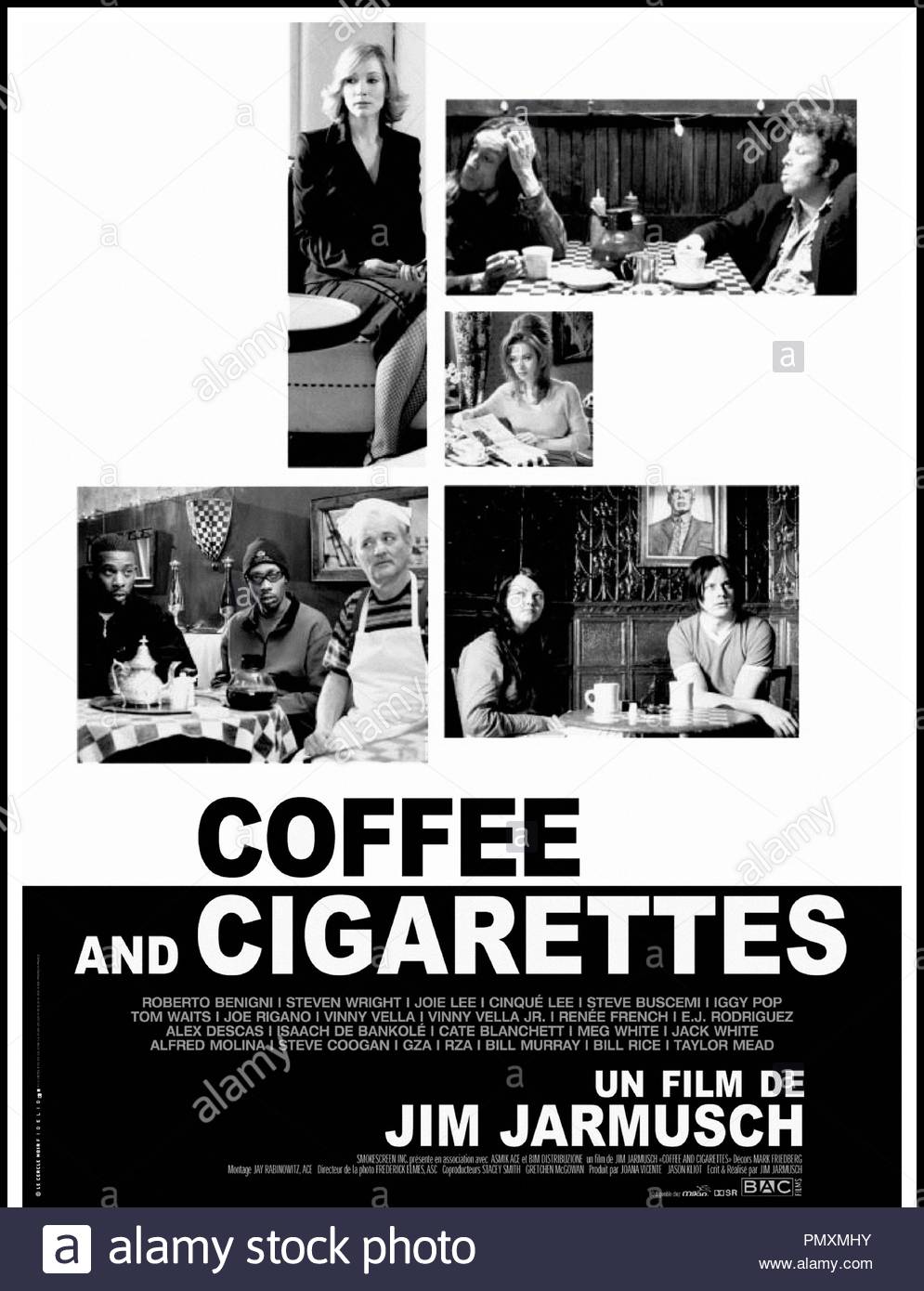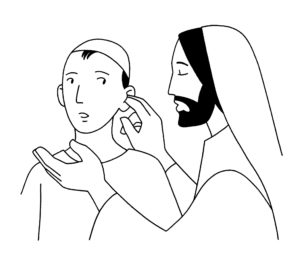Lettre du Villard – mars 2020
LETTRE DU VILLARD
Le Villard, le 15 mars 2020
Cher ami,
À peine ai-je utilisé cette formule que j’en ressens la sottise, ces deux mots étant redondants. Si vous êtes mon ami, n’est-ce pas parce que vous m’êtes cher ? Des amis qui ne seraient pas chers seraient-ils de vrais amis ? Certes, les exemples ne manquent pas d’amitiés qui ne le sont que de nom. Il n’est que de voir les propositions d’amitié qu’on reçoit sur Facebook. En d’autres temps, on distinguait les amis, des camarades, des collègues, des connaissances, des relations, des proches, etc, mais dans notre société qui ne s’embarrasse pas .des nuances, tout a été mis dans le sac de l’amitié. Ceci signifie non pas que l’amitié n’existe plus mais que l’usage du terme est galvaudé. Alors, comment vous saluer ? « Ami ! », fait un peu cavalier, pour ne pas dire ostentatoire, dans le genre « Eh ! Mon brave ! ». « Mon ami » est également dans la redondance, puisqu’on ne peut imaginer que celui qui vous écrit s’adresse à une autre personne qu’à vous. Alors ? « Mon cher » ? On peut, là encore, objecter que faire précéder « cher » du possessif « mon » ne se justifie pas puisque, lorsqu’on est cher à quelqu’un, on est déjà dans une relation d’appartenance. Je n’imagine pas, non plus, vous bailler du simple « Cher ! » qui ferait un peu précieux sinon tendancieux. J’attends vos remarques et vos propositions sur ce sujet qui doit occuper dans les préoccupations de nos contemporains la surface d’une tête d’épingle.
Nous sommes heureux que les chûtes de neige du mois de février aient pu permettre à toute votre famille d’éprouver les joies qu’elle attendait de son séjour hivernal dans notre bout du monde ; je me remémore avec plaisir les promenades en raquettes que nous avons faites et les conversations que nous avons eues tant entre nous qu’avec les amis du Villard. À ce sujet, je reviendrai sur une des remarques que vous avez faites, alors que nous grimpions vers les Trois cabanes. Vous m’avez rappelé une opinion que j’avais émise dans ma précédente lettre, à savoir que l’idée de morale est désormais exclue du débat public. Vous considériez, au contraire, que notre société est devenue moralisatrice, à la façon de ce qu’on voit outre atlantique, où, à ce qu’on dit, le message des Pères fondateurs puritains reste toujours révéré, du moins dans la forme. La rudesse de la montée m’a alors privé du souffle qui m’aurait permis quelques objections puis nous avons dérivé vers d’autres sujets. Je voudrais cependant y revenir, pour constater en premier lieu notre accord sur le fait qu’en certains domaines, mais en certains domaines seulement, on ne compte plus le nombre de groupes de pression qui nous font la morale. Ma remarque avait cependant un objet légèrement différent : elle faisait référence aux situations où, notamment devant le tribunal de l’opinion publique et, en certains cas, devant les tribunaux judiciaires, il n’est pas politiquement correct, ni recevable, de relever les infractions à la morale dès lors qu’elles ne sont pas pénalement répréhensibles. On vient certes de loin, et pendant des siècles, le droit a en grande partie découlé de la morale, elle-même façonnée à partir de la religion dominante. À partir du moment où la religion est exclue de l’organisation sociale, une morale sociale privée de bases hésite à émerger. Cela fait bien l’affaire de ceux qui veulent vivre à leur guise. L’exemple récent de l’abandon par un candidat de la course à la Mairie de Paris montre cependant à mon sens qu’un fond de consensus moral reste partagé par le plus grand nombre. Si cette personne n’avait pas eu conscience que ce qu’elle avait fait serait considéré dans l’opinion publique comme « quelque chose qui n’était pas bien », elle n’aurait pas abandonné. Cela me rassure un peu de voir que les notions de bien et de mal, qu’écarte le discours public, n’ont pas disparu chez l’individu.
« Jusqu’à quand ? » s’interrogeait l’ami Beraud avec qui nous en parlions. Eh bien, sur ce point-là, je ne suis pas trop pessimiste. Je ne doute certes pas que ceux qui ne veulent pas des valeurs que notre société occidentale a mises en exergue, sans toujours les respecter, ne se sentent pas encouragés par le laxisme ambiant pour essayer de faire triompher leur nihilisme. Il me semble cependant qu’au cœur de l’homme « du peuple » subsiste la conscience du bien et du mal. « Conscience ! Instinct divin, immortelle et céleste loi ! »1 a justement lancé Rousseau qui par ailleurs souvent m’agace. Cet instinct « divin (…) parle la langue de la nature que tout nous fait oublier » souligne Jean-Jacques. Je crois qu’il restera toujours en nous un fonds incompressible d’humanité, qui nous fait distinguer, sans nécessairement que cela procède d’une réflexion de notre part, à la fois le Bien du Mal et le caractère artificiel des propositions de ce que Gastinel nomme Satan. Le problème, reprend notre ami, est que le contexte n’est pas neutre et que, s’il faut reconnaître une qualité à Satan, c’est bien celle de la persévérance. « Perseverare diabolicum »2, ajoute sentencieusement Gastinel.
Cette persévérance est illustrée par ce qu’on a appelé l’affaire Matzneff, masquée depuis par l’affaire Polanski. Il faut alors avoir à l’esprit que dans les années 1970-1980 des personnes comme Louis Aragon, Jean-Paul Sartre ou Michel Foucault et les groupes dans la mouvance de l’idéologie de mai 68, ne voyaient pas les agissements d’individus de ce type d’un trop mauvais œil. Le fait pour des adultes d’avoir avec des enfants des relations que la morale et la société condamnaient était alors considéré par eux comme une étape dans la libération de l’individu. Agir ainsi devenait acte de rébellion contre la société, épisode dans la déconstruction d’une société basée, selon eux, sur l’ignorance, les préjugés et les traditions. Sous l’égide de Marx, qui n’est pas en cause dans cette affaire, mais qui était attaché à combattre les logiques de domination, celle « des patrons sur leurs ouvriers, des professeurs sur les élèves, des médecins sur les malades, des parents sur les enfants »3, et avec la bienveillance des précités se présentaient comme des libérateurs, le mineur émancipé du joug de ses parents, accédant à son plein épanouissement et à sa liberté.
« On en est revenu » nota Me Beraud – « J’en doute, reprit Gastinel, lorsqu’on voit toutes les tentatives de déconstruction de notre monde, toujours selon les mêmes arguments. On a l’impression que tout est oppression pour ceux qui ne se reconnaissent pas dans une société d’expérience, élaborée par des siècles d’histoire, de culture et d’usages. Alors tout est bon pour grignoter le socle culturel, pour nous faire perdre nos repères ». Beraud, toujours moins catastrophiste que Gastinel, développait son idée selon laquelle les seules idéologies qui durent sont celles qui correspondent vraiment à ce qu’est l’homme ; il avançait que tout ce qui nie la meilleure part de l’homme finit un jour ou l’autre par disparaître… « Comme le coronavirus, peut-être, gronda le colonel. Vous étiez certain il y a quelques semaines que l’épidémie serait sans effet majeur ! Et maintenant, j’ose à peine vous serrer la main, les écoles sont fermées, les gens âgés confinés, les entreprises mettent leur personnel au chômage et cela va coûter une fortune aux misérables contribuables que nous sommes, tant en indemnisations qu’en perte de recettes fiscales ». Me Beraud convint que les informations dont il disposait alors l’avaient conduit à sous estimer le phénomène, mais qu’il restait confiant dans les possibilités des pays de limiter le nombre de victimes ainsi que les conséquences économiques. « Ah ! Ne recommencez pas, lui lança Gastinel ; n’oubliez pas, comme je vous l’ai dit tout à l’heure, que perseverare (est) diabolicum ! Je me demande ce qui me retient de vous envoyer au bûcher avec les suppôts de Satan ! »
J’espère que ce petit mot vous trouvera en bonne santé, ainsi que toute votre famille… et que, lorsque nous recevrons votre réponse, nous serons dans le même état !
Prenez soin de vous, car, à ce qu’on dit, ce n’est pas vain.
Mon épouse se joint à moi pour vous redire notre amitié.
P. Deladret
- L’Emile ou De l’éducation, 1762.
- Persévérer (dans l’erreur) est diabolique.
- Enquête du Monde du 29 février, sous la plume d’Anne Chemin.