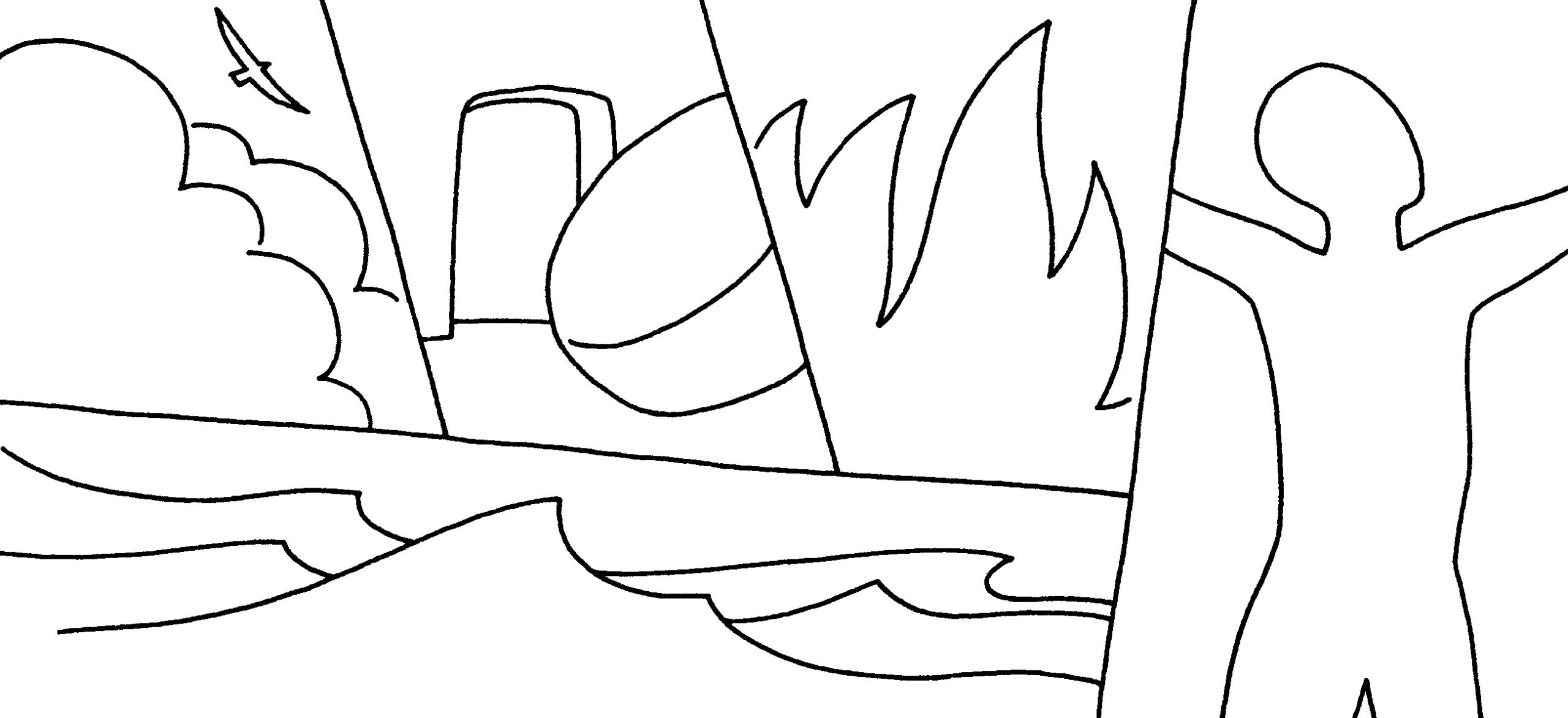Lettre du Villard – mai 2020
LETTRE DU VILLARD
Le Villard, le 20 mai 2020
Mon cher,
Votre dernière lettre nous confirme dans l’idée que la période de confinement qu’a subie votre famille n’a pas été trop difficile à vivre et que les rites que vous aviez choisis avaient du bon pour éviter que le temps que vous ne trouviez pas à valoriser comme à l’ordinaire ne soit du temps évaporé.
À entendre Mimiquet qui, dès le 11 mai, est monté de la vallée pour nous faire causette, un pan entier de la société des gens prétendument rassis, disons de notre âge, est retombé sinon en enfance, du moins en adolescence, les gens passant le plus clair de leur temps à jouer avec leur téléphone pour échanger des plaisanteries. On dit communément que la nature a horreur du vide et l’expérience est là pour montrer que bien souvent nous ne résistons pas à la tentation de nous livrer à des activités « occupationnelles », comme on dit maintenant, pour « passer le temps » quand ce n’est pas pour le « tuer ». Ceci dit, comme l’a souligné le Pape, qui sommes-nous pour juger ? Que telle activité est plus noble qu’une autre ? Quelle aune prendre ? L’utilité sociale, peut-être. Ce qui n’empêche pas que l’activité de certains bénévoles relève parfois aussi de l’« occupationnel ». Qu’importe ; restons-en aux effets, aux actes et non à ce qui a pu les motiver. Si l’Enfer, dit-on, est pavé de bonnes intentions, le Ciel est sans nul doute constellé d’étoiles qui ne s’attendaient pas à s’y trouver.
Les gens qui ont un peu d’expérience ne mésestiment pas la vertu éducative du « temps vide », de l’ennui, qui conduit ceux qui y sont confrontés à développer leur imagination et leur réflexion, du moins lorsque l’individu a quelques dispositions en ces domaines. N’est-ce pas ce que nous avons connu dans notre enfance, lorsque nous ne voyions plus la fin des « grandes vacances » ? Au rebours de ce que pensent bien des parents, laisser un enfant (un peu) s’ennuyer en veillant discrètement à ce qu’il (ne) fait (pas), n’est pas de la maltraitance mais de la bienveillance.
Vous me rappelez d’ailleurs que, dans un domaine parallèle, cette perspective de ne plus avoir « rien à faire » a effrayé le colonel Gastinel lorsque le moment est venu pour lui de prendre sa retraite. Je me souviens de lui avoir dit qu’il allait passer de la vie subie à la vie choisie mais cela ne le tranquillisait pas pour autant. Sans doute son travail ne lui était-il pas cause d’une souffrance particulière. Ou, du moins, d’une souffrance qui, dans la balance, pesait moins lourd que la crainte de l’ennui de ne plus avoir d’obligation professionnelle. Rassurez-vous, il s’est bien accommodé de cet état.
Mimiquet, que je soupçonne de s’être adonné sans trop de réserve à ce cancanage qu’il stigmatise, relève à juste titre qu’on ne peut être en permanence occupé des seules choses de l’esprit. Je ne peux qu’être de son avis, en relevant cependant que certains comportements donnent à penser que tout le monde ne paraît pas trop voir la raison de se poser la question.
Nous verrons bien, dans les semaines qui viennent, si l’élargissement progressif du déconfinement annoncé va produire des effets en ce domaine. Nous entrons en effet dans une période dont l’observation devrait être passionnante. L’image qui me vient à l’esprit est celle de la débâcle, non de celle de 1940, mais de celle de la banquise ; tout ce qui était figé s’en va çà et là, sans qu’on puisse prévoir ce qui peut advenir. Le monde sera-t-il meilleur ou sera-t-il pire ? Les réponses qu’on est tenté d’apporter dépendent moins de la raison, inopérante en la matière, que du système hépatique ; je veux dire par là qu’il y a des gens qui, comme on dit, « se font de la bile » et d’autres non. Il y a ceux qui prennent leurs désirs pour des réalités et qui ne voient pas de raison pour s’encombrer des expériences du passé. Mais il y a aussi ceux qui considèrent que si les choses sont ce qu’elles sont ce n’est pas sans raison. D’autres encore sont dans l’incantation et se complaisent avec les œillères qu’ils se sont données.
L’expérience des mois passés et des multiples pronostics contradictoires qui nous ont été livrés devraient nous conduire à être particulièrement prudents. Aucun État n’a su que faire et tous ont improvisé, avec leur culture. On ne reprochera pas sans mauvaise foi aux politiques de ne pas avoir trouvé de parade à un mal dont on ne sait toujours rien. Me Beraud, avec qui nous avons repris quelques relations distantes et qui nous rejoint pour le café sur le balcon, abonde dans ce sens mais considère qu’il aurait mieux valu qu’ils tiennent un langage de vérité, qu’ils disent qu’ils ne savaient pas ce à quoi nous étions affrontés et qu’ils allaient faire au mieux, non seulement avec les moyens du bord mais aussi avec ceux qu’ils n’ont pas, puisque c’est avec les impôts qu’on va prélever sur les contribuables payant l’impôt1 qu’on va essayer de rembourser les dettes ainsi accumulées. Gastinel, qui partageait ce jour-là notre conversation, lui a remontré qu’une telle franchise aurait été insupportable dans un pays comme le nôtre, où la surenchère démagogique est le moteur de la vie politique et la recherche du consensus une tare inavouable. Nous n’étions pas, et nous ne sommes pas plus, prêts à accepter la vérité, d’autant plus qu’après des mois de recherches nous avons l’impression qu’elle court devant nous en nous fuyant.
On ne peut, non plus, écarter le risque que les pouvoirs publics ne reçoivent un choc en retour car le fait d’avoir essayé de donner à penser qu’ils savaient ce qu’ils faisaient ou disaient, dans un domaine où ils ne savaient pas grand-chose, a sans doute sapé la confiance minimale dont ils bénéficient en bien d’autres domaines : qui peut dire que les orientations économiques, militaires, culturelles, et j’en passe, qui sont présentées aux différentes démocraties (les dictatures n’ont pas ce genre de problème) ne sont pas décidées dans un contexte d’aussi grande incertitude ? La France a connu suffisamment de défaites militaires pour être un tant soit peu concernée par la question. Que dire des politiques économiques dont on nous affirmait qu’elles allaient apporter la prospérité et le plein-emploi ? J’espère que ceux qui avançaient cela y croyaient un peu… Et que dire de ceux qui veulent plus (ou moins) d’Europe ? En ignorant tout ce que cela peut donner. Dans le courant du xxe siècle, on a tenté de nous convaincre que la complexité de ce qui constituait l’action gouvernementale ne pouvait être laissée à de braves citoyens élus du peuple, qui n’avaient du bien commun qu’une aspiration, non une expérience. C’est ainsi que l’idée de gouvernements de technocrates a fait son chemin jusqu’à ce qu’on en voie, notamment dans la crise sanitaire actuelle, les limites mais aussi les aspects suicidaires. La liberté de parole inhérente à la démocratie permet à chacun d’exprimer ses doutes ; il serait tragique qu’on glisse du doute ponctuel à une suspicion généralisée.
Notre ami notaire m’a cité, à propos de cette crise, un adage de l’ancien droit dont la force réside notamment dans la concision : « La bonne foi n’exclut pas l’impéritie »2. Ce que nous vivons confirme la pertinence de l’adage mais ne nous assure pas, mais alors pas du tout, que d’autres auraient eu les aptitudes voulues dans les circonstances actuelles. Il faut donc être humble. À Gastinel, qui est un enthousiaste, qui est prêt à faire confiance à ceux qui lui disent ce qu’il aime entendre et à tenter le saut dans l’inconnu, j’ai cité Saint Exupéry : « Ce qui sauve, c’est de faire un pas. Encore un pas »3. Et je lui ai rappelé que l’Histoire ne montre pas que les révolutions aient apporté aux peuples les bonheurs que leurs auteurs leur promettaient. Comme je disais qu’à mes yeux la seule façon honnête de vivre était, que l’on soit chrétien ou non, de se comporter en hommes de bonne volonté, au sens où l’entend l’Évangile, cela a eu le don de l’exaspérer : « Ce ne sont que prêchi-prêcha » a-t-il fulminé en déposant sa tasse.
Heureusement, Mimiquet était là et a fait diversion en me demandant s’il devait faucher votre pré. Je me suis cru autorisé implicitement à l’inviter à le faire. J’espère que vous pourrez prochainement nous confirmer que vous venez passer vos vacances au Villard ; ce sera pure charité de votre part car avec le confinement nous tournons toujours plus en rond et nous craignons de ne pouvoir soutenir une conversation avec votre famille.
Croyez en nos pensées les plus amicales.
P. Deladret
- 16 sur 38 millions de foyers fiscaux.
- Impéritie : manque d’aptitude.
- Terre des hommes, 1938.